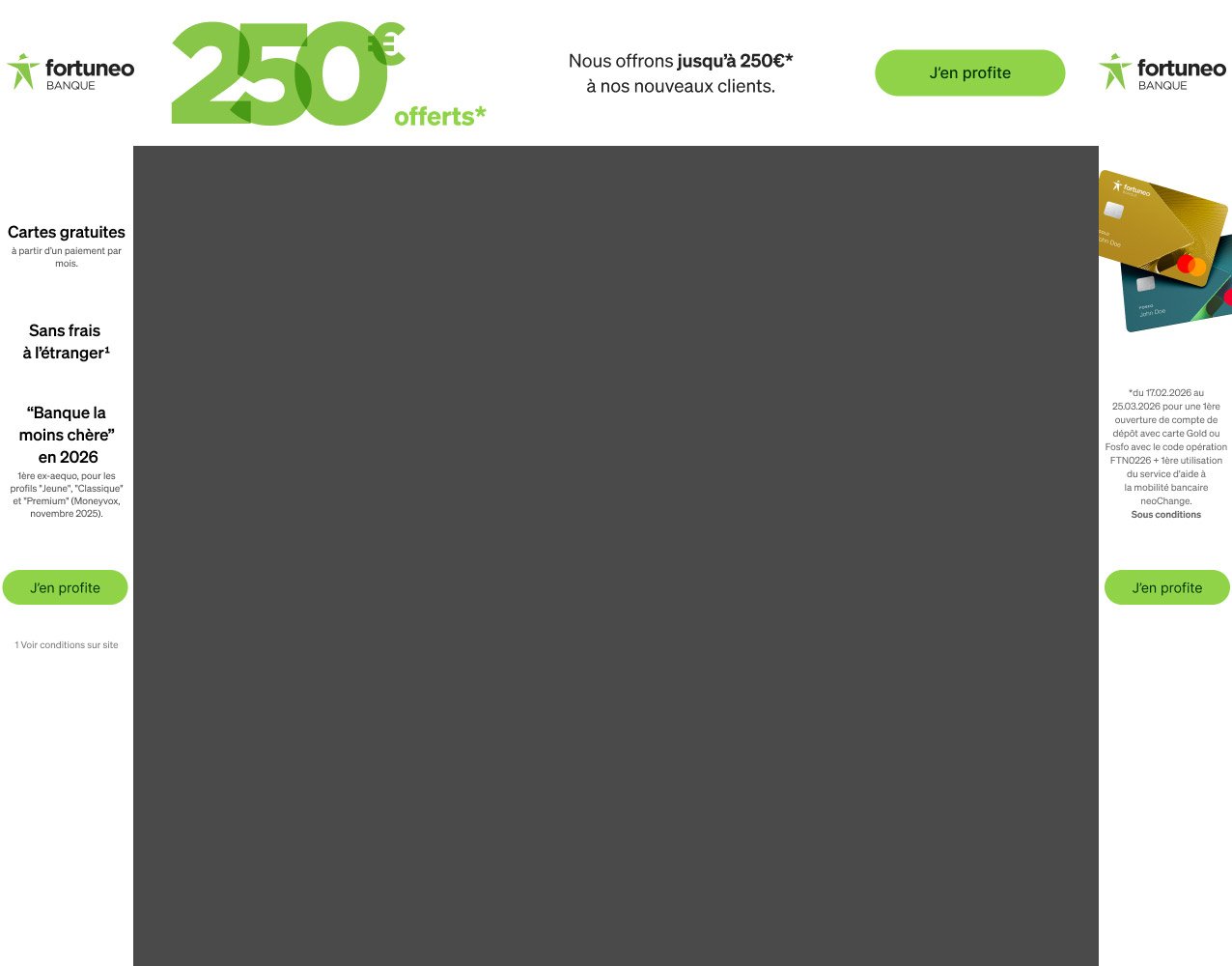Un peu plus d'1% des paiements, hors espèces ; 22,7% des montants dérobés... En 2024, le chèque est resté le moyen de paiement le plus fraudé, assez nettement devant la carte bancaire et le virement instantané.
Une situation qui dure depuis 2018 et qui a convaincu l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP) de la Banque de France de formuler, en 2021, des recommandations à destination des usagers et des banques pour renforcer la sécurité des paiements.
La grande majorité de la fraude trouve son origine dans l'utilisation de chéquiers volés pendant leur acheminement. Elle prospère également, car les usagers tardent à faire opposition, soit parce qu'ils ne sont pas conscients du vol d'un chéquier qu'ils n'ont jamais reçu, soit parce que la procédure d'opposition est trop complexe... et trop chère.
Ce que les banques ne font pas pour vous protéger de la redoutable fraude au chèque
Les pratiques tarifaires des banques, en effet, peuvent parfois être une entrave à la lutte contre la fraude, comme le montre le rapport 2025 de l'Observatoire des tarifs bancaires (OTB), publié aujourd'hui.
Des oppositions qui coûtent cher
C'est notamment le cas des frais d'opposition. « Au 1er avril 2025, seuls 6 établissements (principalement des banques en ligne) proposent gratuitement l'opposition à un chèque ou un chéquier », note l'OTB dans un communiqué. « 92 établissements facturent ce service, avec des tarifs majoritairement compris entre 10 et 20 euros pour un chèque, et entre 15 et 30 euros pour un chéquier. » Le panel de l'OTB compte 103 établissements.
Parmi ces six banques, on retrouve quatre banques en ligne (Fortuneo, BoursoBank, Monabanq, Hello Bank) et une grande banque commerciale (BNP Paribas, à condition que l'opposition soit effectuée en ligne). La sixième est une banque régionale mutualiste, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, qui propose toutefois une gratuité très limitée, puisque seule la première mise en opposition est offerte.
Quels frais pour faire opposition à un chèque ou un chéquier ?
Pour rappel, l'OSMP recommande « de ne pas pratiquer des tarifs pouvant conduire certains clients à renoncer à la mise en opposition » et « de ne jamais appliquer de frais de mise en opposition dans le cas de chéquiers déclarés perdus ou volés dans les circuits de distribution, avant leur réception par l'utilisateur », rappelle l'OTB.
Des envois sécurisés beaucoup, beaucoup plus coûteux que les envois simples
Une autre pratique tarifaire peut potentiellement nuire à la lutte contre la fraude : celle qui consiste à facturer beaucoup plus cher les frais d'envoi de chéquier en recommandé. Pour des questions pratiques ou parce que c'est la solution proposée par défaut par leur banque, de nombreux usagers se font envoyer leurs chéquiers à domicile par la Poste. Ils ont généralement le choix entre un envoi simple ou un envoi en recommandé.
Selon l'OTB, la première solution est proposée gratuitement dans 44 établissements. Ailleurs, son prix moyen est de 0,89 euro. S'ajoute parfois la facturation des frais postaux, de l'ordre de 2,80 euros actuellement.
L'envoi sécurisé coûte beaucoup, beaucoup plus cher :
- 7,55 euros en moyenne pour un recommandé simple ;
- 9,04 euros en moyenne pour un recommandé avec accusé de réception.
Envoi d'un chéquier à domicile : quel prix ?
S'ajoutent parfois à ces prix les frais postaux, compris entre 7,40 et 11,30 euros selon la présence d'un AR et selon le niveau de recommandation. Seuls huit établissements facturent uniquement ces frais postaux et deux banques seulement (BoursoBank et Fortuneo) offrent gratuitement l'envoi en recommandé.
Pour mémoire, l'OSMP recommande « pour des raisons de sécurité, de laisser la possibilité aux clients des établissements possédant un réseau d'agence, de venir chercher leur chéquier au guichet, et ce gratuitement comme le prévoit le Code monétaire et financier (article L. 131-71) », rappelle l'OTB. Il demande également aux banques de renoncer à la pratique des envois de chéquiers par courrier simple.
Banque en ligne : le comparatif des offres
Mise à jour (10 octobre 2025, 18h) — Corrections sur le nom des banques proposant la gratuité sur les mises en opposition de chèques.