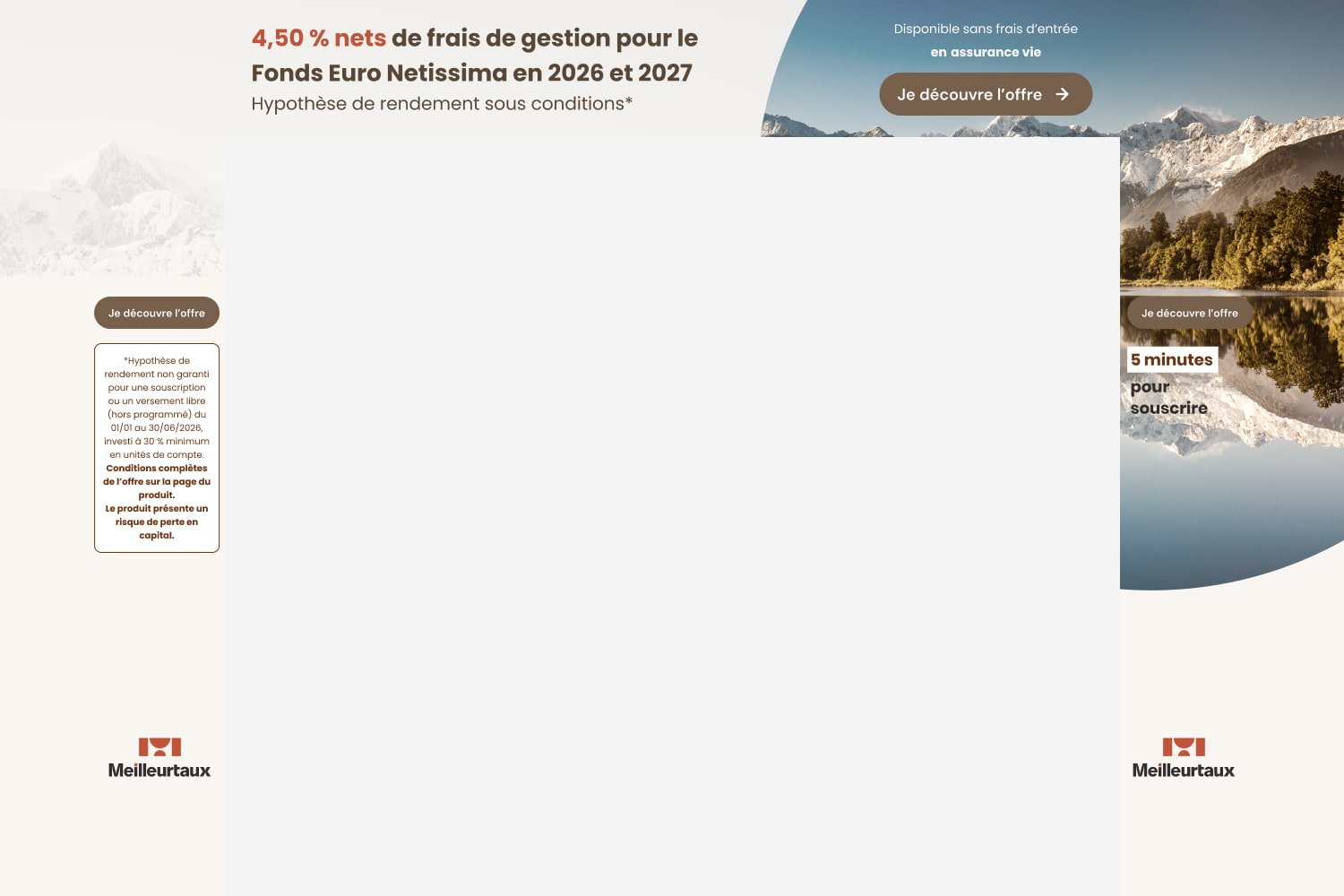Verdict ? Une banque, d'abord, qui donne la priorité à l'intérêt de ces clients. Premier critère : 40% des sondés (1) veulent une politique de frais bancaires raisonnable, qui ne cherche pas à réaliser des marges trop élevées sur ce qui est vendu. Seconde priorité : le devoir de conseil, cité par 37% des répondants : une banque et ses collaborateurs doivent proposer ce qu'ils estiment être dans l'intérêt de leurs clients.
Mais les Français ne s'intéressent pas qu'à leur intérêt personnel immédiat. Ils attendent également de leur banque qu'elle accorde de l'importance aux critères sociaux et environnementaux :
- 33% attendent qu'elle privilégie des investissements liés à l'intérêt collectif ;
- 33% également qu'elle reste éloignée des paradis fiscaux ;
- 30% qu'elle ne dépende pas d'actionnaires ;
- 26% qu'elle intègre l'écologie dans sa politique et dans ses actes ;
- 24% qu'elle réalise ses activités en lien avec un ancrage local et la connaissance de son territoire.
Les bonnes questions à se poser avant de choisir sa banque
De la parole aux actes
Les Français sont en effet bien conscients des enjeux liés à l'usage de leurs dépôts. Ils souhaitent massivement que leur argent serve à favoriser le développement économique local et territorial (86%), à agir en faveur de l'environnement (78%) et pour réduire les inégalités sociales (78%). Voire à participer au maintien de la paix dans le monde (72%) et à renforcer la souveraineté de la France (66%).
Reste à passer de la parole aux actes. De manière paradoxale, la finance solidaire reste embryonnaire en France, quoiqu'en essor. Fin 2021, elle représentait 0,42% du patrimoine financier des Français, avec un encours de 24,5 milliards d'euros, en hausse de 26% en un an.
Le classement des banques les moins chères
(1) Sondage effectué en ligne par Viavoice du 10 au 17 juin 2022 auprès d'un échantillon de 1 000 personnes, représentatif de la population habitant en France Métropolitaine âgée de 16 ans et plus (méthode des quotas appliquée aux critères suivants : sexe, âge, profession, région et catégorie d'agglomération).