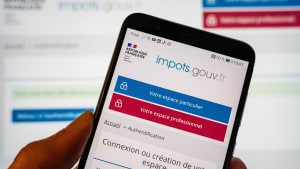Pourquoi vos revenus ne sont-ils pas imposés jusqu'à 11 497 euros ? Pourquoi passent-ils à un taux d'imposition à 11% jusqu'à 29 315 euros, 30% jusqu'à 83 823 euros, puis 41% et 45% encore au-delà ? Pourquoi ce barème à tranches est-il revalorisé chaque année ? Pourquoi un gel (ou « année blanche ») cristallise les débats ?
Pourquoi, dans les faits, seuls 43% des ménages paient l'impôt, et uniquement à partir de 17 447 euros de revenu net imposable ? Finalement, pourquoi ce barème complexe ne pourrait-il pas être remplacé par un système plus lisse et progressif ?
Plongée dans le barème, avec l'économiste Pierre Boyer, membre du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) et auteur de Peut-on être heureux de payer des impôts ? (1) pour cerner les subtilités de la fiscalité française.
« Le seul pays qui n'a pas de tranches mais un barème lisse, c'est l'Allemagne »
Pourquoi la France ne passe-t-elle pas à un barème d'impôt sur le revenu « sans tranche » ? Ne serait-ce pas plus simple et même plus juste ?
Pierre Boyer : « À ma connaissance, le seul pays qui n'a pas de tranches mais un barème lisse, c'est l'Allemagne. Leur barème repose sur une fonction mathématique. Eux ont fait ce choix avec un souci d'effet de lissage et pour éviter les effets pervers liés aux seuils de tranches. »
Le système du barème de l'impôt sur le revenu par tranches a-t-il été créé dans un souci de lisibilité, avec des seuils identifiés ?
P.B. : « Ça semble être la norme. En France, il y a eu une période où le système était différent. En 1937, une réforme a été menée par le Front populaire. L'idée assumée, et annoncée dans leur programme, était “si vous voulez taxer fort les plus aisés, vous devez changer la structure du barème pour être encore plus progressif sur l'impôt”. C'était pour permettre d'aller plus fort sur les revenus plus élevés : ce barème fonctionnait avec un taux d'impôt moyen, appliqué à l'ensemble de vos revenus, et qui augmentait selon le niveau de revenu. La France est ensuite revenue en 1942 à un barème avec des tranches et des taux marginaux. Ce principe n'a plus évolué depuis. »
« La France est ensuite revenue en 1942 à un barème avec des tranches. Ce principe n'a plus évolué depuis »
Le barème de l'impôt revient fréquemment dans le débat politique : supprimer une tranche, changer un taux, geler la revalorisation, etc. Mais pourquoi le principe de ce barème ne fait pas débat ?
P.B. : « Au fil de mes recherches, j'ai étudié avec mes collègues un panel de 927 réformes fiscales dont l'ensemble des réformes des pays de l'OCDE depuis 20 ans et dans certains pays comme la France et le États-Unis depuis le début du XXème siècle. Où que ce soit, mis à part en Allemagne comme évoqué plus tôt, nous avons systématiquement des barèmes fiscaux avec tranches. Par exemple, aux États-Unis, jusqu'à la période Reagan, il y avait beaucoup plus de tranches. Plus récemment, Trump a proposé pendant la campagne électorale de 2016 de passer de 7 à 4 tranches d'impôt sur le revenu.
« Il y a une simplicité apparente mais celle-ci n'est pas forcément réelle. On peut retrouver deux foyers avec des situations comparables mais avec des niveaux d'imposition très différents »
Mais pourquoi garde-t-on, partout, cette forme-là de barème fiscal, avec des tranches et des taux marginaux ? C'est une excellente question. Oui il y a l'argument de la lisibilité. Peut-être, aussi, à une époque, la facilité d'application pour l'administration, ce qui serait moins vrai aujourd'hui. Après, le système actuel est lisible au premier abord mais il y a une réelle sophistication derrière. Car l'impôt dépend de la situation familiale, du type de revenus : travail ou capital notamment. Il y a une simplicité apparente mais celle-ci n'est pas forcément réelle. On peut retrouver deux foyers avec des situations comparables mais avec des niveaux d'imposition très différents, du fait des multiples facteurs intervenant en sus du barème à tranches. »
À Bercy, ils connaissent évidemment le fonctionnement allemand... et ils ne l'ont jamais choisi.
P.B. : « Cela dit, il faut étudier cette question de façon plus large qu'un simple barème. Dans les différentes études comparatives, le système socio-fiscal allemand n'est pas plus efficace que le système français. En France, nous avons notamment un dispositif d'incitation au retour à l'emploi et de soutien aux travailleurs modestes, la prime d'activité, qui n'existe pas en Allemagne. Or la prime d'activité permet de soutenir des situations de reprise d'emploi qui peuvent être dans le cas contraire désincitatives au niveau fiscal. »
Il faut donc se poser des questions au niveau plus global, au-delà du seul impôt sur le revenu ?
P.B. : « Oui. Pour avoir une vision éclairée du modèle socio-fiscal, il faut regarder l'impôt sur le revenu mais aussi la prime d'activité, le RSA et les APL. Là on analyse le système socio-fiscal au niveau plus global.
« Sur le long terme, nous ne sommes pas loin d'une réforme par an ! On aurait pu penser que la réforme du prélèvement à la source en 2019 rendrait l'impôt sur le revenu moins visible, puisque sa perception est devenue plus diffuse. Mais ce n'est pas le cas »
L'impôt sur le revenu sert souvent de punching-ball électoral. Quand l'on regarde sur le long terme, nous ne sommes pas loin d'une réforme par an ! On aurait pu penser que la réforme du prélèvement à la source en 2019 rendrait l'impôt sur le revenu moins visible, puisque sa perception est devenue plus diffuse. Mais ce n'est pas le cas. La moitié des Français connaissent très exactement leur taux de prélèvement à la source : c'est ce qui est ressorti des études réalisées depuis par le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO). C'est étonnant car la CSG (contribution sociale généralisée) touche tous les revenus, les Français sont conscients qu'ils la paient mais ils ne connaissent pas le taux de CSG, qui est, dans le cas général, de près de 9% sur les revenus d'activité et sur les revenus du patrimoine et de placement. »
Cette réforme de l'impôt à la source a-t-elle amené plus de clarté ? A-t-elle finalement eu un effet pédagogique sur l'impôt sur le revenu ?
P.B. : « C'est mon sentiment mais c'est impossible à démontrer. Car nous n'avons pas posé cette question sur le taux de prélèvement avant la réforme. Avant 2019, j'aurais été étonné que 50% des Français ne donnent leurs taux moyens de tête ! La prochaine enquête permettra, elle, d'étudier l'impact du passage au taux individualisé par défaut. »
« Il ne faut pas oublier la décote et l'entrée dans l'impôt, ça, ce ne serait pas facile à lisser ! »
Sans chercher à faire évoluer l'impôt à payer, est-ce techniquement faisable de basculer sur un barème « lisse » avec un pourcentage augmentant progressivement ?
P.B. : « Oui je pense que ce serait possible. Si vous voulez une fonction lisse, dans les problèmes mathématiques, ce serait possible de faire une approximation lisse du barème actuel. Mais il ne faut pas oublier la décote et l'entrée dans l'impôt, ça, ce ne serait pas facile à lisser ! »
Impôt sur le revenu : la décote, ce mécanisme complexe qui réduit voire efface votre montant à payer
Y aurait-il un intérêt à changer de système, en basculant sur un barème à l'allemande ?
P.B. : « Peut-être que ce serait plus simple pour l'administration. Mais je ne sais pas si ce serait plus simple pour les contribuables. Dans les enquêtes sur le consentement l'impôt, on se rend effectivement compte que ce qui permet de mieux comprendre le système aide au consentement à l'impôt. On a intérêt à ce que le contribuable comprenne bien le système ! Donc si un tel changement pouvait aider à comprendre l'impôt, cela aurait des effets bénéfiques. Mais, au final, quand l'on regarde le baromètre des prélèvements obligatoires, la France est finalement très proche des pays voisins : en clair les systèmes des voisins ne sont pas vraiment plus simples ni mieux compris.
« La difficulté n'est pas forcément le barème en lui-même mais l'ensemble des autres aspects : le quotient familial, les déductions et crédits d'impôts, les abattements, la décote, etc. »
La difficulté, par rapport au barème de l'impôt sur le revenu, n'est pas forcément le barème en lui-même mais l'ensemble des autres aspects : le quotient familial, les déductions et crédits d'impôts, les abattements, la décote, etc. Avec tous ces éléments additionnels, ça se complique !
Enfin, concernant les effets pervers d'un barème à tranches comme le nôtre, est souvent pointé le risque d'une accumulation de foyers “en coin”, au changement de taux. »
C'est-à-dire ?
P.B. : « En théorie, ce système risque de vous inciter à ne pas progresser en revenus pour éviter de basculer dans la tranche supérieure. Dans la réalité, on n'observe pas ce type de phénomène quand l'on regarde au niveau de la population globale. Au final, si l'on ne change pas de système, pour un barème à l'allemande, c'est surtout qu'il n'y a pas suffisamment d'arguments pour un tel changement. »
« Si l'on ne change pas de système, pour un barème à l'allemande, c'est surtout qu'il n'y a pas suffisamment d'arguments pour un tel changement »
L'idée d'un euro symbolique, pour que tout le monde soit imposable, et non plus « seulement » 43% de la population, revient régulièrement dans les débats budgétaires à l'Assemblée nationale. Ce serait un bon signal pour la compréhension et le consentement à l'impôt ?
P.B. : « On est là sur la notion de justice fiscale. Certains pensent qu'il faudrait imposer les revenus au premier euro. Pour que le système soit juste, ils adhèrent à un critère de stricte proportionnalité. D'autres pensent que ce n'est pas important, que la justice fiscale se situe a contrario du côté de la redistribution des revenus. C'est une conception de la citoyenneté. Toutefois, si l'on place le contribuable dans une vision globale, rien qu'avec la CSG et sans même parler de TVA, le nombre de personnes contribuant aux prélèvements est nettement plus élevé !
« Une majorité de Français pensent que, oui, l'impôt est un acte citoyen »
Sur le consentement à l'impôt, tout est une question de perspective. Avec le CPO, nous posons plusieurs questions. Payez-vous trop d'impôts ? En France, paie-t-on trop d'impôt ? Est-ce que payer l'impôt est un acte citoyen ? Trois quarts des Français pensent que l'on paie trop d'impôts en France. Mais au niveau individuel, la réponse est déjà moins nette : 65% pensent que, eux, paient trop. On interprète cela comme un rejet du système actuel plutôt que d'un rejet de l'impôt en lui-même. Surtout qu'une majorité de Français pensent que, oui, l'impôt est un acte citoyen. »
(1) « Peut-on être heureux de payer des impôts ? », aux éditions PUF. 2024.