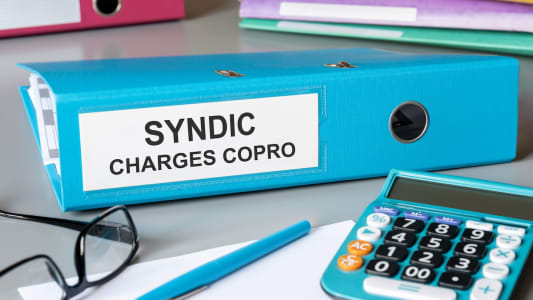Les charges de copropriété sont un sujet central que l'on soit propriétaire ou locataire d'un appartement. Voici ce qu'elles comprennent, leur montant, et qui doit les payer.
Les charges de copropriété constituent un sujet central dans la gestion des immeubles collectifs. Elles permettent de couvrir les dépenses nécessaires au bon fonctionnement, à l'entretien et à l'amélioration des parties communes. Toutefois, leur nature, leur répartition entre copropriétaires et locataires, ainsi que leur régularisation, soulèvent souvent des questions pratiques et juridiques. Cet article détaille les différentes catégories de charges, leurs coûts moyens, les responsabilités financières des parties, ainsi que les modalités de régularisation et de paiement.
Définition des charges de copropriété
Les charges de copropriété sont les dépenses courantes que doivent payer collectivement les copropriétaires pour assurer le bon fonctionnement de la copropriété.
L'article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis indique que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. »
Les différentes charges de copropriété
Les charges générales
Ces charges concernent l'entretien et la conservation des parties communes, ainsi que les services collectifs dont bénéficient tous les copropriétaires. Elles incluent :
- Le nettoyage des espaces communs : escaliers, couloirs, halls d'entrée...
- Les consommations générales : électricité, eau des espaces communs...
- Les frais administratifs : assurance de l'immeuble, syndic...
Les charges spéciales ou charges d'équipement collectif
Ces charges concernent les équipements collectifs, leur entretien et leur fonctionnement. Elles sont réparties en fonction de l'utilisation potentielle ou réelle des équipements par les copropriétaires. Exemples :
- Chauffage collectif et eau chaude
- Ascenseur
- Interphone et digicode
Les charges exceptionnelles
Ces charges concernent les travaux importants, tels que :
- Ravalement de façade
- Réfection de la toiture
- Mise en conformité avec des normes légales (ascenseur, accessibilité)
La distinction entre ces charges est essentielle pour déterminer leur répartition et leur mode de financement.
À noter que ces principes sont complétés par les règlements de copropriété, qui précisent souvent la répartition spécifique des charges dans chaque immeuble. Pour tout savoir de ses charges, il faut donc se référer à ce document.
Quel est le prix des charges de copropriété au mètre carré ?
Le coût moyen des charges de copropriété varie selon plusieurs facteurs : la localisation géographique du bien (les charges sont généralement plus élevées dans les grandes villes), les équipements collectifs disponibles dans la copropriété (ascenseur, présence d'un gardien, chauffage collectif...) ou encore la taille de la copropriété (les coûts seront mieux répartis dans les grands immeubles).
Selon les estimations de différents acteurs spécialisés dans la gestion des copropriétés en France, à l'image de Sergic, les coûts moyens en 2023 étaient de 15 à 20 euros par m2 par an en moyenne pour un petit immeuble sans ascenseur. Il faudra en revanche compter entre 25 et 35 euros par m2 par an en moyenne pour les immeubles avec services classiques (ascenseur, chauffage collectif). Enfin, les immeubles proposant des prestations « haut de gamme », disposant par exemple d'un gardien ou d'une piscine, peuvent voir leurs charges de copropriété s'envoler à 50 euros par m2 et par an.
Cas particulier des travaux exceptionnels
Attention : Les travaux importants peuvent faire exploser les coûts. Ces charges sont réparties en fonction des tantièmes de copropriété (proportion de propriété détenue par chaque copropriétaire).
Qui doit payer les charges : locataire ou propriétaire ?
La répartition des charges entre le locataire et le propriétaire est encadrée par le décret n° 87-713 du 26 août 1987.
Charges récupérables auprès du locataire
Le locataire doit payer les charges dites « récupérables », qui concernent l'entretien courant, les services collectifs et les consommations individualisées. Sont ainsi récupérables les charges concernant le nettoyage des parties communes, l'entretien des espaces verts et de l'ascenseur, ou encore les charges sur l'eau et le chauffage collectif (sur répartition).
Ces charges sont fixées sur la base d'une provision ou d'un forfait dans le bail et réglées tous les mois. Le dépannage de l'ascenseur, ou encore les menues réparations dans les parties communes comme l'entretien de la minuterie, la pose, la dépose et l'entretien des tapis sont autant de charges considérées comme récupérables. L'intégralité des charges récupérables est à retrouver ici.
Charges incombant au propriétaire
Le propriétaire reste responsable des charges relatives aux travaux d'amélioration, aux grosses réparations ou encore à toutes les charges ne profitant qu'au propriétaire comme les honoraires de syndic. La répartition peut être clarifiée dans le règlement de copropriété ou le contrat de location.
Mode de paiement des charges : mensuel, annuel ou trimestriel ?
Les charges de copropriété peuvent être payées soit mensuellement, soit une fois par trimestre, voire une fois par an. La méthode est généralement précisée dans le règlement de copropriété.
Ainsi, les paiements mensuels et trimestriels se font par provision de charges. Les copropriétaires versent une provision (mensuelle ou trimestrielle) calculée sur le budget prévisionnel de l'année, voté lors de l'Assemblée générale (AG). Les locataires paient ainsi une provision mensuelle, incluse dans le loyer. Une fois par an, une régularisation est effectuée.
En cas de paiement annuel en revanche, aucune régularisation n'est nécessaire, car le versement se fera après le calcul des dépenses annuelles réelles. Mais contrairement à la mensualisation, la charge financière doit être supportée sur un unique paiement.
Régularisation des charges, mode d'emploi
La régularisation est une étape obligatoire pour les copropriétés et les baux de location. À la fin de chaque exercice comptable, le syndic établit un arrêté des comptes. Les dépenses réelles sont comparées aux provisions versées par les copropriétaires.
Si un surplus existe, il est remboursé ou affecté à un fonds de travaux. En cas de déficit, les copropriétaires doivent verser un complément. Ils peuvent consulter les justificatifs (factures, contrats) pendant une période légale de six mois après l'assemblée générale.
Dans le cadre d'un contrat de location, l'article 23 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. »
À noter que dans certains cas, le locataire peut demander un étalement de la régularisation. Ainsi, le même article rappelle que « lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande. »
Enfin, le propriétaire (ou l'agence immobilière) peut réclamer pendant 3 ans tout impayé de charges. Ce délai s'applique aussi au locataire qui a payé trop de charges et veut se faire rembourser le trop-versé.
Déductions fiscales possibles
Dans certains cas, le propriétaire peut bénéficier d'allègements fiscaux sur les charges. En revanche, les locataires ne bénéficient d'aucune déduction fiscale sur les charges qu'ils payent.
Pour les propriétaires bailleurs, il est ainsi possible de déduire de ses revenus fonciers certaines charges dites déductibles, à l'image des frais de gestion du syndic de copropriété, comme le souligne le site des impôts. Ces déductions permettent de réduire l'assiette imposable.

Romain DESIGNOLLE
Romain Designolle est diplômé du CFPJ depuis 2017. Après des expériences dans le domaine des Sports et de la locale pour des quotidiens régionaux... Lire la suite
© MoneyVox 2025-2026 / Droits réservés