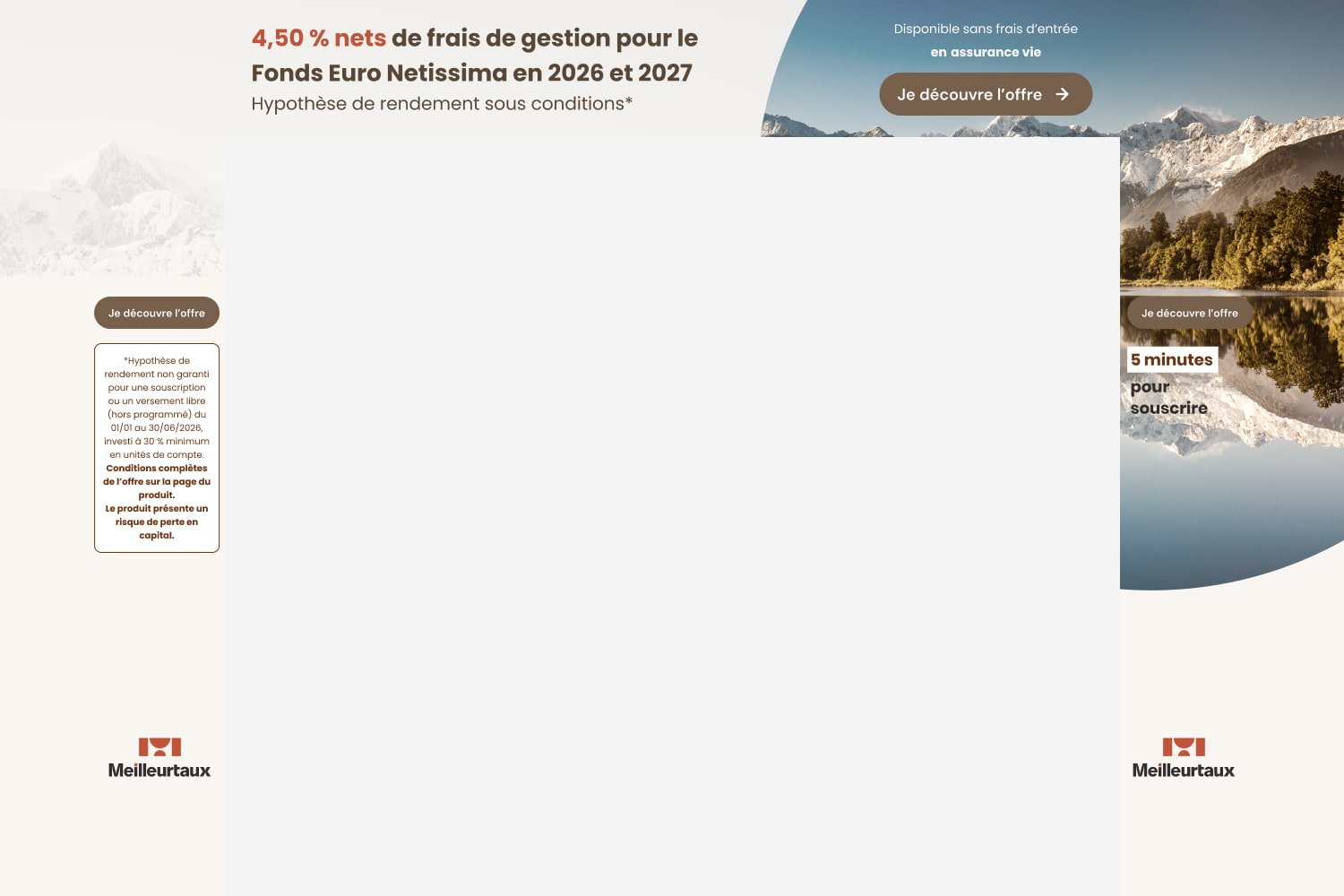L'essentiel
- L'ordonnance 2025-880, qui entrera en vigueur le 20 novembre 2026, prévoit de nombreuses modifications de la réglementation sur le crédit à la consommation en France.
- Une meilleure protection des consommateurs est attendue, avec des règles plus strictes pour les prêteurs, notamment une étude plus attentive de la solvabilité du demandeur avant l'octroi du crédit.
- L'ordonnance prévoit également un élargissement du « périmètre » de la réglementation, touchant davantage de produits, et une augmentation du pouvoir de sanction de la DGCCRF.
Cela va « bousculer » le marché. Le 20 novembre 2026, l'ordonnance 2025-880 relative au crédit à la consommation entrera en vigueur. Publiée le 4 septembre au Journal Officiel, elle prévoit de multiples évolutions de la règlementation. La France avait peu de marge de manœuvre sur son contenu : il fallait transposer la directive européenne du 18 octobre 2023 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Même s'il ciblait avant tout les pays où l'activité est peu régulée, le texte européen impose néanmoins à notre pays d'adapter plusieurs articles du Code de la Consommation. Avec un objectif clair : « limiter les dérives, mieux protéger les consommateurs, et ainsi réduire les risques de surendettement », analyse Timothée Waxin, responsable du département Finance, data & performance à l'École de Management Léonard de Vinci.
Crédit conso : le business juteux de l'assurance emprunteur qui coûte très cher aux consommateurs
Un sujet essentiel : selon les chiffres de la Banque de France, « la part des dettes à la consommation chez les ménages surendettés atteint 43%, en hausse de trois points sur un an ». Et ce alors que 134 803 dossiers ont été déposés par les ménages français en 2024, « en hausse de 10,8% par rapport à 2023 ».
Doit-on s'attendre à une révolution ? Pas forcément. « Ce n'est pas une réforme aussi colossale que l'était la Loi Lagarde en 2010 », tranche Jérôme Lasserre Capdeville, Maître de conférence à l'Université de Strasbourg et auteur du livre Le droit du Crédit à la Consommation. Une loi qui avait posé à l'époque un cadre strict dans un secteur en pleine dérive. « Dans l'ordonnance du 3 septembre, il s'agit plutôt d'évolutions logiques, de reprécisions, d'ajouts... » Avec notamment 6 mesures qui devraient modifier les pratiques et habitudes, tant des professionnels que des clients.
Crédit conso : comment les banques vous mettent la pression pour prendre l'assurance emprunteur
Des publicités revues
C'est certes symbolique, mais l'ordonnance modifie la fameuse formule accompagnant les publicités. « Un crédit vous engage et doit être remboursé », devient « Attention ! Un crédit coûte de l'argent et doit être remboursé ». Un message plus assertif, qui permet selon les experts de montrer qu'un crédit « n'est pas une ressource, mais une dépense ».
« Les publicités doivent également intégrer des exemples et des éléments explicatifs », détaille Remi Legrand, enseignant à Science Po Paris et auteur du livre Le Crédit à la consommation. Les messages devront ainsi « décomposer ce qui est proposé : mensualités, taux, type de crédit, engagement... » L'accent est mis sur le taux effectif global (TAEG, le coût total du crédit en incluant tous les frais). Et la présentation doit s'adapter aux différents supports. Un moyen d'en finir avec les « petites lignes » invisibles sur smartphone !
Plus de contrôle par les prêteurs
Fini, le dossier signé en quelques minutes en banque ou sur internet. À partir de novembre 2026, les prêteurs doivent mener « une étude minutieuse de la solvabilité du demandeur », explicite Rémi Legrand. Les modalités (justificatifs...) doivent être définies par décret, mais l'idée sera de leur permettre « d'évaluer les revenus, les dépenses courantes, voire le patrimoine, pour avoir une appréciation du reste à vivre et de la capacité de remboursement. C'est un grand changement, car jusque-là, l'information n'était pas normée. »
Le professeur de Sciences Po relève que la directive imposera au créancier, avant tout accord, « de consulter le FICP, fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers. » Les exceptions : ce sera « facultatif » pour les crédits de moins de 3 mois, les « sans frais », et les montants inférieurs à 201 euros.
« Beaucoup de situations compliquées résultaient du fait que les prêteurs ne vérifiaient pas la solvabilité de l'emprunteur. »
Pour l'économiste Timothée Waxin, ces précautions sont un moyen de « limiter les excès dans l'accès au crédit des ménages. Beaucoup de situations compliquées résultaient du fait que les prêteurs ne vérifiaient pas la solvabilité de l'emprunteur. Les professionnels du secteur, y compris pour le paiement fractionné, ne sont pas contre. »
Ce qui va restreindre mécaniquement l'accès au crédit des personnes les moins aisées, comme le reconnaît Pauline Dujardin, déléguée générale de la Fédération Crésus, réseau d'associations accompagnant les personnes en difficultés financières : « C'est un sujet complexe, mais cela permettra de se rendre compte de quelles sont ses propres capacités. »
De nouveaux produits concernés
Autre évolution majeure : l'élargissement du « périmètre » de la règlementation. Actuellement, les prêts inférieurs à 200 euros et supérieurs à 75 000 euros ne rentrent pas dans le « cadre protecteur » du crédit à la Consommation.
Fin 2026, « les règles s'appliqueront dès le premier euro, et jusqu'à 100 000 », indique Rémi Legrand. Par ailleurs, cette évolution concernera aussi certaines formes particulières de prêt : la location avec option d'achat, le découvert bancaire... Et surtout deux éléments qui font débat : le paiement fractionné (le fameux « X fois sans frais ») et les mini crédits.
« Lorsqu'il paye en trois fois, le consommateur n'est pas conscient qu'il est en train de faire un crédit. »
Un enjeu important selon Rémi Legrand, alors que « ces facilités de paiement explosent en Europe ». Or « leur encadrement est aujourd'hui très léger. Vous pouvez les obtenir en trois clics, ou en quelques instants en caisse... » Le professeur regrette que trop souvent, « lorsqu'il paye en trois fois, le consommateur n'est alors pas conscient qu'il est en train de faire un crédit. » Avec tous les engagements que cela suppose... Comme de le rembourser, sous peine de perdre son bien !
« Cette évolution répond à ce que beaucoup d'études avaient souligné : les nouvelles formes de crédits posent problème, constate Timothée Waxin. Les conditions ne sont pas suffisamment expliquées aux consommateurs. Il était nécessaire de clarifier et stabiliser ce marché. » Car si, bien utilisé dans le cadre du budget personnel, le paiement fractionné peut être « un outil intéressant », Pauline Dujardin suggère qu'il peut devenir « dangereux quand on commence à en cumuler »...
Malgré tout, la fédération Crésus se satisfait que les paiements fractionnés ne soient pas interdits par l'ordonnance aux ménages surendettés. « L'idée est de protéger, limiter, mais non interdire. Ces crédits peuvent permettre à des personnes, même en difficulté, de remplacer un bien indispensable, comme une machine à laver en panne... »
Des propositions clarifiées
L'ordonnance renforce l'obligation d'information avant la signature du contrat. La fiche préalable normalisée à l'émission de l'offre (FIPEN) va devenir ainsi plus précise. « Elle va devoir mieux expliquer les caractéristiques de l'opération demandée par les clients : montant et type de crédit, mensualités, taux effectif global (TAEG) intégrant tous les éléments de frais et assurances, droit de rétractation... », reprend Rémi Legrand.
Et le banquier ne pourra pas se contenter de remettre le document. « Les composantes doivent être commentées et expliquées à l'emprunteur. » De son côté, l'offre finale doit également se montrer plus précise. « Elle devra mieux détailler tout ce qui concerne le crédit et les obligations auxquelles il engage. ». Jérôme Lasserre Capdeville relève un autre élément notable : le prêteur sera désormais tenu par « l'obligation légale de mise en garde sur le risque de crédit ».
Un devoir d'accompagner et d'orienter
Face aux incidents de crédit, il était déjà demandé aux banquiers une forme de « clémence » et de « compréhension ». L'ordonnance fixe un cadre plus précis. « Elle prévoit l'obligation pour le prêteur de proposer des solutions autour d'un rééchelonnement, un étalement, l'allongement de la durée du prêt... » notifie Rémi Legrand. « On encourageait déjà les banquiers à renégocier, à se montrer patientes... Désormais, ils doivent aider les clients », complète Jérôme Lasserre Capdeville.
En cas de grande difficulté, il devient obligatoire d'orienter vers des services de conseils aux personnes en difficultés financières, notamment les associations spécialisées. Et lors des procédures de recouvrement, Timothée Waxin signale que les pénalités de retard ne devront pas dépasser celles autorisées par la règlementation. « C'est aussi un élément important de protection du consommateur. Car il nous a été remonté qu'il pouvait y avoir, là encore, des dérives. »
Un nouveau pouvoir de sanction
Jérôme Lasserre Capdeville a repéré un dernier élément qui risque de faire parler de lui. « Une énorme évolution, c'est que le pouvoir de sanction relèvera désormais de la DGCCRF ». Confier la mission de contrôle à la répression des fraudes va, selon lui, « tout changer ! Avant, on pouvait avoir des sanctions pénales, mais elles n'étaient jamais appliquées. Une décision de première instance était très rare, et ne parlons pas d'un appel ! Forcément, cela ne découragerait pas les mauvaises pratiques. »
À l'inverse, il est convaincu que la DGCCRF, plus simple à saisir, sera plus encline à dresser des procès-verbaux. De quoi avoir un réel impact dissuasif ?
De (petites) modifications à prévoir ?
Ces nouvelles règles vont forcément ralentir et limiter l'accès au crédit. Une telle évolution n'est pas neutre, d'un point de vue économique. Rémi Legrand synthétise les choses : le crédit « représente un peu plus de 4% de la consommation française sur 2024. » Plus de régulation aura donc un impact sur la croissance et le pouvoir d'achat. De quoi justifier que quelques lignes bougent avant l'année prochaine ?
Justement, avant d'entrer en vigueur, l'ordonnance doit justement faire l'objet d'une loi de ratification et de décrets. Même si l'esprit de la directive européenne doit être respecté, Jérôme Lasserre Capdeville suggère que ce sera l'occasion, pour le législateur, de « reprendre certains éléments ». Comme, peut-être, les conséquences pour l'activité bancaire, ou même les sanctions encourues.