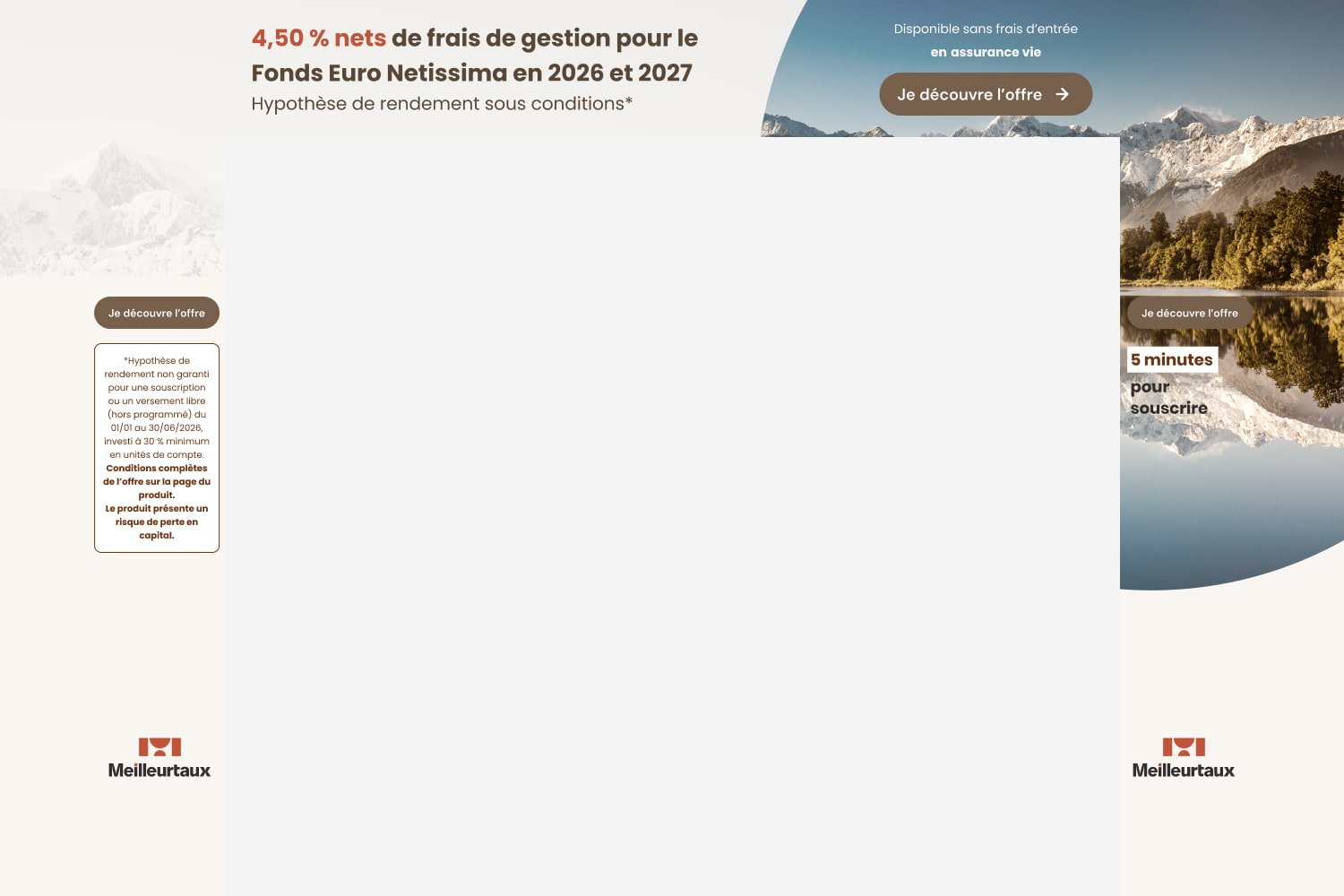L'essentiel
- En 2024, 19% des ménages français détenaient un crédit conso, représentant plus de 210 milliards d'euros, soit plus de 6% du PIB national.
- Deux types de crédit conso existent : le prêt personnel et le crédit affecté, ce dernier étant versé directement au vendeur du produit.
- Les banques ne favorisent pas le crédit affecté en raison de sa réglementation protectrice qui pourtant peut offrir des meilleurs taux aux clients.
C'est un sujet qui concerne des millions de Français. Les chiffres du crédit à la consommation ont de quoi donner le vertige. Selon le dernier Observatoire des Crédits aux Ménages de la Fédération Bancaire Française (FBF), 19% des ménages détenaient ce type de produit fin 2024. Selon la Banque de France, les encours des crédits conso représentaient plus de 210 milliards euros. Cela dépasse 6% du produit intérieur brut du pays !
Il n'est donc pas surprenant que les offres pullulent dans les agences bancaires et sur internet. La présentation varie au gré des campagnes : « Prêt auto », « Spécial rentrée », « Opération vacances »... Le point commun : l'objet de la dépense est mentionné pour toucher les personnes concernées. Mais derrière ces appellations, on ignore souvent que plusieurs produits coexistent, avec des cadres différents.
Crédit conso : ces gros frais augmentent encore, et pourtant vous pouvez éviter de les payer
Des règles différentes selon le crédit
Deux mondes s'opposent : le prêt personnel et le crédit affecté. Quelle est la différence ? « D'un point de vue règlementaire, le crédit affecté se distingue, car la somme est versée directement au commerçant par le prêteur », souligne Rémi Legrand, enseignant à Science Po Paris et auteur du livre Le Crédit à la consommation .
L'argent ne transite donc pas par le compte de l'emprunteur. C'est par exemple le cas des financements proposés par les opérateurs de téléphone, les concessionnaires auto ou les vendeurs d'équipement de la maison : l'argent est débloqué uniquement pour l'achat d'un produit.
C'est toute la différence avec un prêt personnel « classique », car dans ce cas, l'emprunteur reçoit les fonds. Charge à lui de les utiliser par la suite. Or il existe une ambiguïté : de nombreux produits présentés comme « prêts auto », « mariage », « travaux » ou « voyage » ne relèvent en réalité pas du crédit affecté. « En général, ce sont des promotions, des dénominations marketing, rebondit Rémi Legrand. Derrière ces mots, le produit est un prêt personnel classique. » Malgré la mention, « il n'y a pas de cadre règlementaire ».
Crédit conso : comment les banques vous mettent la pression pour prendre l'assurance emprunteur
Les banques boudent le crédit affecté
MoneyVox a sollicité plusieurs banques. La réponse est la même : l'affecté n'a pas la cote. Le Crédit Agricole nous indique ainsi que « les caisses régionales ne font pas de crédits consommation affectés ». « Nos prêts personnels ne sont pas affectés », soutient-on également du côté de BNP Paribas. Et selon nos informations, c'est la tendance dans le milieu. « Ce sont surtout les organismes financiers qui les proposent », glisse un cadre du secteur. En effet, s'ils commercialisent aussi du « crédit conso », le catalogue des Cofidis, Sofinco et autres Cetelem intègre des offres « affectées ». Des organismes d'ailleurs détenus respectivement par le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole et BNP Paribas.
« Le droit du crédit affecté est beaucoup plus protecteur »
Pourquoi les grands réseaux ne s'y aventurent pas ? Une question de « souplesse », nous indique notre contact. Il faut dire que la règlementation ne plaisante pas. « Le droit du crédit affecté est beaucoup plus protecteur », analyse Jérôme Lasserre Capdeville, Maître de conférence à l'Université de Strasbourg et auteur du livre Le droit du Crédit à la Consommation. Il contient ainsi une clause essentielle : la « déchéance du terme ». Le crédit est conditionné à l'achat. En cas de rétractation, le prêt est donc annulé. Il n'y aura rien à rembourser, mais l'emprunteur ne pourra pas disposer du capital.
Mais qu'en est-il des crédits « classiques » ? Quel que soit le motif évoqué, « il y a une liberté », assure Jérôme Lasserre Capdeville. Y compris lorsque l'offre de la banque s'appelle « prêt travaux » ? « Si l'argent est versé à l'emprunteur, c'est un crédit personnel », pointe Rémi Legrand. Et dans ce cas, des clauses imposant la dépense font débat chez les juristes, entre légalité et mention « abusive ».
Des dépenses à justifier ?
Mais le sujet est sensible. Pour vérifier si la dépense a respecté la clause, il faudrait contrôler a posteriori, demander des preuves. Et que faire en l'absence de factures ? Les conseillers ne s'embarrassent donc pas. « Dans le cas d'un prêt personnel, la banque ne demande pas de preuve d'achat », explique-t-on chez BNP Paribas. Pourquoi mentionner « auto » ou « maison » dans la proposition ? « Il s'agit d'opérations commerciales », concède l'institution.
Traduction : une fois le virement reçu, on est libre d'en faire ce qu'on veut. Même pour des produits spécifiques à taux bas, dédiés à la rénovation énergétique ou le maintien à domicile des personnes âgées, BNP Paribas va simplement demander aux clients « des attestations ». Pas plus. « Ces financements ne sont pas affectés : nous ne demandons pas de facture ou de justificatif post-déblocage », précise la banque.
Un rabais sur le taux pour un crédit affecté
Or c'est justement l'élément qui étonne. Quand on « flèche » sa demande, on obtient parfois un rabais de quelques dixièmes de points sur les intérêts. « Pour le prêteur, il est plus intéressant de connaître la destination des fonds », justifie Rémi Legrand. « Dans l'évaluation, le risque financier est moindre dans le cadre d'un achat durable, plutôt que lorsque l'on ne connaît pas l'objet du prêt. »
Il est plus facile pour le banquier d'appréhender l'avenir. « En cas d'achat de voiture, le bien existe. La banque pourrait, en cas de difficultés, la récupérer et la vendre, pour en retirer une valeur », souligne Rémi Legrand. Ce qui ne serait pas le cas si tout est « parti » pour un voyage ou des dépenses courantes !
Une remise en cause du crédit affecté
On pourrait donc se dire que les prêteurs auraient tout intérêt à intégrer une clause de « destination ». Mais le sujet est sensible. Pour vérifier si le contrat est respecté, il faudrait contrôler a posteriori, demander des preuves. Mais que faire en cas d'absence de factures ? Casser le crédit ? « Vérifier si un voyage ou un mariage ont eu lieu... Ce serait un coup à perdre le client, à briser le lien de confiance. » Il en est convaincu : « la banque ne le fera pas » !
D'ailleurs, l'économiste observe que le sujet est sur le point d'être définitivement tranché. La Cour de Justice de l'Union européenne a été saisie par un magistrat pour savoir si un crédit peut être annulé pour une autre raison qu'un problème de remboursement (par exemple, si un achat n'a pas eu lieu). La décision pourrait retourner le marché, car elle remettrait en cause le principe du crédit affecté. « La CJUE a deux ans pour se prononcer. Et si les clauses sont prohibées... C'est la fin des haricots ! », lâche Rémi Legrand.