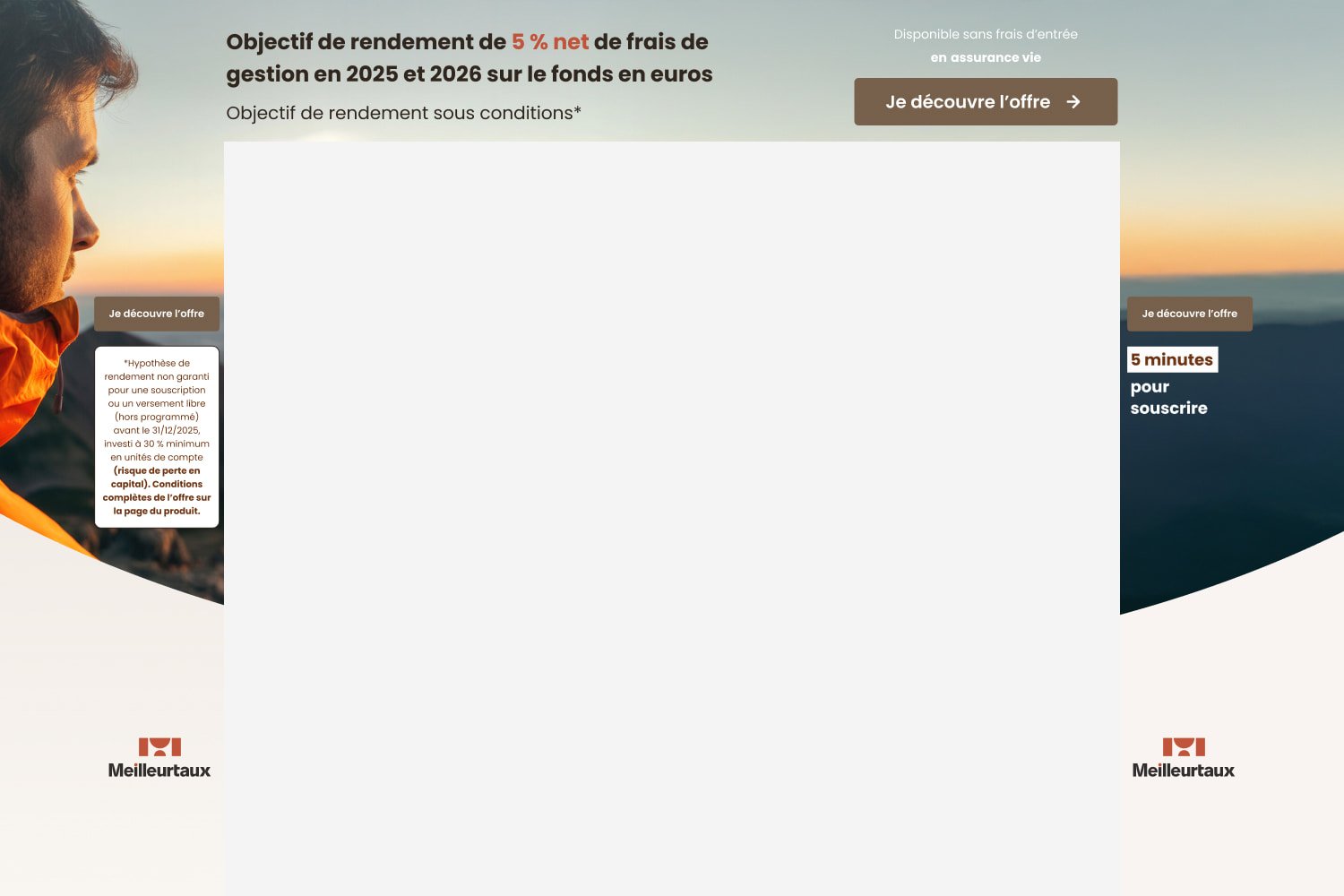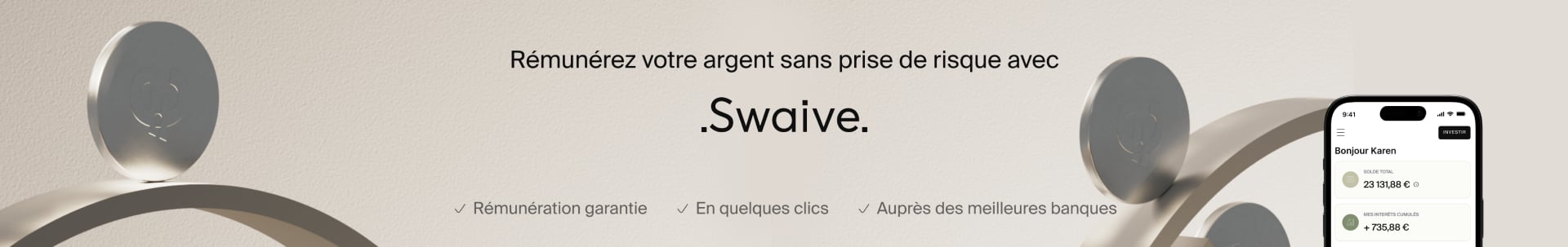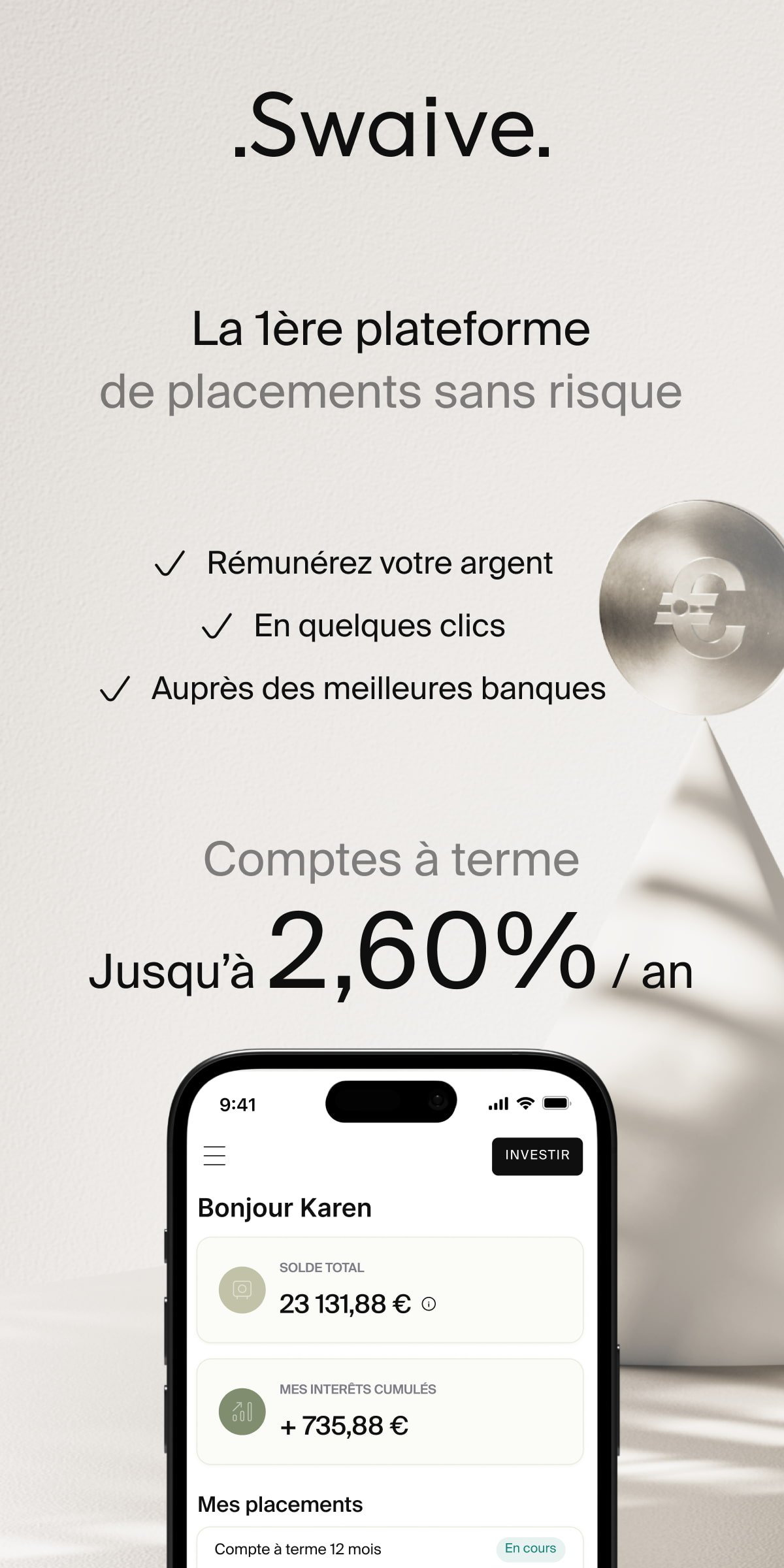Un rapport de l'Unédic, établi à la demande des partenaires sociaux, évoque des pistes de réformes, qui durciraient les conditions d'accès aux indemnités.
Qui est concerné, pour quel coût ?
Voulue par le Medef et créée par la loi de « modernisation du marché du travail » en 2008, la rupture conventionnelle permet au salarié et à son employeur de rompre un CDI à l'amiable. Le salarié touche une indemnité spécifique, négociée avec l'employeur, qui ne peut être inférieure à l'indemnité de licenciement. Il peut ensuite percevoir des indemnités chômage, contrairement à un salarié démissionnaire.
Selon le rapport de l'Unédic, 515 000 ruptures conventionnelles individuelles ont été signées en 2024, majoritairement par des salariés en milieu de carrière, plus diplômés que la moyenne des allocataires de l'assurance chômage. Une étude de l'Institut des politiques publiques début novembre montrait que ces ruptures remplacent souvent des démissions, dont le nombre a diminué de 19% entre les périodes 2003-2006 et 2012-2014.
D'après l'Unédic, 75% des ruptures conventionnelles donnent lieu à une inscription à France Travail et à une indemnisation chômage. En 2024, les dépenses d'allocations chômage liées à ces ruptures ont atteint 9,4 milliards d'euros, soit 26% des dépenses d'allocations.
Une nouvelle négociation sur l'assurance chômage ?
En août, le gouvernement Bayrou avait envoyé une lettre de cadrage demandant aux partenaires sociaux de négocier une nouvelle convention d'assurance chômage en réalisant 2 à 2,5 milliards d'euros d'économies par an entre 2026 et 2029. Elle fixait le 15 novembre comme date butoir pour un accord. Une lettre jugée inacceptable par les syndicats, alors que la dernière réforme est entrée en vigueur en avril dernier.
Après la chute du gouvernement Bayrou, le Premier ministre Sébastien Lecornu a semblé abandonner l'idée d'une nouvelle réforme globale et cibler « les ruptures conventionnelles (qui) peuvent donner lieu à des abus ».
Mais pour la CFDT, les ruptures conventionnelles ne sont pas un « sujet majeur », contrairement aux contrats courts, sur lesquels les partenaires sociaux se sont déjà engagés à négocier, insiste Olivier Guivarch, négociateur du syndicat pour l'assurance chômage.
En outre, « ce n'est pas le gouvernement qui fixe les règles de l'Assurance chômage, ce sont les partenaires sociaux » et l'Assurance chômage n'est pas « une variable d'ajustement pour le budget de l'État », rappelle Olivier Guivarch. « Ce discours des « abus » cherche juste à légitimer une réduction de droits », estime la sociologue au Centre d'études de l'emploi et du travail Claire Vivès, qui pointe les « réformes incessantes de l'assurance chômage depuis 2017 ».
Les ruptures conventionnelles doivent être homologuées par les services du ministère du Travail et très peu ne le sont pas, tandis qu'à France Travail, la recherche active d'emploi est soumise à des contrôles, souligne-t-elle.
Quelles sont les pistes de réforme ?
Le rapport de l'Unédic chiffre plusieurs pistes évoquées dans le débat pour limiter les « phénomènes d'optimisation ». Première piste, un allongement de la durée du différé d'indemnisation. Aujourd'hui, le délai de carence des salariés ayant perçu des indemnités supra-légales lors de leur rupture de contrat est plafonné à 150 jours avant de pouvoir toucher des allocations chômage.
Mais décaler ce plafond à 180 jours ne permettrait d'économiser que 10 millions d'euros par an en régime de croisière, note l'Unédic. Supprimer complètement le plafond ferait grimper le gain à 60 millions d'euros en régime de croisière.
Autre piste, inclure les indemnités légales dans le différé spécifique des ruptures conventionnelles. En cumulant cette mesure et un plafond à 180 jours, l'économie atteindrait 200 millions d'euros en régime de croisière. Ce chiffrage ne tient pas compte des éventuels changements de comportement en cas de réforme.
Un régime ad hoc pourrait aussi être créé, avec des indemnités distinctes de celles des chômeurs. Pour la CGT, ces mesures de rabotage ne seraient « pas acceptables ». Le rapport n'a pas été demandé pour « préempter une décision », insiste son secrétaire confédéral Denis Gravouil.
Olivier Guivarch juge « très prématuré » de parler de pistes précises et souhaite une vraie réflexion pour l'Assurance chômage, loin « du cadre très court-termiste » du gouvernement qui cherche des économies.