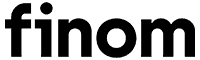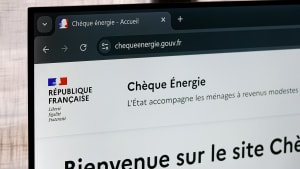Depuis son lancement en 2020, MaPrimeRénov' s'est imposée comme le principal outil public d'aide à la rénovation énergétique. Mais à compter de 2026, le dispositif se recentre sur les rénovations dites « d'ampleur », celles qui permettent de gagner plusieurs classes sur le diagnostic de performance énergétique (DPE). À l'inverse, les gestes isolés, tels que l'isolation des murs ou le remplacement d'une chaudière, seront progressivement exclus des subventions directes. Ils seront désormais soutenus via les CEE.
Et ce n'est pas un simple ajustement. Selon les données présentées par Effy ce jeudi, la nouvelle période du dispositif, qui s'ouvre début 2026, s'accompagne d'un objectif d'économies d'énergie supérieur à la précédente, de l'ordre de 27% environ. Ce renforcement du cadre permettra de financer entre 6 et 10 milliards d'euros d'aides chaque année entre 2026 et 2030. Une montée en puissance qui confirme que les CEE deviendront une arme non négligeable du financement de la rénovation énergétique, en relais partiel de MaPrimeRénov'.
MaPrimerénov' : pourrez-vous bénéficier d'aides à la rénovation en 2026 ?
Pour les particuliers comme pour les professionnels du bâtiment, ce changement de paradigme est majeur. Les aides publiques directes reculent : MaPrimeRénov' ne disparaît pas, mais se concentre sur les projets globaux. À l'inverse, les CEE – financés par les fournisseurs d'énergie, dits « obligés » – gagnent en importance. Ce sont eux qui prendront désormais en charge une grande part du soutien financier, à travers des primes ou des programmes spécifiques.
Une volonté de transférer la rénovation sur les fournisseurs d'énergie ?
Pour les propriétaires, l'enjeu est donc d'anticiper. Les chantiers lancés avant la fin 2025 pourront encore bénéficier du régime actuel. En revanche, dès 2026, les barèmes évolueront et les aides dépendront surtout des volumes de CEE mobilisés par les entreprises partenaires.
Ce virage s'explique avant tout par une logique budgétaire. MaPrimeRénov' a connu un succès massif – et coûteux – pour les finances publiques. En s'appuyant davantage sur les CEE, l'État transfère une partie de l'effort vers les énergéticiens, tout en poursuivant la même ambition : accélérer la rénovation du parc immobilier français.
Mais le gouvernement y voit aussi un moyen d'améliorer l'efficacité. Les CEE constituent un mécanisme de marché régulé : les fournisseurs d'énergie sont mis en concurrence pour atteindre leurs obligations d'économies d'énergie au moindre coût. Cette logique incitative, explique Effy, permet de générer des résultats concrets sans peser sur le budget public.
Reste une difficulté : la lisibilité. Le système des CEE demeure complexe, avec plus de 200 opérations éligibles et des montants de primes très variables. Les fraudes passées ont entaché sa réputation, mais, selon Effy, les contrôles se sont considérablement renforcés depuis 2023, rendant le dispositif plus fiable et plus transparent.