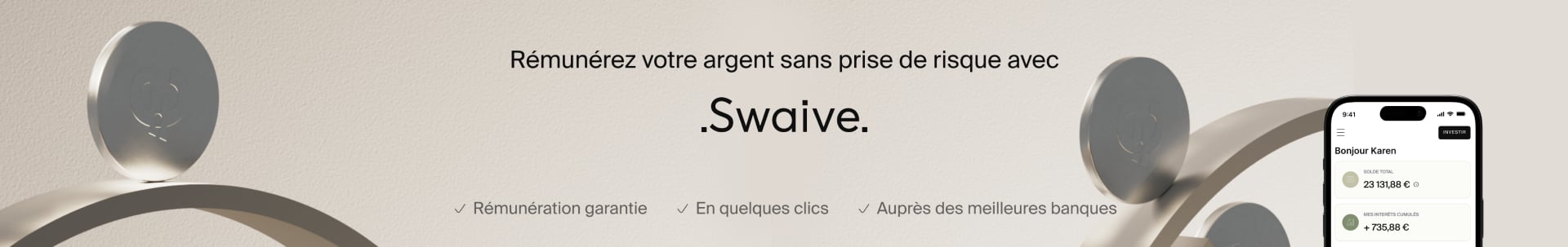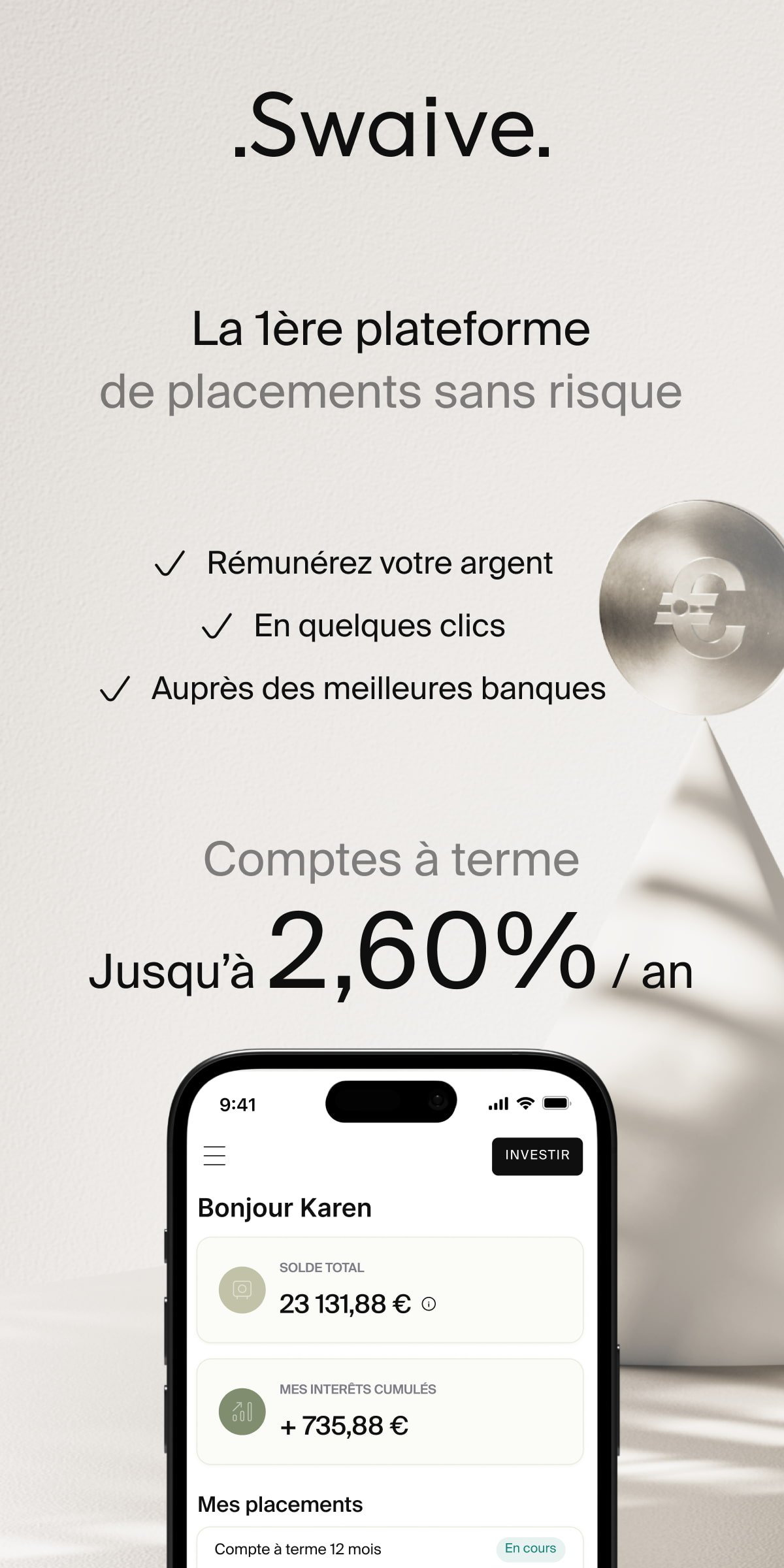1- Que s'est-il passé concrètement le 1er janvier 2025 ?
Les bénéficiaires du RSA sont désormais inscrits à France Travail depuis le début d'année. Cette nouveauté découle de la loi pour le plein emploi. Pas moins de 1,2 million de Français supplémentaires font désormais partie des catégories de demandeurs d'emploi, dont 200 000 jeunes en parcours d'insertion dans les missions locales des départements.
2- Que vont devoir faire les bénéficiaires ?
Après l'inscription automatique à France Travail, les allocataires du RSA doivent signer un contrat d'engagement, « comportant un plan d'actions précisant ses objectifs d'insertion sociale et professionnelle », précise Service-Public.fr. Il est élaboré lors de l'entretien de diagnostic global avec le conseiller.
RSA, prime d'activité : bientôt une bonne nouvelle pour de nombreux allocataires de la CAF
Ce contrat prévoit, notamment, 15 à 20 heures d'activités sous diverses formes : formations, découverte de métiers grâce à l'immersion en milieu professionnel, candidatures aux offres d'emploi, ateliers d'aide à la recherche d'emploi, entretiens ou encore démarches d'accès aux droits, à la santé, au logement, de garde d'enfants. En sont exemptées les personnes en difficulté « en raison de leur état de santé, de leur handicap, de leur invalidité ou de leur situation de parent isolé sans solution de garde pour un enfant de moins de douze ans », précise France Travail.
Cette réforme a déjà été expérimentée dans 49 départements (dont 18 depuis le printemps 2023).
3- Quels sont les résultats de l'expérimentation ?
Quelque 54% des allocataires ayant bénéficié de l'accompagnement de France Travail durant les douze derniers mois ont occupé un emploi à un moment (et même un emploi durable pour la moitié d'entre eux). En ce qui concerne l'objectif des 15 à 20 heures d'activités, il « suscite des réflexions et des débats parmi les professionnels et les allocataires », note le rapport final d'évaluation de l'expérimentation publié en novembre par le ministère du Travail.
« S'il peut être mobilisateur pour les allocataires, l'objectif des 15-20 h suscite aussi des perceptions négatives, notamment le sentiment de devoir se justifier face à un soupçon d'inactivité, est-il écrit. De plus, la contrainte administrative de traçabilité des 15-20 heures est difficile à justifier et peut affecter la relation de confiance avec les bénéficiaires, voire dans certains cas conduire à renoncer au RSA. En pratique, l'atteinte de cet objectif est inégale, plus accessible pour les allocataires proches de l'emploi. »
RSA : des associations alertent sur les dérives des quinze heures d'activité obligatoires
De son côté, le Secours catholique s'inquiète du « risque de travail gratuit », avec une « loi très vague concernant la nature des activités dans le cadre des heures obligatoires ». En un an, le taux de non-recours au RSA est en hausse « de 10,8% dans les départements qui expérimentent la réforme, quand il recule au contraire de 0,8% dans les autres départements sur la même période ».
Par ailleurs, le coût moyen de l'accompagnement renforcé « oscillerait entre 600 euros et 1 200 euros par allocataire selon la modalité d'accompagnement » et jusqu'à 4 000 euros « quand l'accompagnement se veut extrêmement renforcé ».
RSA : ce qui change pour les bénéficiaires en janvier 2025 avec l'inscription à France Travail
4- Les allocataires sont-ils considérés comme chômeurs ?
Jusqu'alors, cinq types de demandeurs d'emploi existaient. De la catégorie A où les personnes sont tenues de « faire des actes positifs de recherche d'emploi », précise l'Insee, à la catégorie E, qui concerne les particuliers « non tenus de faire de actes positifs de recherche d'emploi » (comme les bénéficiaires de contrats aidés et les créateurs d'entreprise).
Désormais, deux nouvelles catégories sont créées. La F concerne les personnes en « parcours d'insertion sociale », alors que la G est une « catégorie d'attente » pour les bénéficiaires du RSA, le temps d'être répartis dans l'une des six premières catégories à l'issue de leur entretien d'orientation.
5- Que va-t-il se passer pour les nouveaux bénéficiaires du RSA après janvier 2025 ?
Les allocataires seront directement inscrits à France Travail, juste après leur demande. Cette mesure concerne le demandeur, mais aussi son conjoint, y compris s'ils exercent une activité professionnelle.
Ensuite, ils renseigneront « directement sur le site internet de France Travail, via un questionnaire en ligne, des informations sur [leur] situation afin d'être orienté vers l'organisme référent susceptible de [les] accompagner au mieux », précise la Caf dans un questions-réponses à ce sujet. Cette démarche peut être complétée par un entretien « avec les services du conseil départemental, ou un organisme désigné par lui-même ». Ensuite, comme pour les allocataires actuelles, les nouveaux bénéficiaires doivent faire un bilan personnalisé et signer un contrat d'engagement.
6- Doivent-ils continuer à déclarer leurs ressources à la Caf ?
Oui, l'inscription à France Travail n'a aucun impact sur le versement du RSA par l'organisme. Les allocataires doivent continuer de faire leur déclaration trimestrielle de ressources en indiquant le montant net social. Tout changement de situation qui pourrait avoir un impact sur le versement de l'aide doit être signalé dans l'espace « Mon Compte ».
CAF : un changement très important dès le 1er janvier 2025 pour toucher certaines aides
7- Les allocataires de la Mutualité sociale agricole sont-ils concernés ?
La réforme concerne tous les bénéficiaires, qu'ils soient inscrits à la Caf ou à la Mutualité sociale agricole (MSA). Cette dernière indique qu'elle « continuera à verser le RSA comme d'habitude ». Fin 2023, 23 141 foyers étaient bénéficiaires de ce minima social (dont 8 392 non-salariés agricoles) à la MSA.
8- Quelles sont les sanctions ?
Pendant l'expérimentation, aucune personne ne pouvait perdre le droit au RSA s'il n'effectuait pas les 15 à 20 heures d'activité. « Ce n'est ni l'objet ni l'objectif » de l'expérimentation, précisait le ministère du Travail en mars 2024. « Ces heures ne sont pas une condition à l'octroi d'une allocation, c'est un élément au sein du contrat d'engagement coconstruit entre la personne et l'organisme référent », poursuivent France Travail et les ministères des Solidarités et du Travail auprès de l'AFP.
En revanche, depuis le 1er janvier 2025, « le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu'il fixe, du versement du RSA lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire refuse d'élaborer ou d'actualiser le contrat d'engagement ou ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat » (article L.262-37 du Code de l'action sociale et des familles).
La contribution pour le financement du RSA
La durée de suspension ou suppression de l'aide, ainsi que le montant concerné « sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer, et en fonction de la nature et de la fréquence des manquements constatés, précise le même article ». Le président du conseil départemental peut également déléguer à France Travail (...) « le prononcé des mesures de suspension du RSA », si une délibération du conseil départemental l'y autorise.
Plus d'1,8 million de bénéficiaires
En septembre 2024, 1,84 million de personnes bénéficiaient du RSA, selon les statistiques du ministère des Solidarités. Le montant de l'aide est, actuellement, de 635,70 euros pour une personne seule, 953,56 euros pour un couple sans enfant et 1 334,98 euros pour un couple avec deux enfants.