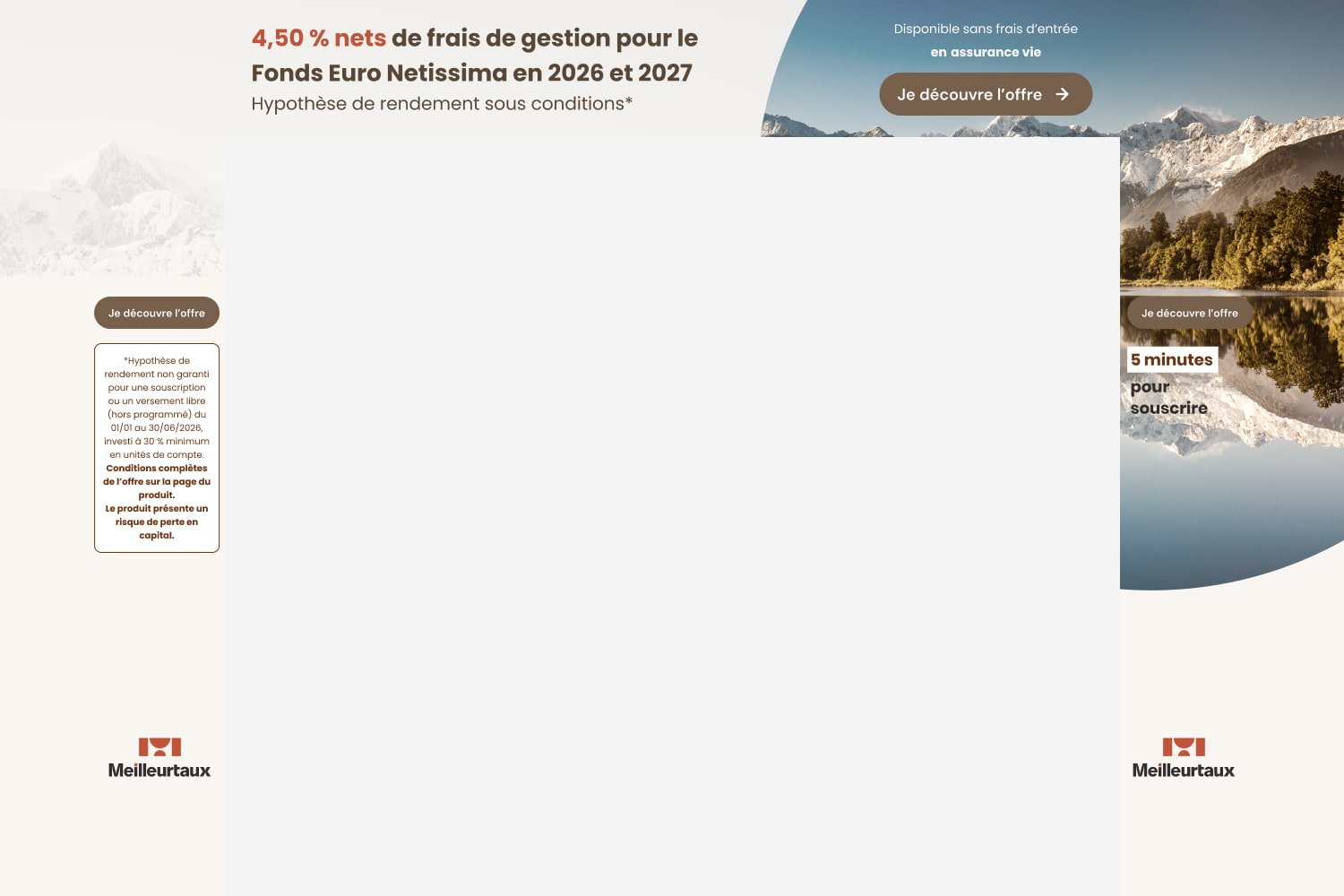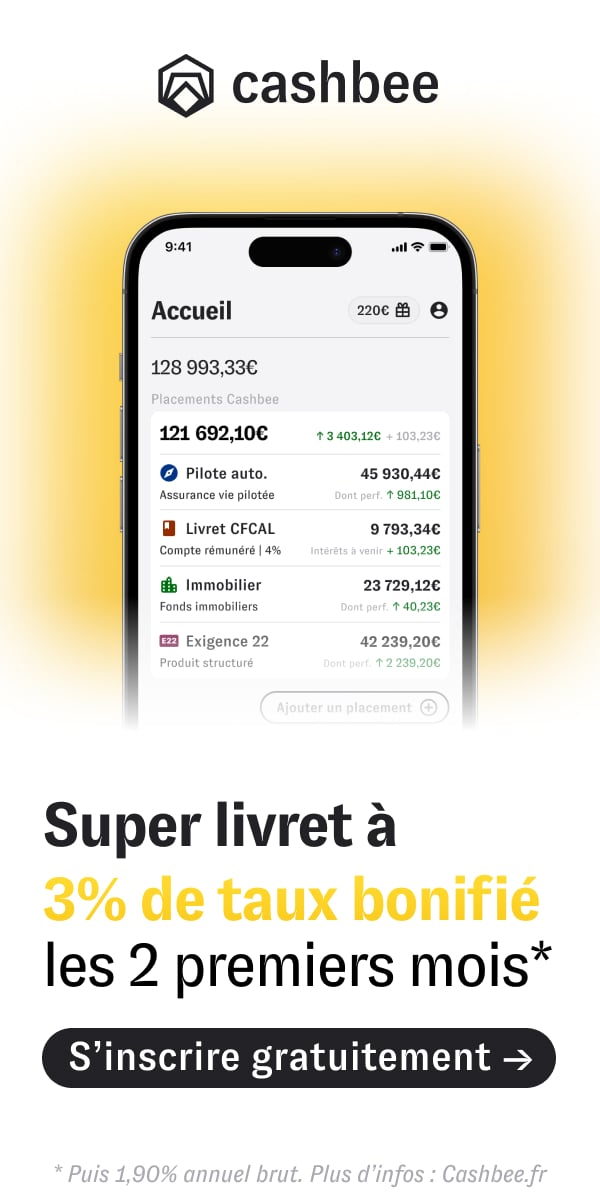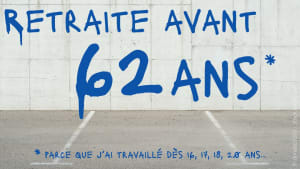Après un conclave sur les retraites qui a laissé les fonctionnaires sur leur faim, le député Liot de la Marne a livré une analyse critique du système de retraite des agents civils et militaires de l'Etat (64 milliards d'euros de pensions versées en 2024), réitérant une proposition de doter le régime d'une caisse autonome.
Cette suggestion intervient après des interrogations sur un prétendu « déficit caché » du système des retraites des fonctionnaires, qui serait masqué par une surcontribution de l'Etat. Cet argument avait pris de l'épaisseur après que l'ancien chef du gouvernement François Bayrou a suggéré que le déficit des retraites pourrait s'avérer plus important que prévu, missionnant la Cour des comptes de faire « la vérité » des chiffres avant son conclave.
Les Sages avaient balayé l'hypothèse du déficit caché soulignant les difficultés de comparer le régime de retraite général et ceux des fonctionnaires dont les règles sont très différentes.
Fin 2023, on dénombrait 1,97 million de fonctionnaires civils ou militaires cotisant pour 2,06 millions de pensions versées, soit un ratio de 0,96 cotisant pour un pensionné : l'illustration d'un régime plus déséquilibré démographiquement que le régime général. Depuis 2006, les retraites des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat (2,5 millions d'agents actifs) sont retracées dans un document budgétaire, le compte d'affectation spécial (CAS) « pension », annexé au projet de loi de finance, qui doit être à l'équilibre.
Mais il s'agit d'une « boîte noire » qui conduit à surestimer certaines dépenses publiques, dénonce Charles de Courson à l'AFP, qui réclame a minima une « plus grande clarté » dans sa présentation.
Quel coût réel ?
Les retraites des fonctionnaires civils et militaires sont alimentées par les retenues sur les salaires des agents, les cotisations d'employeurs publics (comme les collectivités), et surtout par une importante subvention acquittée par l'Etat pour équilibrer le régime : 48,2 milliards d'euros en 2024, en augmentation de 1,8 milliard d'euros par an en moyenne depuis 2020, selon le rapport.
Mais « on englobe beaucoup de choses dans cette contribution » qui « manque beaucoup de transparence », regrette Hélène Paris, secrétaire générale du Conseil d'analyse économique (CAE), et auteure d'une note sur les retraites des fonctionnaires.
En pratique, l'État surcotise pour équilibrer le régime avec un taux de contribution employeur pour les fonctionnaires civils près de 5 fois supérieur au privé où il est d'environ 16%. Pour les militaires, le taux de contribution employeur est de plus de 120%, indique le rapport.
Ces écarts sont notamment le fruit de surcoûts propres au régime de retraite de ces agents, et d'une prise en charge de la compensation démographique insuffisante, estime Charles de Courson.
Parmi les spécificités, les militaires bénéficient de règles particulières concernant les départs anticipés qui pèsent pour 3,6 milliards d'euros sur le régime, tandis que les pensions des anciens fonctionnaires d'Orange (ex France Telecom) et de la Poste représentent 7,3 milliards d'euros par an, avec un ratio d'un cotisant pour plus de cinq retraités, peut-on lire dans le rapport.
Autre illustration, le régime verse 1,7 milliard d'euros au titre des pensions d'invalidités, alors qu'elles sont prises en charge par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) dans le régime général.
Au total, ces surcoûts représentent 26,4 milliards d'euros en 2023, sur quelque 60 milliards d'euros de besoins de financement du régime, qui devraient être « clairement identifiés » et isolés comptablement, selon Charles de Courson. Le cas échéant, pour les fonctionnaires civils, on aboutirait à un taux de cotisation employeur de 41,8% contre 74,28% en 2023, peut-on lire.