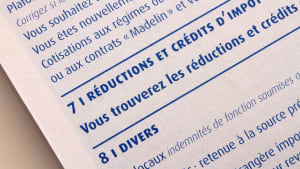Pour aider Caroapero, et répondre aux remarques qui précèdent sur le côté profane ou averti de Caroapero, et de la SCI dans laquelle elle est actionnaire.
La question qui se pose en l’espèce est donc de savoir si la Société civile immobilière a la qualité de professionnel ou non.
Le critère qui est rapidement apparu dans la jurisprudence est celui de l’activité à l’occasion de laquelle la personne morale en cause a souscrit les engagements litigieux. Il s’agit de vérifier si l’opération est conforme à l’objet social de ladite SCI ou si elle a été réalisée dans un but commercial ou professionnel.
S’agissant de déterminer si la SCI peut être considérée comme un emprunteur non-professionnel ou non, il est utile de rappeler que la directive européenne 93/13/CE du 5 avril 1993, en son article 2 – alinéa b, définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.
Ainsi, c’est davantage par référence à la qualité des contractants que la directive a défini les contrats auxquels elle s’applique, considérant que ce critère se justifie au regard du système de protection mis en œuvre par cette même directive dans la mesure où le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel.
À ce titre, il convient de noter que le Droit français, désireux d’assurer un niveau de protection plus élevé des consommateurs, a introduit la notion de non-professionnel, défini comme la personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, par opposition au professionnel qui agit dans le cadre d'une activité habituelle et régulière, condition nécessaire et suffisante à le qualifier ainsi.
La Loi n° 95-96 du 1er février 1995, qui a visé à transposer en droit interne la directive européenne, a maintenu la référence aux "contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs“, le concept de non-professionnel traduisant sa volonté de donner une signification propre à cette notion.
En effet, le professionnel est généralement considéré comme celui qui agit dans la durée pour les besoins de sa profession, c'est-à-dire pour se procurer les ressources nécessaires à son existence, par le biais d'activités organisées dans un but de production, de distribution ou de prestation de services.
Cette notion de professionnel a du reste été clairement définie par la Commission française de refonte du droit de la consommation comme englobant « les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui offrent des biens ou des services dans l'exercice d'une activité habituelle. », précisant en outre s’agissant du non-professionnel que le bien ou le service devait être acquis « pour un usage non professionnel », s’appuyant en ce sens sur les termes utilisés par différents textes protecteurs, comme les dispositions relatives aux opérations de crédit qui ne concernent pas les prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle.
Cette notion d’activité habituelle est notamment reprise dans les termes de l’article L.312-3 du Code de la consommation qui précise que « sont exclus du champ d’application des dispositions relatives au crédit immobilier les prêts destinés sous quelque forme que ce soit à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance. »
Il se déduit ainsi de l’article L.312-3 précité que les personnes morales qui ne procurent pas des immeubles à titre habituel et n’exercent pas d’activité qui s’inscrivent dans la durée, peuvent bénéficier du régime protecteur du Code de la consommation. C’est en effet la régularité et la récurrence de l’activité qui ont vocation à caractériser le côté professionnel de la personne physique ou morale, et non pas sa seule qualité de société civile immobilière.
C’est donc par référence à la qualité de contractant de la SCI de Caroapero, selon que cette dernière a agi ou non dans le cadre de son activité professionnelle, que seront définis les contrats auxquels pourrait s’appliquer la qualification de non-professionnels ou non, ceci afin de déterminer si les actes de prêts litigieux étaient soumis ou non aux règles protectrices du consommateur ou du non-professionnel.
Pour ce faire, il faut demander à la Cour d'appel d'examiner toutes les circonstances de l’espèce en recherchant l’usage qui prédomine et en analysant la cause finale des contrats litigieux, notamment la nature du bien faisant l’objet des offres et contrats de prêts considérés, susceptibles de démontrer à quelle fin ce bien a été acquis (en ce sens : CJUE, 4ième Chambre, 3 sept. 2015 - Costea c/ SC Volksbank România SA, affaire C-110/14).
Ces considérations sont à rapprocher du nouvel alinéa 3 de l’article liminaire du Code de la consommation qui définit désormais le non-professionnel comme toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles (Code de la consommation, article préliminaire, alinéa 3, modifié par la Loi n° 2017-203 du 21 février 2017, article 3, en vigueur depuis le 23 février 2017).
En l’espèce, ce qui importe est l'objet de l’obligation des parties et le but qui les pousse à contracter, et non la personnalité de celui qui s'y engage. À ce titre, dès que l'usage du bien peut être considéré comme étranger à l'activité professionnelle et qu’il s’agit de satisfaire un besoin d’ordre privé, notamment une utilisation familiale, les contrats sont présumés être des contrats de consommation, lesquels sont incontestablement des contrats dont la cause est l’achat dans un but non professionnel.
Ainsi, en l’absence d’activité commerciale, c’est donc le régime de droit commun des sociétés civiles qui sera applicable, sans restriction, ni réserve, sachant qu’en tant que personne morale agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité, celle-ci pourra d’autant plus être considérée comme un non-professionnel ayant conclu un contrat n’ayant aucun rapport direct avec une prétendue activité commerciale.
En ce sens, pour la Cour de cassation, constituent des actes de consommation les prêts souscrits à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, décidant le 22 septembre 2016 (n° 15-18.858, Publié au bulletin) :
« Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses énonciations que le prêt litigieux avait été souscrit à des fins étrangères à l’activité professionnelle de M. et Mme X., la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Enfin, il est utile de préciser que la Cour de cassation a rappelé, le 20 décembre 2007, que la destination professionnelle d’un crédit ne peut résulter que d’une stipulation expresse (Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2007, n° 06-16543, Publié au bulletin).
En espérant que cette analyse vous sera utile.

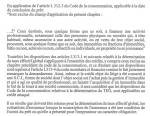
 mais ça démontre au moins l'impartialité des juges sur ce point ... Reste à tomber sur la même composition
mais ça démontre au moins l'impartialité des juges sur ce point ... Reste à tomber sur la même composition  ) : 19.886,40 €, tenant compte de la remise commerciale visée ci-avant
) : 19.886,40 €, tenant compte de la remise commerciale visée ci-avant