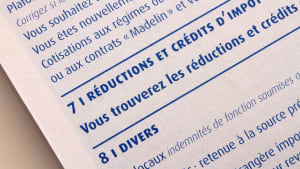Bonsoir Aristide
Avant de vous répondre, je tenais à vous remercier pour l'intelligence et la subtilité de vos posts.
Mon offre de contrat de prêt indiquait clairement "assurance OBLIGATOIRE" : 50% tête Madame / 50% tête Mr"
Or, les magistrats du TGI ont indiqué sur cette offre de prêt : "
Le Tribunal de ne peut déduire des seules propositions versées ("des seules?", non non, j'en ai versé qu'une seule : la seule proposition fournie par le Crédit Agricole
) par la demanderesse que la souscription d'une assurance décès invalidité était une condition nécessaire pour l'octroi du prêt, même si les propositions sont ainsi rédigées" Ah OK Mr le Juge : c'est écrit noir sur blanc, mais ce n'est pas retenu Mr Piaff

du moins, cela ne suffit pas !!!!! Rrrrr !!!!!
Le document "offre prêt" n'a pas été clairement retenu par le TGI : comme si entre temps, le CA m'avait fait de bien meilleures propositions, mais bien sûr !
En faites : le Crédit Agricole (=CA) m'a bel et bien contrainte à souscrire une assurance chez eux. Entre nous, ravie d'avoir obtenu le financement de mon bâtiment commercial, je n'ai même pas à chercher à souscrire ailleurs. A croire que les magistrats n'ont jamais fait de demande de financement pour leur habitation principale ou autre ... Ils ne connaissent ainsi donc pas le poids du déséquilibre significatif entre un particulier (ou même un gérant de SCI) et une banque. Bref il s'agit là d'un autre sujet.
Pour en revenir à mon affaire, bien que cette assurance m'a très clairement été imposée par le CA : ils ont inscrits dans leur contrat prêt 2 mentions : l'une la présentant "Obligatoire" (page 18), puis l'autre "facultative" (page 31 et 44). Le notaire, rédacteur de l'acte de vente a repris l'erreur. En clair, les magistrats du TGI ont simplement retenu l'erreur "
matérielle" (d'ailleurs reconnu par la partie du notaire, ainsi que la partie CA). Mais une petite erreur "matérielle" pour reprendre leurs termes, ne suffit pas. Je cite encore mon jugement : "
Dans ces conditions, la prise en compte de l'ensemble des éléments annexés au contrat de vente notarié et formant un tout indivisible, permet d'analyser pourtant clair et non équivoque de l'acte notarié, comme une erreur matérielle, ce qui est dalleurs expressément admis par la SCP ------" (la SCP ----- étant le cabinet de conseil du notaire).
Aussi, je poursuis la citation de mon jugement (intervenant à la suite de ma 1ère citation) : "
Par ailleurs, la mention précitée relative à la hausse du TEG en cas de tarif majoré s'analyse comme une clause de style qui découle de la mention "assurance obligatoire", laquelle est manifestement une erreur de retranscription de la part du notaire".
"
En conséquence, le coût de l'assurance ADI n'avait pas à être intégré dans le calcul du TEG et la SCI ________ ne démontre donc pas que le TEG est erroné"
Comme vous le constatez : il s'agit là d'une simple erreur, et moi je passe clairement pour une opportuniste de la procédure, bien qu'étant dans mes droits ! De toute façon, j'ai clairement senti le vent tourné sur ces affaires depuis 2 ans ... ça ne va pas dans le bon sens. Je ne fais pas ici qu'allusion qu'à mon cas personnel, mais à l'ensemble des souscripteurs non avertis sur ces sujets : malgré une forte législation en faveur des consommateurs.
Alors sinon, il y a cette ultime phrase dans mon jugement qui me laisse "pantoise" :
"
Aucune défaillance de l'établissement bancaire quand à son obligation d'information n'est prouvée par la SCI _______ qui sera donc déboutée de l'intégralité de ses prétentions"
Moi j'y vois une perche tendue pour mon appel et des pistes, mais mon conseil n'y voit rien ...
Et vous ? comment interprétez-vous cette dernière phrase ?
Bon en clair, j'ai perdu avec un bel article 700 du CPC à ma charge de 2000 euros ! Quand même !!! En relisant les derniers jugement rendus en 1ère instance (sur le site web Doctrine que j'adoooore) : je n'ai jamais vu une telle somme pour un particulier ou une SCI ... Bref, d'où mon attachement à bien travailler la partie en appel ...
D'ailleurs, à la lecture ce matin de cet article :
[lien réservé abonné]
je me dis qu'il n'a pas de raison de prouver clairement le caractère obligatoire de cette assurance
Des pistes de réflexion Messieurs / Dames ??
Bonne soirée et merci par avance de l'intérêt porté à mon affaire
 )!)
)!) )!)
)!)