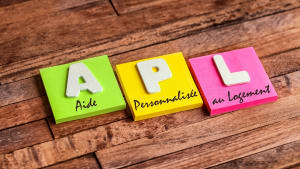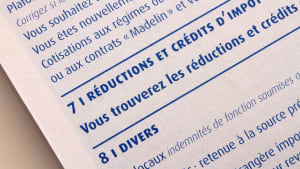Joseph44
Contributeur
Lexicus a dit:Bonjour Valentin600cbr,
Navré que vous n'ayez pas abouti favorablement dans votre action.
La décision de votre Tribunal est, semble t-il, fondée sur l'absence de preuve de l'utilisation d'une année lombarde lors de la phase amortissement.
Très certainement la banque a défendu l'équivalence des intérêts en ayant eu recours au mois normalisé de 30,41666 car selon elle 30/360 = 30,41666/365.
Raisonner sur la période d'amortissement ne permet d'apporter aucune preuve car si l'on doit accepter l'équivalence entre 30/360 = 30,41666/365 jours, il faudrait accepter d'autres équivalences.
Par exemple, pour un prêt de 200 000 € à 4% l'an, les intérêts annuels seraient de :
200 000 X 4% X 30/360 = 666,66 €
200 000 X 4% X 30,416666/365 = 666,66 €
200 000 X 4% X 20/240 = 666,66 €
Cet exemple (certes par l'absurde) démontre que l'argument de la banque n'est qu'une tentative pour dissimuler l'utilisation de l'année lombarde.
La preuve de l'année lombarde ne s'apporte que par un calcul sur les échéance dite "brisées", à savoir sur un mois incomplet. C'est le cas notamment de la 1ère échéance, en cas de remboursement anticipé ou de déchéance du terme.
Je ne comprends pas pourquoi cet argument de l'équivalence est si facilement entendu par les Magistrats. La Cour d'Appel de Paris a rejeté à plusieurs reprises cet argument, notamment dans 3 arrêts du 12 janvier, 27 janvier et 23 mars 2017
Je pense que vous devriez mesurer avec votre avocat l'intérêt de faire Appel (les Cours d'Appel sont souvent plus justes et plus compétentes sur ces sujets du droit bancaire)
Bon courage à vous
En complément, la cour d appel de Paris ( 22 juin 2017, n° 17/01330) a également confirmé la jurisprudence citée par lexicus.
Se pose toujours la question de l interprétation de l arrêt du même jour de la cour de cassation que je ne comprends toujours pas