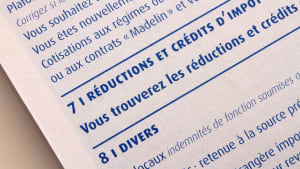Sp4rDa a dit:
En effet, cela va devenir très compliqué de nous défendre face au lobby bancaire.
Toujours est-il que le problème du calcul des intérêts n'a rien à voir avec le calcul du TEG.
Le taux conventionnel sert à déterminer le prix soit les intérêts à payer ce que ne peut faire le TEG.
La Cour veut mettre aux oubliettes la protection des emprunteurs en répondant à côté de la plaque.
Vous lui démontrer que le soleil est jaune et elle vous répond que vous avez tort parce que la lune est grise... Il faut donc trouver un autre moyen de leur prouver que lorsque le taux conventionnel n'est pas correctement appliqué, cela n'a rien rien à voir avec le résultat du TEG.
Nous demandons à la Cour d'observer que le montant du prix à payer à été calculé avec un taux différent de celui qui a été convenu. Lorsque seul la mention du taux conventionnel est exprimé dans le contrat alors il est considéré que celui ci s'appliquera avec la base exact/365 ou 366 et ensuite le mois normalisé. Au surplus, le taux conventionnel et la base de calcul deviennent indissociables grâce à l'annexe de l'article R314-3 du code de la consommation, plutôt clair dans l'explication de l'utilisation de la méthode de calcul.
Or, dès que nous demontrons que le taux n'est pas utilisé avec la bonne base alors la stipulation du taux d'intérêt conventionnel devient nul car comme indiqué ci avant le taux est la base de calcul sont indissociables peu importe que le TEG soit impacté d'une décimale ou non...
L'impact d'une décimale sur le TEG serait admissible si seulement le TEG servait à retrouver le prix à payer, en l'espèce ce n'est pas le cas.
Voilà le fond de ma pensée, en espérant ne pas faire fausse route.
Non, non, vous ne vous trompez pas dans votre raisonnement, et «
vous ne faites pas fausse route » comme vous dites.
Et cela même si les récentes décisions de la Cour de cassation semblent témoigner qu'en ce moment nos Hauts Magistrats ont oublié les principes fondamentaux du droit des contrats et de la rencontre des volontés, entre un consommateur profane qui emprunte et un professionnel du crédit qui lui prête une certaine somme d'argent, moyennant un taux contractuel parfaitement convenu, a priori calculé tout légitimement (et légalement) sur la base d'une année civile.
Avant toutes choses, il y a un principe de base dans une telle transaction :
Les dispositions de l’article L.111-1 (ou L.111-2) du Code de la consommation (en vigueur du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014) prévoient qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de fourniture de services,
le professionnel doit lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du service et le prix de celui-ci en application des articles L.113-3 et L.113-3-1 du même code.
Ces dispositions font écho au droit des contrats, dont la refonte en 2016 à droit constant exprime le fondement :
- La nouvelle rédaction de l’article 1114 du Code civil précise que l’offre doit comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ;
- Celle de l’article 1113 précise que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ;
- Celle de l’article 1163 précise que l’obligation doit être déterminée ou déterminable ;
- Celle de l’article 1162 précise que le contrat qui déroge à l’ordre public par ses stipulations ou son but est invalide.
Aux termes de ces prescriptions,
le taux d’intérêt se présente très certainement comme l'une des caractéristiques principales du contrat en ce qu’il permet de déterminer le prix à payer en contrepartie de la disposition du capital sur la durée convenue.
Il est constant que le contrat de prêt d’argent consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel qui se forme par le simple échange des volontés, ce contrat de prêt à un consommateur se formant en effet par la rencontre formalisée d’une offre et d’une acceptation, par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Ainsi le prix, c’est-à-dire l’intérêt que devra payer l’emprunteur pour la jouissance du capital qu’il s’oblige à restituer, doit être déterminé ou déterminable en application du droit des obligations.
Le taux nominal d’un prêt n’est pas un prix déterminé, mais le mode de détermination du prix, soit le mode de calcul de l’intérêt sur lequel les volontés doivent s’accorder.
À partir de là, on pourrait imaginer que l'établissement financier ait décidé de faire usage de ce que l'on appelle “l'année lombarde“, c'est-à-dire une année bancaire fictive de 360 jours (au lieu de l'année civile attendue), pour calculer les intérêts du prêt, en usant pour cela d'un diviseur 360 pour l'ensemble des mensualités, de la première à la dernière, sans aucune régularisation à un moment ou à un autre. En pareil cas, il va en résulter un surcroît indu d'intérêts (clandestins) prélevés par le prêteur, au détriment de l'emprunteur (en partant du principe que la banque lui a caché cette modalité de calcul).
Il en résultera que si la convention de calcul entre le taux et le prix (1/12 du taux annuel, Exact/Exact, 30/360) n'est pas partagée entre le prêteur et l’emprunteur,
l'accord des volontés sur le prix n'a pas pu se faire : l'intérêt contractuel est donc nul et ne subsistera alors que le taux légal (sur les fondements de l'article 1907 du Code civil).
À partir de ces hypothèses, on va se retrouver dans une situation où diviser le taux annuel par 360 ou par 365 jours ne peut pas aboutir mathématiquement au même résultat.
Un tel mode de calcul impacte nécessairement le taux d'intérêt qui sera dès lors supérieur à celui qui serait calculé sur la base d’une année civile.
Ce qui veut dire que le prêteur a prévu (sans en parler à son co-contractant)
deux modes distincts de calcul, l'un en base Exact/360 en préfinancement et l'autre sur la base du mois normalisé (30,41666/365) en amortissement, ce qui n’est rien d’autre que prévoir deux taux différents sur la durée du crédit : un "taux 360", puis un "taux 365" qui auront "facialement" la même valeur, mais dont l’un - le taux 360 - génèrera plus d’intérêt que l’autre.
L'emprunteur se retrouve dès lors confrontés à deux taux d’intérêt différents pour un même prêt, dont il résulte un taux unique supérieur à celui stipulé au contrat, auquel il n’a pas consenti. En d'autres termes, le taux de l'offre n'est pas celui du contrat.
Quelles conclusions peut-on donc en tirer ?
La fraude au consentement de l'emprunteur sur le prix qu’il s’engage à payer en signant son contrat de prêt est dès lors caractérisée, d’où il se déduit le fait que les volontés n'ont pas pu se rencontrer,
ce qui conduira à considérer que le taux contractuel est intrinsèquement vicié.
La nécessité que le taux d’intérêt soit calculé sur une année civile est
une règle formelle d’ordre public de protection financière des particuliers, mais au-delà, il s’agit d’une règle formelle du droit du contrat de prêt à intérêt : l’unicité du taux avec sa règle de calcul est consubstantielle de l’accord de l’emprunteur sur le prix du capital prêté.
La sanction devrait être la nullité de plein droit de la stipulation conventionnelle d'intérêt, et partant la substitution de l'intérêt légal au taux contractuel initialement prévu entre les parties.
Cette solution emprunte aux mécanismes issus du droit commun, en se fondant sur la seule observation de l’absence de rencontre des volontés, sans se référer, d'une manière ou d'une autre, à la théorie des vices du consentement.
Il sera rappelé que la nullité concerne les conditions de validité d'un acte qui ne sont pas réunies ou qui n'ont jamais été réunies, et
vise donc la formation du contrat et particulièrement sa condition de validité. En pareil cas, elle a un effet rétroactif,
de sorte que la clause litigieuse est considérée comme si elle n'avait jamais existé.