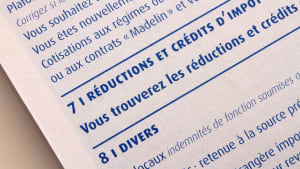Retour (à nouveau) sur l'arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2019
(n° 18-19.097, Publié au bulletin)
Cette décision continue de faire couler beaucoup d'encre, que ce soit ici sur notre Forum, ou de la part d'auteurs avisés dans un certain nombre de publications.
De l'avis de tous, la rédaction de cet arrêt est incompréhensible, ce qui n'est pas à l'honneur de notre Haute Cour qui s'était engagée, lors de sa conférence de presse du 5 avril 2019 (ci-annexé), à «
permettre à chacun de mieux comprendre la décision en mettant davantage en évidence la progression du raisonnement qui a conduit à la solution retenue », expliquant sans ambiguïté «
qu’un arrêt peut être regardé comme bien motivé dès l’instant où sa seule lecture suffit à tout juriste pour en saisir le sens et la portée », l’objectif poursuivi étant «
de permettre un accès au droit plus précis et plus informé. »
Petit à petit, au gré des commentaires des uns et des autres, on commence à y voir un peu plus clair.
Deux auteurs, avocats spécialistes des problématiques des taux, Maîtres Jérémie B. et Jean-Simon M., ont été les premiers à proposer une lecture de l'arrêt en question, à tout le moins leurs différentes interprétations (avouez néanmoins que c'est un comble d'avoir besoin d'un mode d'emploi pour connaître le raisonnement suivi par les Hauts Magistrats pour rendre leur décision !!).
Je vous renvoie à mon post sur le sujet :
Analyses de deux Avocats spécialistes
Par ailleurs, j'ai pu me procurer le Rapport du Conseiller (ci-joint). Celui-ci se contente de disséquer le pourvoi, sans proposer clairement une solution .
Chose curieuse, apparemment l'Avocat général n'a pas pris la peine d'émettre un avis écrit (cet avis ne figure pas sur la page de l'arrêt sur le site “Jurinet“ de la Cour de cassation). Comme il s’agissait d’une FR (formation restreinte), il est tout à fait possible que celui-ci ait siégé avec quelques notes manuscrites (ce qui paraît incroyable pour un arrêt publié !).
Tout laisse à penser que la première Chambre a décidé seule d'abandonner sa jurisprudence de 2013, et de le faire savoir en publiant l'arrêt au Bulletin. Et elle en remet une couche en renvoyant l'affaire devant la même cour d'appel, pour forcer la Cour de Riom à se déjuger : c'est d'une grande perversité.
Une nouvelle publication nous livre son analyse pertinente (ci-joint) : il s'agit d'un article du Recueil DALLOZ, paru le 16 janvier 2020, écrit par deux éminents auteurs, Gérard Biardeaud (Magistrat) et Bérangère Poitrat (Expert judiciaire en mathématiques financières).
Clairement, il s'agit d'une charge violente contre la première chambre, appelant les juges du fond à la résistance. De plus, il me semble que la démonstration mathématique est pour le moins édifiante.
S'il fallait résumer les trois analyses dont je viens de vous faire écho, on peut retenir un certain nombre d'invariants, tirés de ces réflexions de spécialistes :
1) Le surcoût ne serait sanctionné que s’il entraîne un dépassement du taux annoncé d’au moins une décimale ;
le taux à considérer, nonobstant le visa de l’article R. 313-1, est le taux conventionnel, seul directement impacté par le diviseur 360.
2) S’agissant d’un prêt remboursable en plusieurs versements, le calcul du montant des intérêts ne peut s’effectuer qu’
à l’intérieur et en considération d’une période déterminée (par exemple, une échéance brisée correspondant à un mois incomplet, comme la première échéance, par exemple).
Ce qui veut dire que la décimale exigée par la Cour de cassation pour déclencher la substitution du taux légal au taux conventionnel ne peut donc s’apprécier qu’eu égard au rapport entre le surcoût engendré,
pour la période considérée, aux intérêts qui auraient dû être prélevés au titre de ladite période.
3) En effet, la recherche du taux conventionnel effectivement appliqué s’effectue
ligne par ligne, à partir du tableau d’amortissement édité après déblocage total ;
il n’y a pas à calculer l’incidence sur le taux conventionnel du prêt dans son ensemble car le calcul d’une telle incidence, qui fait appel à une méthode spécifique, est réservée au seul calcul du TEG/TAEG.
Comme l'expliquent justement les auteurs Gérard Biardeaud et Bérangère Poitrat, prendre à la lettre cet arrêt du 27 novembre 2019 voudrait dire qu'un taux d'intérêt conventionnel (contractuel) pourrait être faux de plus d'une décimale sur sa première échéance calculée sur 360 jours
que si le taux du prêt excède 7,20 % ! ... Hypothèse totalement absurde puisque depuis bien longtemps déjà les prêts n'atteignent jamais de tels taux. Pour cela, la décision des Hauts Magistrats reste totalement incompréhensible car admettre un possible écart jusqu’à un certain seuil admissible, aurait pour effet de
priver le consommateur d’une protection effective de ses droits, en contradiction avec le droit communautaire.
Il n'en reste pas moins que les emprunteurs ne sont pas tout à fait démunis s'ils ont à diligenter une action contre leur prêteur, dans les cas où celui-ci aura usé d'un diviseur 360 (démontré), entraînant un surcoût (démontré) venant à leur détriment. En effet, l'argumentation pourrait porter sur les points suivants :
-
En considération des règles les plus élémentaires du droit des contrats où les volontés doivent s’accorder, le taux du contrat ne peut qu'être celui de l'offre, peu important la différence de taux (n'importe quel juge ne peut qu'être sensible à un tel argument ; on a vu que l'arrêt de la Cour de cassation ne tient pas la route pour toutes les raisons exposées). En effet, l'emprunteur sera réputé dès lors
n'avoir pas consenti valablement au taux et au coût, ce qui conduira à la nullité relative du contrat, se traduisant par la substitution du taux légal (absence de consentement).
- Le calcul “dit lombard“ induit un surcoût dissimulé qui confère à lui seul, quelle que soit l’importance du surcoût,
un caractère abusif à la clause stipulant un tel calcul (
Recommandation n° 05-02 de la Commission des clauses abusives, BOCCRF 20 sept. 2005) : cette clause est dès lors réputée non écrite, et le taux indiqué, devenu sans pertinence faute de mode d’emploi, suit tout naturellement le sort de la clause qui régissait son application, ce qui conduira le juge à annuler la clause et à substituer l'intérêt au taux légal.
Bref, à bien des égards, cet arrêt du 27 novembre 2019 pose plus de problèmes qu’il n’en résout... :-(