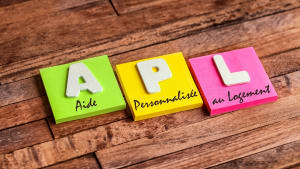agra07 a dit:
Bonsoir,
"Démonstration magistrale" ? Sauf que cette démonstration est faussée sinon fausse.
Pourquoi?
Argument de la banque: l'erreur sur la première échéance (brisée) a une conséquence modique: c'est exact.
Réponse du juge (aidé peut-être par l'argumentation "magistrale" de l'avocat ?): l'erreur est faible sur cette échéance brisée mais elle se répercute sur toutes les échéances suivantes (sous-entendu) ce qui fait que l'erreur finale n'est pas modique: cette réponse, qui sert de motif au juge, est en réalité fausse. Un calcul rapide et simple montre en effet que l'incidence sur chaque échéance suivante est d'environ 0.03€ ce qui représente 6€ sur 200 échéances (je ne me souviens plus du nombre exact d'échéances du prêt). Chacun s'accordera à dire que cette somme reste modique. Donc le juge fonde (partiellement) sa décision sur un faux motif..
Ce n'est pas un avis, ce sont des faits.
Le problème ne vient pas du montant du préjudice, le problème vient de la tromperie et de la duplicité de la banque, qui n'est pas sanctionnée lorsque les juges se mettent en tête de décider en équité et non en droit, au motif fallacieux qu'il y aurait "un effet d'aubaine". Lorsqu'un particulier dépasse un découvert, autorisé ou non, on le facture sans état d'âme, et les frais sont parfois plus importants que le découvert lui-même, et là, pas de souci, c'est normal. Mais si les banques violent sciemment la loi, et que les emprunteurs agissent, là c'est trop méchant ?
Il faut arrêter de se moquer du monde, chaque année, les commissions diverses et variées augmentent, et les banques françaises sont les plus rentables au monde. Et je ne parle pas du scandale du LCL, renfloué par le contribuable français, de la perte de la SG mutualisée via une remise d'impôts (toujours au détriment du contribuable), etc. Bizarrement, quand une banque va mal, le contribuable paye, mais quand elle va bien, seuls les actionnaires empochent...
Donc si on se place sur le même plan "moral" qu'Agra, force est de constater que les banques rackettent littéralement leurs clients (à l'époque actuelle, impossible de ne pas avoir de compte, et la lutte contre l'argent liquide ne fera que renforcer l'emprise qu'ont les banques sur les citoyens) en toute impunité, pour des services de qualité inégale (là, je suis gentil...).
En résumé, la Cour de cassation a posé en principe, interprétant la loi (au sens large) l'interdiction de calculer les intérêts sur 360 jours et la sanction , à savoir la nullité de l'intérêt conventionnel et l’application du taux légal.
De nombreux juges, en réaction à l'importance du contentieux, ont cru pouvoir décider que "les pauvres banques " ont bien besoin d'être défendues contre les vilains emprunteurs qui ont flairé la bonne affaire, et surtout, ont fait preuve d'une grande imagination pour éviter d'avoir trop de travail en décourageant les emprunteurs.
Mais ce n'est pas au juge de faire la loi, la Cour de cassation devant continuer à jouer son rôle d'unification de la jurisprudence, à défaut de quoi c'est la fin de la sécurité juridique et donc le système vire à l’arbitraire (on gagne à Toulouse, on perd à Marseille, etc...).
Et après tout, le véritable responsable est le législateur, incompétent dans la rédaction des lois (souvenez-vous de sa tentative de mettre un terme à ce contentieux, tentative censurée par le Conseil constitutionnel en 2003).
Si les consommateurs doivent se taire et subir, qu'on arrête l'hypocrisie et qu'on rédige une loi, sur la pression des lobbies bancaires, pour en finir avec ces affaires, au moins les choses seront claires.
En attendant, nous verrons si la Cour de cassation résiste à la pression des banques ou pas à l'occasion des recours contre les arrêts d'appel de 2016 (notons qu'il a suffit que la composition de la Chambre 6 du pôle 5 change pour que la jurisprudence change également, contusionnant un conflit entre celle-ci et la chambre 9 du pôle 4).
Pour ma part, il n'y a rien de plus détestable que de constater que l'exercice du droit devient une véritable loterie, entre des lois incompréhensibles, un législateur inconstant, des avocats paupérisés et prêts à se proclamer experts dans ces domaines, des sociétés commerciales peu scrupuleuses allant même jusqu'à mettre en avant l'assurance du remboursement des frais en cas d'échec (avec les suites qu'on connait), et des juges parfois incompétents, parfois paresseux ou dogmatiques, et d'autres parfois courageux et rigoureux, la chance devenant alors un paramètre majeur de l'équation alors que seul l'aléa judiciaire au sens classique du terme est acceptable.
A suivre donc.
Cdt,
Dimitri