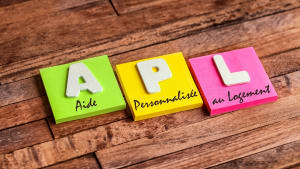Bonjour,
vivien a dit:
Mais vous oubliez que le calcul des intérêts intercalaires se fait sur des années civiles, c'est d'ailleurs ce que précise la Directive 98/7/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998*[1] qui est venue préciser que s’agissant du calcul des intérêts, «*une année compte 365 jours, 365,25 jours ou, pour les années bissextiles, 366 jours"", . Celle-ci a été transposé dans le droit français.
Plusieurs remarques :
1) - La première directive européenne (qui visait les crédits à la consommation et le TAEG) est la 87/102 du 22 décembre 1986 qui comprenait deux annexes "A" et "B"
Elle a été transposée en droit français avec les décrets 2002-927 et 928 du 10 juin 2002.
2) - Seule l'annexe "B" prévoyait la possibilité d'une année de 365,25 jours
3) - Curieusement en droit français c'est l'annexe "dite A" qui a été transposée...........
mais en reprenant les textes et les exemples de l'annexe "B" ???
4) - Les exemples pris qui sont pourtant les mêmes aboutissent à de résultats différents suivant que l'on applique l'annexe "A" ou l'annexe "B"
Exemples avec les mêmes données de départ:
Annexe "A" - Premier exemple => TEG = 12,96%
Annexe "B" - Premier exemple => TEG = 12,92%
=> Pour une directive qui est censée harmoniser les règles européennes et faciliter les comparaisons d'offres de prêts émanant de différents Etats membres l'on peut mesurer la stupidité d'un tel texte !!!
5) - La possibilité de faire un calcul de TEG avec une année de 365,25 jours repose sur l'idée (fausse) que dans la vie d'un crédit il y aura une année sur quatre de 366 jours (et donc 3 années sur 4 de 365 j):
=> ((365j x3) + 366j) / 4 = 365,25 j
Mais ce n'est pas toujours vrai; par exemple dans un prêt sur 5 ans l'année moyenne en jours sera de ((365 x 4) + 366) / 5 = 365,20j......et les exemples sont infinis.
6) - Quelle que soit l'annexe; un mois normalisé est de "365j/12" (affiché 30,416 66j car un nombre de décimales infini est - évidemment - impossible à transcrire dans un texte).
Il est précisé que ce sera toujours 365 jours même pour les années bissextiles
D'autre par il est aussi précisé que l'année est de 12 mois et, avec un nombre de jours de 30,416 66 l'année deviendrait 365/30,416 66 12,00000263...mois => donc supérieur aux 12 mois indiqués.
De plus les exemples 5 bis "A" et "B" ainsi que 5 bis' "A" et "B" utilisent bien l'exposant "365/12" et non pas 30,416 66.
7) - Cette directive a été modifiée et abrogée par la 98/7/CE du 16 février 1998 citée dans le post ci-dessus
Ni les annexes ni les exemples n'on été modifiés; les aménagements ne changent rien sur le fond.
Une dernirez directive sur la prêta à la consommation est la 2008/48 du 23 avril 2008 qui complète les précédentes sur les découverts en compte.
Les annexes de base ne sont pas modifiée mais complétées d'exemples sur lesdits découverts.
Sur le mois normalisé et le "jour normalisé"
Exemple prêt de 100.000€ à 3% avec 10 jours d'intérêts intercalaires
Méthode "exact/exact
Année normale:
+ Intérêts = 100.000€ x 3% /365 x 10 = 82,191......€....arrondi à 82,19€
Année bissextile:
+ Intérêts = 100.000€ x 3% /366 x 10 = 81,967......€....arrondi à 81,97€
Méthode "mois normalisé
Année normale:
+ Intérêts un an = 100.000 x 3% = 3.000€
+ Intérêts un mois normalisé = 3.000€/12 = 250€
+ Intérêt 10 jours = 250€/(365/12) x 10 = 82,191......€....arrondi à 82,19€
Année bissextile si l'on applique le code de la consommation = que des années de 365 jours
+ Intérêts un an = 100.000 x 3% = 3.000€
+ Intérêts un mois normalisé = 3.000€/12 = 250€
+ Intérêt 10 jours = 250€/(365/12) x 10 = 82,191......€....arrondi à 82,19€
Dans la pratique, à ma connaissance, les banques utilisent soit la méthode "exact/exact" soit (à tort) la méthode lombarde.
Mais, quelle que soit la méthode, au niveau du résultat, la différence ne sera sensible que bien au-delà de la tolérance de 0,1%
Cdt