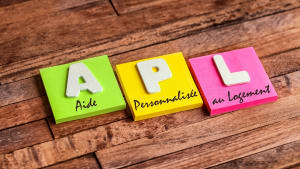thomas6935
Membre
Bonsoir à tous,
Je viens de tomber sur cette discussion très intéressante suite à une recherche effectuée sur Internet afin d'obtenir des explications et des avis à propos du récent jugement concernant mon procès avec ma banque. Pour résumer la situation brièvement, j'ai assigné ma banque en justice en 2015 pour deux erreurs :
- une erreur de forme suite à la stipulation dans les conditions générales de mon offre de prêt de l'usage de l'année lombarde
- une erreur dans le calcul du TEG suite à l'oubli des frais de courtage (erreur estimé à 0.08 par l'expert)
La somme en jeux est 13500 euros
Je viens d'être condamné par le TGI de Lyon a payer 1500 euros. Les raisons évoqués sont les suivantes:
- c'est à l'emprunteur qui évoque l'erreur de démontrer que le taux est erroné dan un proportion supérieur à la décimale prescrite
- le calcul des intérêts mensuels qu'il soit réalisé avec l'année lombarde ou le mois normalisé est le même. Et que donc il n'y a pas d'erreur affectant le taux d’intérêt global ou nominal.Donc pas d'erreur 0 la seconde raison est que
- la simple mention du recours à l'année lombarde ne suffit pas pour demander la nullité ou les déchéances des intérêts. Ce qui est faux d'après la jurisprudence de la cour de cassation.
Il y a un point que je trouve surprenant c'est que le jugement a eu lieu sans la présence des avocats alors que mon cabinet d'avocats parlait de plaidoiries. Est ce que ça été le cas pour vous ? Les motifs de la décision du juge sont presque un copié/collé des conclusions de la partie adverse.
Si je m’arrête ici je limite la casse à 3500 euros. Par contre ce n'est plus le même montant si je fais appel de la décision et que je perds. J'ai lu plusieurs arrêts sur des cas similaires au mien, dont deux de la même cours d'appels (celle de Lyon) et je constate que les jugements divergent en fonction des juridictions, des tribunaux et des juges. Pouvez-vous me donner votre avis sur ma situation par rapport à vos expériences personnelles et/ou des cas similaires sur lesquels vous avez déjà échangé sur le forum ?
Merci à vous
Je viens de tomber sur cette discussion très intéressante suite à une recherche effectuée sur Internet afin d'obtenir des explications et des avis à propos du récent jugement concernant mon procès avec ma banque. Pour résumer la situation brièvement, j'ai assigné ma banque en justice en 2015 pour deux erreurs :
- une erreur de forme suite à la stipulation dans les conditions générales de mon offre de prêt de l'usage de l'année lombarde
- une erreur dans le calcul du TEG suite à l'oubli des frais de courtage (erreur estimé à 0.08 par l'expert)
La somme en jeux est 13500 euros
Je viens d'être condamné par le TGI de Lyon a payer 1500 euros. Les raisons évoqués sont les suivantes:
- c'est à l'emprunteur qui évoque l'erreur de démontrer que le taux est erroné dan un proportion supérieur à la décimale prescrite
- le calcul des intérêts mensuels qu'il soit réalisé avec l'année lombarde ou le mois normalisé est le même. Et que donc il n'y a pas d'erreur affectant le taux d’intérêt global ou nominal.Donc pas d'erreur 0 la seconde raison est que
- la simple mention du recours à l'année lombarde ne suffit pas pour demander la nullité ou les déchéances des intérêts. Ce qui est faux d'après la jurisprudence de la cour de cassation.
Il y a un point que je trouve surprenant c'est que le jugement a eu lieu sans la présence des avocats alors que mon cabinet d'avocats parlait de plaidoiries. Est ce que ça été le cas pour vous ? Les motifs de la décision du juge sont presque un copié/collé des conclusions de la partie adverse.
Si je m’arrête ici je limite la casse à 3500 euros. Par contre ce n'est plus le même montant si je fais appel de la décision et que je perds. J'ai lu plusieurs arrêts sur des cas similaires au mien, dont deux de la même cours d'appels (celle de Lyon) et je constate que les jugements divergent en fonction des juridictions, des tribunaux et des juges. Pouvez-vous me donner votre avis sur ma situation par rapport à vos expériences personnelles et/ou des cas similaires sur lesquels vous avez déjà échangé sur le forum ?
Merci à vous