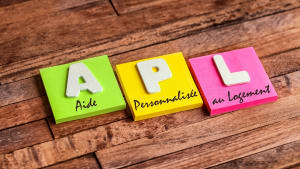Jurisprudence
Contributeur régulier
Contentieux "dit lombard" : comment se positionnent les Hauts Magistrats de la Cour de cassation...
PARTIE II
Le Rapport de l’Avocat Général, Mme Falletti, sous l’arrêt précité du 19 juin 2013, expose clairement que le caractère d’ordre public des dispositions du Code la consommation impose au juge de rechercher, au besoin d’office, si le calcul de l’intérêt conventionnel sur 360 jours selon l’usage bancaire avait été librement convenu entre les parties, et les consommateurs mis à même d’en apprécier l’incidence financière.
En sorte que la Cour de cassation impose de rechercher si l’emprunteur qui souscrit au prêt avait bien conscience des surcoûts générés par un diviseur 360 selon l’usage bancaire, MÊME SI CE N'EST QUE SUR LA SEULE PREMIÈRE ÉCHÉANCE BRISÉE.
Le Rapport de l’Avocat Général précité précise à ce titre qu’il résulte de l’article L.111-1 du Code la consommation que tout professionnel doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service, et qu’en vertu de l’article 1315 du Code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le fait qui a produit l’extinction de celle-ci.
La Cour de cassation a confirmé sa position, le 14 décembre 2016, en précisant que la sanction de la nullité de la stipulation d’intérêts figurant au contrat est fondée sur l’absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt, étant souligné que l'action a été jugée sur les fondements des articles L.313-2 du Code de la consommation et 1907 du Code civil.
EN DEUX MOTS : lorsqu'un emprunteur arrive à démontrer que la banque a utilisé un diviseur 360 sur la première échéance, ce qui n'est pas compliqué puisqu'il s'agit d'une simple règle de trois, il lui suffit d'engager une action en nullité contractuelle, relevant du droit des obligations, en sorte qu'il n'a nul besoin de démontrer une erreur de calcul du taux effectif global, puisque le litige porte en ce cas sur la formation du contrat, et non sur le calcul du TEG pour un contrat valablement formé s’agissant de la stipulation de l’intérêt.
Et c'est précisément ce qu'exprime l'Avocat Général dans l'un des deux pourvois dont la banque s'est désistée (j'ai déjà publié cet avis précédemment). Celui-ci en profite, dans son avis clairement documenté, pour évoquer les arrêts déjà cités du 19 juin 2013 (n° 12-16.651) et du 17 juin 2015 (n° 14-14.326), de portée générale, qui sanctionnent le calcul du taux conventionnel sur une autre base que l'année civile, en sorte que les caractéristiques du crédit importent peu. Il nous indique qu'en effet, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel calculé sur une année civile est vue par la Haute Juridiction comme une condition de validité de la stipulation d'intérêt, visant les lois d'ordre public du Code de la consommation relatives au TEG, combinées avec celles de l'article 1907 - alinéa 2 du Code civil, qui impose la fixation par écrit du taux.
Dans ce même avis, l'Avocat Général poursuit son analyse et précise, sans aucune ambiguïté possible, que les deux arrêts précités répondent à la logique de la solution adoptée en termes d’obligation informative pesant sur l’organisme prêteur, soulignant que la nullité a pour fondement l’absence de consentement des emprunteurs aux intérêts du prêt, si bien que ce consentement fait défaut en cas d'une simple erreur dans la mention du taux, de sorte que seul subsistera l'accord des parties sur le principe de la rémunération du crédit, le taux contractuel ayant été annulé.
L'avis en question nous fait remarquer qu'une présentation conforme à l'année civile, à laquelle songent immanquablement les bénéficiaires du crédit, participe à l'obligation de clarté pesant sur le prêteur qui s'engage sur le contenu du contrat. Le mode de calcul sur 360 jours est illicite par lui-même, de sorte qu’il est frappé de nullité, aucun taux annuel excédant le taux d’intérêt légal n’ayant dès lors été régulièrement stipulé.
POUR RÉSUMER :
De manière constante, la Haute Juridiction considère que le principe de stipulation écrite de l'intérêt conventionnel de l'article 1907 du Code civil ne procède pas d'une règle de preuve, mais d'une formalité substantielle, dont l'irrespect empêche de considérer l'existence d'un accord de volontés sur le montant de l'intérêt, de sorte qu’en l’absence de consentement des emprunteurs à la perception d'un surplus d'intérêts par la banque, le contrat ne s'est pas valablement formé, même si ce surplus, je me répète, ne concerne que la première échéance dont le calcul aurait été fait par la banque en utilisant le diviseur 360 proscrit (voir mon précédent post sur l'utilisation du diviseur 360 pour le calcul des intérêts intercalaires et les conclusions qu'en tire l'Avocat Général).
Dès lors, en matière de recours à l’année lombarde par l'organisme prêteur, une seule sanction est admise, qui consiste en la nullité de la clause mentionnant le taux conventionnel et sa substitution de plein droit par l’intérêt au taux légal à la date d’acceptation de l’offre de prêt, valant contrat entre les parties, et non une responsabilité civile (Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2017, 16-17.802).
En effet, la loi sanctionne l’irrégularité formelle affectant la stipulation d’intérêt conventionnel, sans subordonner la sanction qu’elle édicte à une incidence défavorable pour l’emprunteur, la notion de préjudice n’ayant pas lieu d’entrer en ligne de compte (cela nous renvoie à notre débat sur l'Ordonnance prise par le Gouvernement en matière de TEG, le 17 juillet dernier - voir ci-avant).
Bien à vous.
Chercheur de Jurisprudences
PARTIE II
Le Rapport de l’Avocat Général, Mme Falletti, sous l’arrêt précité du 19 juin 2013, expose clairement que le caractère d’ordre public des dispositions du Code la consommation impose au juge de rechercher, au besoin d’office, si le calcul de l’intérêt conventionnel sur 360 jours selon l’usage bancaire avait été librement convenu entre les parties, et les consommateurs mis à même d’en apprécier l’incidence financière.
En sorte que la Cour de cassation impose de rechercher si l’emprunteur qui souscrit au prêt avait bien conscience des surcoûts générés par un diviseur 360 selon l’usage bancaire, MÊME SI CE N'EST QUE SUR LA SEULE PREMIÈRE ÉCHÉANCE BRISÉE.
Le Rapport de l’Avocat Général précité précise à ce titre qu’il résulte de l’article L.111-1 du Code la consommation que tout professionnel doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service, et qu’en vertu de l’article 1315 du Code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le fait qui a produit l’extinction de celle-ci.
La Cour de cassation a confirmé sa position, le 14 décembre 2016, en précisant que la sanction de la nullité de la stipulation d’intérêts figurant au contrat est fondée sur l’absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt, étant souligné que l'action a été jugée sur les fondements des articles L.313-2 du Code de la consommation et 1907 du Code civil.
EN DEUX MOTS : lorsqu'un emprunteur arrive à démontrer que la banque a utilisé un diviseur 360 sur la première échéance, ce qui n'est pas compliqué puisqu'il s'agit d'une simple règle de trois, il lui suffit d'engager une action en nullité contractuelle, relevant du droit des obligations, en sorte qu'il n'a nul besoin de démontrer une erreur de calcul du taux effectif global, puisque le litige porte en ce cas sur la formation du contrat, et non sur le calcul du TEG pour un contrat valablement formé s’agissant de la stipulation de l’intérêt.
Et c'est précisément ce qu'exprime l'Avocat Général dans l'un des deux pourvois dont la banque s'est désistée (j'ai déjà publié cet avis précédemment). Celui-ci en profite, dans son avis clairement documenté, pour évoquer les arrêts déjà cités du 19 juin 2013 (n° 12-16.651) et du 17 juin 2015 (n° 14-14.326), de portée générale, qui sanctionnent le calcul du taux conventionnel sur une autre base que l'année civile, en sorte que les caractéristiques du crédit importent peu. Il nous indique qu'en effet, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel calculé sur une année civile est vue par la Haute Juridiction comme une condition de validité de la stipulation d'intérêt, visant les lois d'ordre public du Code de la consommation relatives au TEG, combinées avec celles de l'article 1907 - alinéa 2 du Code civil, qui impose la fixation par écrit du taux.
Dans ce même avis, l'Avocat Général poursuit son analyse et précise, sans aucune ambiguïté possible, que les deux arrêts précités répondent à la logique de la solution adoptée en termes d’obligation informative pesant sur l’organisme prêteur, soulignant que la nullité a pour fondement l’absence de consentement des emprunteurs aux intérêts du prêt, si bien que ce consentement fait défaut en cas d'une simple erreur dans la mention du taux, de sorte que seul subsistera l'accord des parties sur le principe de la rémunération du crédit, le taux contractuel ayant été annulé.
L'avis en question nous fait remarquer qu'une présentation conforme à l'année civile, à laquelle songent immanquablement les bénéficiaires du crédit, participe à l'obligation de clarté pesant sur le prêteur qui s'engage sur le contenu du contrat. Le mode de calcul sur 360 jours est illicite par lui-même, de sorte qu’il est frappé de nullité, aucun taux annuel excédant le taux d’intérêt légal n’ayant dès lors été régulièrement stipulé.
POUR RÉSUMER :
De manière constante, la Haute Juridiction considère que le principe de stipulation écrite de l'intérêt conventionnel de l'article 1907 du Code civil ne procède pas d'une règle de preuve, mais d'une formalité substantielle, dont l'irrespect empêche de considérer l'existence d'un accord de volontés sur le montant de l'intérêt, de sorte qu’en l’absence de consentement des emprunteurs à la perception d'un surplus d'intérêts par la banque, le contrat ne s'est pas valablement formé, même si ce surplus, je me répète, ne concerne que la première échéance dont le calcul aurait été fait par la banque en utilisant le diviseur 360 proscrit (voir mon précédent post sur l'utilisation du diviseur 360 pour le calcul des intérêts intercalaires et les conclusions qu'en tire l'Avocat Général).
Dès lors, en matière de recours à l’année lombarde par l'organisme prêteur, une seule sanction est admise, qui consiste en la nullité de la clause mentionnant le taux conventionnel et sa substitution de plein droit par l’intérêt au taux légal à la date d’acceptation de l’offre de prêt, valant contrat entre les parties, et non une responsabilité civile (Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2017, 16-17.802).
En effet, la loi sanctionne l’irrégularité formelle affectant la stipulation d’intérêt conventionnel, sans subordonner la sanction qu’elle édicte à une incidence défavorable pour l’emprunteur, la notion de préjudice n’ayant pas lieu d’entrer en ligne de compte (cela nous renvoie à notre débat sur l'Ordonnance prise par le Gouvernement en matière de TEG, le 17 juillet dernier - voir ci-avant).
Bien à vous.
Chercheur de Jurisprudences