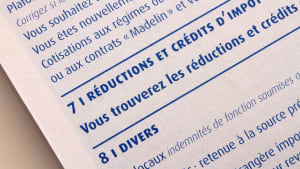Jurisprudence
Contributeur régulier
Éloge de la clarté en droit (de la consommation)
Dans la suite de nos discussions (récentes) sur la bonne information de l'emprunteur par son prêteur, je vous invite à parcourir un intéressant article de Dalloz, renvoyant à un arrêt de la Cour de Justice de l'union européenne du 26 mars 2020.
Pour résumer, et ainsi que je l'ai évoqué ici à plusieurs reprises, le consommateur-emprunteur est en droit de recevoir toutes les informations nécessaires lorsqu'il s'engage en signant son contrat de prêt. Ça vaut pour les taux d'intérêt (taux conventionnel et TEG), induisant également la bonne connaissance de la méthode de calcul opérée par l'établissement financier. Cette connaissance exigeant bien évidemment des informations claires et aisément compréhensibles par le consommateur.
Ainsi, expliquer que la banque calcule les intérêts par référence à une année bancaire de 360 jours (la “fameuse clause lombarde“) n'est pas suffisant pour qu'un emprunteur profane, partie faible au contrat, comprenne facilement l'incidence que pourrait avoir un tel calcul sur le coût de son crédit. Peu important que cette incidence soit faible ou non, il doit comprendre le contrat qu'on lui demande de signer, ceci afin qu'il y ait une réelle rencontre des volontés entre les co-contractants.
En effet, il ressort du commentaire de l'arrêt de la CJUE que « le droit de la consommation, plus que toute autre matière, exige une certaine clarté dans les contrats. »
À ce titre, la Cour rappelle que « l’exigence consistant à mentionner, dans un contrat de crédit établi sur un support papier ou sur un autre support durable, de façon claire et concise, les éléments visés par cette disposition est nécessaire afin que le consommateur soit en mesure de connaître ses droits et ses obligations. »
La Cour rajoute que « la connaissance et une bonne compréhension, par le consommateur, des éléments que doit obligatoirement contenir le contrat de crédit, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE, sont nécessaires à la bonne exécution de ce contrat. »
Dès lors, si vous êtes en contentieux sur une problématique de calcul des intérêts de votre prêt, n'hésitez pas à faire valoir la mauvaise information qui vous a été délivrée par votre prêteur, et notamment que vous n'avez pas pu consentir au taux et au coût de votre crédit, ce qui a contrarié la rencontre des volontés sur le prêt souscrit, valant nullité relative de votre contrat.
Dans la suite de nos discussions (récentes) sur la bonne information de l'emprunteur par son prêteur, je vous invite à parcourir un intéressant article de Dalloz, renvoyant à un arrêt de la Cour de Justice de l'union européenne du 26 mars 2020.
Pour résumer, et ainsi que je l'ai évoqué ici à plusieurs reprises, le consommateur-emprunteur est en droit de recevoir toutes les informations nécessaires lorsqu'il s'engage en signant son contrat de prêt. Ça vaut pour les taux d'intérêt (taux conventionnel et TEG), induisant également la bonne connaissance de la méthode de calcul opérée par l'établissement financier. Cette connaissance exigeant bien évidemment des informations claires et aisément compréhensibles par le consommateur.
Ainsi, expliquer que la banque calcule les intérêts par référence à une année bancaire de 360 jours (la “fameuse clause lombarde“) n'est pas suffisant pour qu'un emprunteur profane, partie faible au contrat, comprenne facilement l'incidence que pourrait avoir un tel calcul sur le coût de son crédit. Peu important que cette incidence soit faible ou non, il doit comprendre le contrat qu'on lui demande de signer, ceci afin qu'il y ait une réelle rencontre des volontés entre les co-contractants.
En effet, il ressort du commentaire de l'arrêt de la CJUE que « le droit de la consommation, plus que toute autre matière, exige une certaine clarté dans les contrats. »
À ce titre, la Cour rappelle que « l’exigence consistant à mentionner, dans un contrat de crédit établi sur un support papier ou sur un autre support durable, de façon claire et concise, les éléments visés par cette disposition est nécessaire afin que le consommateur soit en mesure de connaître ses droits et ses obligations. »
La Cour rajoute que « la connaissance et une bonne compréhension, par le consommateur, des éléments que doit obligatoirement contenir le contrat de crédit, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE, sont nécessaires à la bonne exécution de ce contrat. »
Dès lors, si vous êtes en contentieux sur une problématique de calcul des intérêts de votre prêt, n'hésitez pas à faire valoir la mauvaise information qui vous a été délivrée par votre prêteur, et notamment que vous n'avez pas pu consentir au taux et au coût de votre crédit, ce qui a contrarié la rencontre des volontés sur le prêt souscrit, valant nullité relative de votre contrat.
Pièces jointes
-
La consultation des
pièces jointes est
réservée aux abonnés