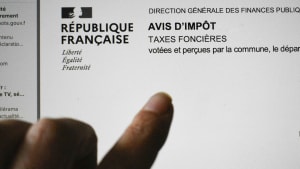Exemple pour le blé :
le potentiel de récolte 2022 est établi pour le Tarn à 46q/ha pour une moyenne nationale de 72q/ha (94q/ha dans l'Eure)
=> Quelle que soit sa pratique culturale et les conditions climatiques, pour une même surface cultivée, un exploitant de notre zone géographique pourra espérer bien moins de chiffres d'affaires que d'autres.
Après calcul, le rendement réel sur l'exploitation a été de 37q/ha cette année. Le blé n'a aimé ni le gel de fin avril ni la canicule de juin ni la sécheresse sur toute la campagne. Par rapport au voisinage, ce n'est pas un mauvais rendement.
Cette page internet est bien représentative pour le blé et il est possible aussi de voir les valeurs pour les autres cultures :
[lien réservé abonné]
Quelle que soit la culture (blé, orge, tournesol, sorgho, maïs, soja), la situation est la même y compris lorsque l'on fait attention à choisir les variétés supposées les plus adaptées à notre zone.
Pour les cultures, les revenus des agriculteurs sont composés :
- des ventes des produits
L'agriculteur ne choisit pas ses prix de vente. Le prix affiché est pour un produit "aux normes" (taux de protéine, humidité, poids spécifique....). Tout écart à la norme entraîne des pénalités sur le prix d'achat. Chaque remorque livrée à la coopérative est analysée pour mesurer tous ces paramètres. Les coûts de transport entre les coopératives de proximité et les silos de départ en gros sont facturés aux agriculteurs.
- des primes PAC incluant le "paiement vert" liées aux bonnes pratiques (environ 15k€ pour une exploitation comme la nôtre)
Pourrait-on augmenter le chiffre d'affaires lié aux cultures ?
* au niveau des primes PAC : NON et ça ne fait que baisser...
* vente des produits : NON
- se passer des coopératives : IMPOSSIBLE car exploitation trop petite (0 poids auprès des acheteurs si passage en direct sans compter que cela nécessite des compétences que nous n'avons pas)
- vendre en direct au consommateur pour mieux valoriser le prix : impossible car tout ne peut se prête pas à la vente directe (ex : sorgho) et que la transformation nécessite souvent beaucoup d'investissement et la commercialisation beaucoup de temps. De plus, le marché local ne peut pas absorber toute la production (ex : c'est facile pour un agriculteur de vendre 1t de blé en sac de farine mais cela lui serait impossible de vendre toute sa production a fortiori si tous ses voisins le font aussi)
- passer des contrats de vente à des prix fixés en avance : possible, impact très limité et beaucoup de risque si le volume promis à la vente n'est pas atteint (pénalité importante)
- produire d'autres cultures : vraiment pas évident et déjà tenté
Beaucoup de cultures ne se prêtent pas au type de sol ou au climat local (pommes de terre, colza, sarrazin ...) donc, déjà, on sème ce qui est censé pousser. De plus, faire une culture "atypique" fait prendre le risque d'avoir un produit invendable (les grossistes ne veulent pas s'embêter à revendre une toute petite quantité de produit).
Il y a 2 ans, un voisin s'est par exemple retrouvé avec sa petite récolte de grains de moutarde sur les bras car pas de transformateur local et pas d'acheteur.
Il y a aussi les contraintes liées à l'obligation de faire des rotations de culture. Il serait impossible de semer chaque année la même récolte sur la même parcelle même si elle rapportait beaucoup au risque de "tuer sa terre" (l'appauvrir) et voir apparaître des maladies ou des plantes envahissantes.
- passer en BIO pour vendre plus cher : fausse bonne idée car le prix d'achat plus élevé ne couvre même pas le différentiel de charge. Cette année, certaines cultures sont achetées au même prix bio ou pas. De plus, certaines récoltes sont invendables car le produit final n'est pas sain (champignons, graines parasites impossibles à trier...)
- stocker pour essayer de vendre "au bon moment" : très incertain et peu d'impact
Pour le moment, le stockage à la ferme ne concerne que les produits (blé, maïs) qui sont ensuite utilisés pour l'alimentation de nos volailles dans l'année ou réutilisés en semence fermière. Le surplus de récolte est vendu au moment de la moisson.
Il serait possible de stocker à la ferme ou de faire stocker à la coopérative et de vendre le produit plus tard dans la saison. Le stockage à la ferme nécessite beaucoup d'investissements (silo, système de ventilation...) impossible à rentabiliser vu la taille de l'exploitation et de frais de fonctionnement (électricité, insecticides...). Faire stocker à l'extérieur a un coût rarement couvert par l'écart de prix entre le moment de la récolte et celui de la vente. De plus, les prix n'augmentent pas forcément sur la saison.
Les principales charges liées au culture sont :
- les semences
- les engrais
- les produits phytosanitaires
- le carburant
- l'entretien des matériels
- les assurances liés au matériel
- l'eau y compris pour l'irrigation
Tous ces postes de dépenses ont subi une très forte augmentation. La plus grosse augmentation étant les engrais (multiplié par 7 en 2 ans).