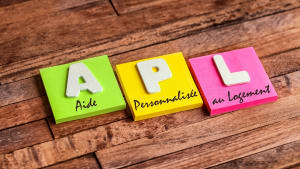Aristide a dit:
Les mathématiques sont une chose; le droit est une autre chose.
Si au, plan du calcul ledit expert a raison, il n'est pas du tout acquis qu'il ait également raison en droit.
Cette situation a été vécue à de nombreuses reprises et y compris dans un autre post sur ce forum.
Cdt
Bonjour,
Je constate que le sujet du "mois normalisé" et de son corollaire concernant l'année à prendre en compte soulève de nombreux échanges, notamment entre "connaisseurs" et participants avisés, ce qui est une très bonne chose.
J'apprécie infiniment le sérieux et le soin qui est apporté à chacune des interventions, et j'en remercie les auteurs.
Il y a quelques posts, j'avais indiqué que je pensais que ce sujet nous amènerait au "cœur d'un vrai débat". J'ai l'impression que je ne me suis pas trompé.
Ce qui m'amène à une réflexion toute personnelle : est-ce normal que l'on soit obligé de "torturer" les textes, ainsi que les calculs pour répondre à toutes nos interrogations ? Ne pourrait-on pas avoir un Droit plus simple et plus fluide, en deux mots mieux accessible au commun des mortels ? Surtout sur un sujet concernant le taux d'intérêt qui, a priori, ne devrait pas poser autant de "problèmes" s'agissant de déterminer le taux ou de calculer les intérêts en nombre de jours exacts (l'informatique le permet), en toute bonne logique. Je suis persuadé que tout bon emprunteur qui signe son offre a l'intime conviction que son banquier lui facture les intérêts selon la réalité du calendrier (exemple : 31 jours en mars rapporté à une année de 366 jours si l'année est bissextile).
Je suis bien incapable de rentrer dans le détail technique de ce débat, n'ayant pas la compétence de certains intervenants ici, mais je pense avoir un peu de bon sens.
Alors je me permets de remettre sur le tapis deux décisions de notre bonne Cour de cassation, dont un arrêt qui a moins de trois mois, par lesquelles la Cour nous renvoie à
la notion d'année civile, qui comme chacun le sait comporte soit 365 jours, soit 366 jours les années bissextiles.
Cette même Cour de cassation allant même jusqu'à
sanctionner la Cour d'appel qui «
n'avait pas recherché si le taux effectif global de chacun des prêts litigieux n'avait pas été calculé en fonction d'un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à la durée de l'année civile ». Pourquoi alors n'avoir pas écrit « … rapporté à une année de 365 jours » ? (
Cass., 15 juin 2016, n° 15-16498 / ci-joint à nouveau).
De la même manière, dans une autre décision, la Cour de cassation relève
l'inexactitude du taux d'intérêt parce qu'il a été appliqué (on parle bien là du calcul des intérêts, c'est-à-dire de l'application du contrat)
sur une base (donc par rapport à, rapporté à) autre que l'année civile. Que je sache, notre Haute juridiction ne parle pas d'une année de 365 jours ou "d'année normalisée", mais bien d'une année civile, c'est-à-dire d'une année qui comporterait 365 jours ou 366 jours les années bissextiles (Cass., 29 novembre 2017, n° 16-17.802 / ci-joint à nouveau).
En ces conditions, qui fait le Droit ? Est-ce
l'Annexe c) de l'article R.313-1 du Code de la consommation, qui apparemment autorise les mois normalisés de 30,41666 jours rapportés à une année qui comporterait toujours 365 jours, ou bien la Cour de cassation qui nous parle d'année civile ?
Pour ma part, en me fondant sur mon seul bon sens, précisant que cela n'engage que moi et mon intuition, je pencherais plutôt sur l'année civile, en d'autres termes pour
une méthode 30,41666 rapportés à 365 ou 366 jours, tout simplement parce qu'il n'y a aucune raison que l'on ne tienne pas compte des années bissextiles. Le tableau que j'ai versé précédemment aux débats nous montre que l'emprunteur a bien été "lésé" de 196,04 euros pour son prêt de 450.000 euros si l'on met en parallèle deux types de méthode, l'une tenant compte précisément des années bissextiles.
Et ainsi, si l'on considère en définitive que c'est la Cour de cassation qui "réoriente" l'interprétation des textes (surtout lorsqu'ils sont aussi peu clairs, la preuve ce débat depuis plusieurs pages), j'ai l'intime conviction que nous pourrions être face à
une quatrième voie, jamais évoquée sur ce Forum, d'une méthode
"NORMALISÉ/EXACT" (pour rappel, les 3 méthodes largement évoquées ici depuis deux ans :
"EXACT/EXACT",
"NORMALISÉ/365" et sa jumelle
"30/360", et enfin lombarde
"EXACT/360", en notant au passage que certains considèrent que la méthode lombarde est la méthode "30/360").
En conclusion,
l'arrêt du 15 juin 2016 me ferait effectivement pencher pour une solution "NORMALISÉ/EXACT", plus conforme à la protection du consommateur (qui ainsi n'est plus privé des années bissextiles), plus proche du simple bon sens et du "vrai" calendrier, et surtout plus proche du concept que c'est bien à l'année civile (365 ou 366 jours) qu'il faut se rapporter, ainsi que la Cour de cassation ne cesse de le répéter depuis le fameux arrêt du 19 juin 2013 («
Attendu qu'en application combinée de ces textes, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile ».
Bien cordialement.
Chercheur de Jurisprudences.
Afficher la pièce jointe Cass_15_juin_2016.pdfAfficher la pièce jointe Cass_29_novembre_2017.pdf