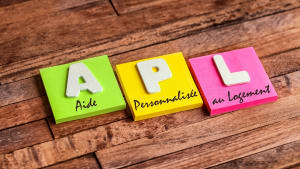agra07
Contributeur régulier
Bonjour,
Je ne pratique pas les textes sur les crédits immobiliers et n'est pas envie de les décortiquer comme le font certains (et je les comprends parfaitement dans la mesure où il s'agit soit de leur métier soit d'une implication judiciaire personnelle).
Ceci étant rappelé, autant je comprends ceci:
Autant, j'ai du mal à adhérer à cela:
Et des jours fictifs ne peuvent s'additionner ou se soustraire à des jours réels.
C'est un peu comme si vous enleviez une carotte à dix tomates; il reste quoi ?
Donc,
Mais au fond, quelle incidence réelle pour l'emprunteur entre un calcul approché avec 4 chiffres après la virgule ou 10 chiffres ou 100 chiffres ? (c'est une question pour les spécialistes équipés en moyen de calcul)
Je ne pratique pas les textes sur les crédits immobiliers et n'est pas envie de les décortiquer comme le font certains (et je les comprends parfaitement dans la mesure où il s'agit soit de leur métier soit d'une implication judiciaire personnelle).
Ceci étant rappelé, autant je comprends ceci:
MRGT34 a dit:Ainsi, la convention du mois normalisé consiste à considérer que la durée de chacun des 12 mois de l'année est de 30 jours normalisés, chacun ayant une durée égale à 365/360=1,0139 jours civils.
Autant, j'ai du mal à adhérer à cela:
Pour moi, les deux propositions ne peuvent se déduire l'une de l'autre car vous raisonnez sur des mois fictifs, donc fait de jours fictifs que vous comparez à des jours réels (civils).Conséquence : si un mois compte 30,41666 jours, le 31ième jour ne peut exister !
Et des jours fictifs ne peuvent s'additionner ou se soustraire à des jours réels.
C'est un peu comme si vous enleviez une carotte à dix tomates; il reste quoi ?

Donc,
Pour moi, en tant que néophyte, au contraire, la suppression des 31ième jours n'est guère compréhensible et un texte serait le bien venu pour légaliser, à défaut d'expliciter, la bonne méthode.Nul besoin de texte pour le déduire.
Là, c'est une évidence. Les moyens de calcul permettent aujourd'hui une plus grande précision.Dernier point de détail : l'écriture 30,416 66 jours renvoie à une notation indiquant qu'en réalité, le nombre 365/12 est un nombre rationnel décimal illimité. Le vrai bon calcul est de poser 365/12 et d'utiliser toutes les décimales permises par l'automate utilisé. L'arrondi ne se fait qu'en fin de calcul.
Mais au fond, quelle incidence réelle pour l'emprunteur entre un calcul approché avec 4 chiffres après la virgule ou 10 chiffres ou 100 chiffres ? (c'est une question pour les spécialistes équipés en moyen de calcul)


 , ni si réellement la jurisprudence a extrapolé l'application de l'Annexe de l'article R.313-1 aux crédits immobiliers comme vous le dites.
, ni si réellement la jurisprudence a extrapolé l'application de l'Annexe de l'article R.313-1 aux crédits immobiliers comme vous le dites.