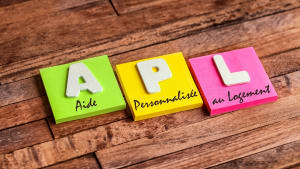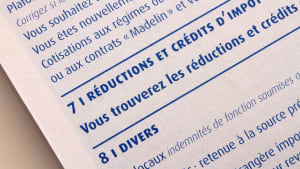Amojito
Membre
L'arrêt du 29 novembre 2017 (ch. com., n°16-17.802, inédit) dit deux choses qui nous intéressent.
Le moyen n°1 ne nous intéresse pas, il parle du devoir de mise en garde
Le second moyen est étudié selon deux branches.
Selon la branche n°4, il est reproché à la Cour d'appel d'avoir prononcé une déchéance (totale, mais ce n'est pas ça qui est important) au lieu d'une (nullité de la stipulation de taux conventionnel avec) substitution au taux légal (la Cour fait un raccourci) "à compter de la date de conclusion du prêt" (logique car les intérêts rémunératoires ne sont dus qu'à compter de la signature du contrat), "les intérêts de retard au taux légal et pénalités demeurant dus" (les intérêts moratoires, l'emprunteur a été assigné en remboursement)
Le plus étonnant est le visa employé : 1134 sur la bonne foi et la loi des parties ... incompréhensible !
L'arrêt est classé "inédit", donc sa portée est toute relative sur ce point, mais dans cet arrêt, la chambre commerciale a bien écarté la déchéance au profit de la nullité.
Ensuite dans le second moyen, étudié dans sa deuxième branche : il est reproché à la Cour d'avoir débuté la sanction à compter de la mise en demeure : "que le compte entre les parties sera recalculé hors intérêts, l'intérêt au taux légal étant dû sur le solde à compter de la mise en demeure".
Il s'agit de la mise en demeure de la banque : voir les faits : "qu'après avoir mis M. X... en demeure de payer des échéances impayées du prêt immobilier, la banque en a prononcé la déchéance du terme, puis lui a délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière "
Cela signifie que la sanction prononcée débutait qu'à compter de la mise en demeure de la banque, soit des années après la conclusion du contrat de prêt.
La Cour de cassation censure naturellement ce jugement car la nullité est rétroactive. Si le taux conventionnel est annulé, il l'est depuis la conclusion du contrat de crédit. La Cour d'appel "aurait dû faire application du taux légal à compter de la date de la conclusion de chacun des prêts garantis".
J'espère avoir été à peu près claire.
Le moyen n°1 ne nous intéresse pas, il parle du devoir de mise en garde
Le second moyen est étudié selon deux branches.
Selon la branche n°4, il est reproché à la Cour d'appel d'avoir prononcé une déchéance (totale, mais ce n'est pas ça qui est important) au lieu d'une (nullité de la stipulation de taux conventionnel avec) substitution au taux légal (la Cour fait un raccourci) "à compter de la date de conclusion du prêt" (logique car les intérêts rémunératoires ne sont dus qu'à compter de la signature du contrat), "les intérêts de retard au taux légal et pénalités demeurant dus" (les intérêts moratoires, l'emprunteur a été assigné en remboursement)
Le plus étonnant est le visa employé : 1134 sur la bonne foi et la loi des parties ... incompréhensible !
L'arrêt est classé "inédit", donc sa portée est toute relative sur ce point, mais dans cet arrêt, la chambre commerciale a bien écarté la déchéance au profit de la nullité.
Ensuite dans le second moyen, étudié dans sa deuxième branche : il est reproché à la Cour d'avoir débuté la sanction à compter de la mise en demeure : "que le compte entre les parties sera recalculé hors intérêts, l'intérêt au taux légal étant dû sur le solde à compter de la mise en demeure".
Il s'agit de la mise en demeure de la banque : voir les faits : "qu'après avoir mis M. X... en demeure de payer des échéances impayées du prêt immobilier, la banque en a prononcé la déchéance du terme, puis lui a délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière "
Cela signifie que la sanction prononcée débutait qu'à compter de la mise en demeure de la banque, soit des années après la conclusion du contrat de prêt.
La Cour de cassation censure naturellement ce jugement car la nullité est rétroactive. Si le taux conventionnel est annulé, il l'est depuis la conclusion du contrat de crédit. La Cour d'appel "aurait dû faire application du taux légal à compter de la date de la conclusion de chacun des prêts garantis".
J'espère avoir été à peu près claire.