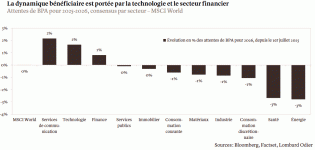MAJ août 2025 (1/2) - Au fait, qui va payer l'addition ?
 Droits de douane entre les États-Unis et l’UE :
Droits de douane entre les États-Unis et l’UE :
L’Union européenne est l’un des derniers de 9 partenaires visés par les menaces tarifaires américaines à signer un accord commercial avec Washington.
L'Europe a plié le genou face à Donald Trump. Un accord qui va renchérir les produits européens, mais qui satisfait le monde financier qui craignait le pire.
Les États-Unis et l'Union européenne se sont mis d'accord pour instaurer un droit de douane de 15% sur la plupart des marchandises expédiées du vieux continent vers les ports américains. Bruxelles s'est aussi engagée à acheter du gaz américain et à investir sur le territoire des États-Unis. En échange… rien. Ce qui relativise l'utilisation de l'expression "se sont mis d'accord".
Difficile de trouver un seul négociateur qui verrait autre chose qu’un rapport de force parfaitement asymétrique.
Les États-Unis ressortent vainqueurs de ce bras de fer, l’Europe perdante.
Le marché a apprécié l’amélioration de la visibilité sur les relations commerciales entre les États-Unis et l’UE, mais il n’en demeure pas moins vrai que le niveau des droits de douane américains a pratiquement été multiplié par 6 par rapport à celui qui prévalait avant le "Jour de la libération" (début avril).
La trêve commerciale entre la Chine et les États-Unis a, rappelons-le, été prolongée juste avant son expiration. Donald Trump a signé un décret suspendant jusqu'au 10 novembre à 12h01 l'entrée en vigueur des droits de douane annoncés plus tôt sur les produits importés de Chine.
Revenons au titre de ce reporting : Qui va payer l'addition ?
Pour les entreprises exportatrices, c’est un coup dur. Elles devront rogner sur leurs marges. Les prix de leurs produits, déjà renchéris par la hausse de l’EUR/USD, vont à nouveau grimper aux États-Unis.
Droits de douane :
La charge ne peut se répartir qu’entre 3 acteurs : les importateurs, les exportateurs et les consommateurs.
Les droits de douane ne peuvent pas être indolores. Soit les entreprises "
mangent les tariffs" pour reprendre une formule de Donald Trump, et dans ce cas les marges diminuent. Soit les consommateurs encaissent le choc, et dans ce cas l’inflation remonte.
Une autre voie qui touche tout le monde est la baisse de la consommation face à la hausse des prix. Ce qui pèsera sur l'activité économique du pays, et donc sur l'emploi.
Qui va payer la facture ?
A ce stade, ce sont plutôt les entreprises qui sont touchées. Selon une étude de Goldman Sachs, jusqu’en juin, les consommateurs n’ont absorbé que 22% des droits de douane. Le reste est réparti entre les entreprises américaines (64%) et étrangères (14%).
Mais les économistes de la banque américaine s’attendent à ce que le partage du fardeau évolue dans les prochains mois. La part payée par les consommateurs devrait atteindre 67% si on suit le schéma des droits de douane précédemment appliqués.
A cette étude de Goldman Sachs basée sur la répartition des droits de douanes, il faut ajouter 2 autres facteurs qui sont, selon les experts du cabinet Simon-Kucher, le recul de la demande causé par la hausse des produits vendus, et la perte de rentabilité des pays exportateurs.
Les experts de Simon-Kucher estiment à 15% la baisse de la demande et une perte de rentabilité (bénéfices) de 38% (marges rognées et ventes en baisse), sur des secteurs très concurrentiels où le prix est le principal facteur de décision.
Ce niveau peut sembler élevé, mais devient crédible dans un contexte inflationniste, où les consommateurs comparent davantage et arbitrent plus rapidement. Même des produits traditionnellement peu sensibles au prix peuvent voir leur demande se contracter.
Sur des secteurs moins concurrentiels, "l'élasticité" est plus faible : Les ventes baisseraient moins (-5,6%), mais les bénéfices reculent malgré tout de 25 %.
L'ampleur des effets dépend aussi du comportement des concurrents. Si les autres exportateurs, comme l'Allemagne, l'Italie, le Japon ou la Corée du Sud, relèvent eux aussi leurs prix en réponse à la hausse des tarifs douaniers, la perte relative de compétitivité est partagée.
À l'inverse, les producteurs américains, non soumis à ces droits, peuvent choisir de stabiliser leurs prix pour gagner des parts de marché… ou de les augmenter à leur tour, en profitant du contexte pour améliorer leurs marges.
Un droit de douane ne se résume donc pas à un simple surcoût logistique. Il modifie profondément les équilibres de prix, de volumes et de marges sur les marchés d'exportation.
Des répercussions sur l'économie ?
Si les consommateurs n’ont payé pour le moment qu’une part faible du surcoût, c’est d’abord parce que les entreprises ont constitué des stocks au début de l’année, et que les hausses de prix arriveront à mesure que ces stocks seront renouvelés.
D’autant que les droits de douane réciproques, dégainés par Donald Trump début avril et plusieurs fois repoussés, sont finalement entrés en vigueur la semaine dernière. Désormais, chaque pays est imposé de 15 à 50%, moins diverses exemptions sectorielles. Selon les estimations de Bloomberg, le taux moyen de droits aux États-Unis est maintenant de 15.2%.
Les économistes s'attendent à ce que l'inflation poursuive sa remontée, à mesure que les droits de douane entrent en vigueur et que les entreprises renouvellent leur stock.
L'inflation :
Au 31 décembre 2024, le tarif douanier moyen s’élevait à 2,5% aux États-Unis. Même maintenu entre 15 et 20%, il reste au moins six fois plus élevé qu’avant. Les investisseurs veulent croire (pour l'instant) que l’économie tiendra.
Aux États-Unis, cependant, l’impact sur l’inflation des droits de douane de Donald Trump est déjà perceptible, note Lazard Frères Gestion.
Les meubles, l’électroménager et les vêtements ont vu leurs prix grimper. Les produits les plus touchés par les taxes sont devenus plus chers pour les entreprises, qui ont choisi de répercuter ce coût sur les consommateurs.
Les récents chiffres laissent penser qu'un retour de l'inflation se profile aux États-Unis.
- L'inflation a été plus forte en juillet, selon de nouvelles données gouvernementales publiées le 12/08/2025
L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,7 % sur une base annuelle en juillet, ce qui est plus lent que les attentes des économistes qui tablaient sur une hausse de 2,8 %.
Expurgé des éléments volatils (alimentation et énergie), la hausse atteint par contre +3.1% contre un consensus de 3.0%.
Les investisseurs ont bien accueilli la nouvelle en ne retenant que le 1er indice tout en ignorant superbement le second indice.
Or, c'est ce second indice, l'IPC Core, que regarde la FED pour décider de sa politique monétaire.
2 jours plus tard, le 14 août, l'indice des prix à la production (PPI) hors ajustements a affiché sur une base annuelle une
hausse de 3,3%, la plus forte depuis février.
D'après le rapport du jour, l'indice américain des prix à la production du mois de juillet a augmenté de 0,9% d'un mois sur l'autre contre 0,2% de consensus. Il grimpe de 3,3% sur un an, contre 2,6% de consensus et 2,3% un mois avant.
Des prix à la production en hausse qui vont alimenter l'inflation aux États-Unis.
La fin des vacances pour Jerome Powell :
Mauvaise nouvelle pour le dollar, et casse-tête pour la Fed. Les tarifs douaniers créent un choc d’offre :
L'inflation et l'emploi risquent d’évoluer en sens contraire. Un scénario bien évidemment pas privilégié par les banquiers centraux. La banque centrale devra arbitrer entre contenir une nouvelle poussée inflationniste et préserver l’emploi.

La semaine s'achèvera avec le symposium de Jackson Hole, dans le Wyoming, organisé par la Fed. Une sorte de séminaire de rentrée pour les banquiers centraux. La prise de parole de Jerome Powell sera particulièrement attendue.
Tant que le président Trump aura le contrôle total, c'est-à-dire du Sénat, de la Chambre des représentants et de la Cour suprême, l'environnement politique restera volatil. Il y a peu de chances de stabilisation avant les élections de mi-mandat de novembre 2026. Pour les entreprises, cela se traduit par un report des investissements et un ralentissement des recrutements.
Et les marchés dans tout ça ?
Le S&P 500 a gagné près de 30% depuis son plus bas d’avril, lorsque les inquiétudes liées à la politique commerciale américaine étaient à leur summum.
Le sentiment du marché a aussi été soutenu par la poursuite des investissements des géants technologiques dans l’IA.
Les actions sont très chères et les signes d’euphorie se multiplient. La hausse se poursuit car les mauvaises surprises sont en vacances.
Attention, la rentrée pourrait les voir revenir sur le devant de la scène et provoquer beaucoup de volatilité.
Même un chiffre d'inflation plus élevé qu'attendu aux États-Unis n'a pas entamé la confiance des investisseurs quant à une baisse de taux de la Fed en septembre. Ils risquent d'être déçus !
Ce retour de l’inflation arrive dans un moment délicat pour l’économie. Les salaires n’augmentent pas au même rythme, et le pouvoir d’achat commence à baisser. La guerre commerciale voulue par Trump, censée protéger l’économie américaine, commence à peser sur le portefeuille des Américains.
Du côté de la demande intérieure, la croissance américaine "
semble beaucoup plus faible, à l'instar de la zone euro, dans un contexte de faible confiance des consommateurs et des entreprises", fait remarquer Allianz Trade, qui table sur une montée de l'inflation américaine à près de 4% d'ici fin 2025 et sur un ralentissement de la croissance.
Les dernières décisions tarifaires de Donald Trump portent le taux tarifaire mondial moyen des États-Unis à 15,2%. Le taux de droits de douane le plus élevé depuis la Grande dépression.
Dans ces conditions, il faut se préparer à la volatilité des marchés.
L’impact des droits de douane se fera davantage sentir à partir du troisième trimestre.
Le positionnement des investisseurs sur les actions s’est accru, surtout du côté des particuliers…. Ce qui est une très mauvaise nouvelle (c'est souvent un signal de vente).
Vu les anticipations de ralentissement de la croissance économique et de volatilité boursière accrue, un allègement des portefeuilles prend du sens.