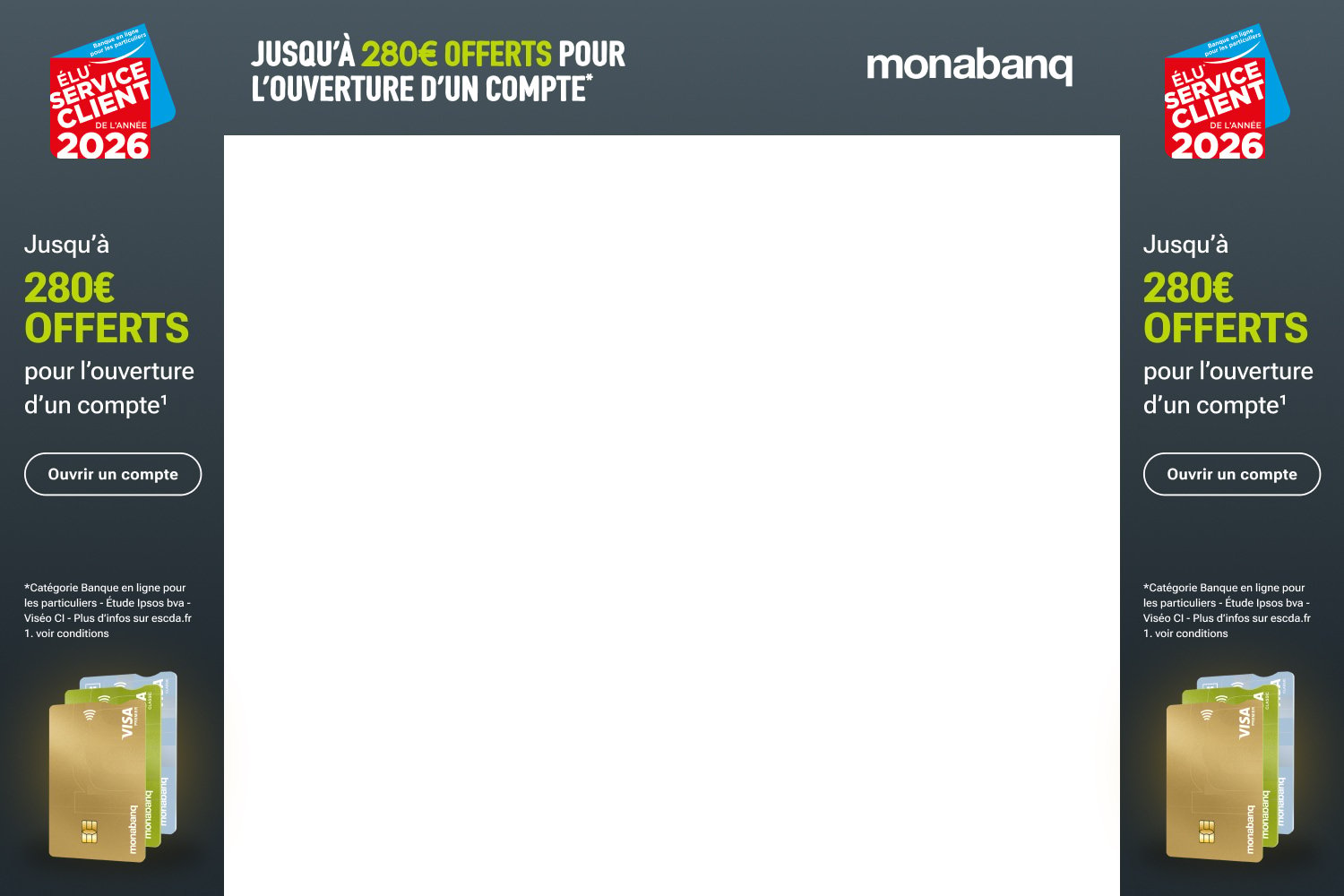Dans l'univers des paiements, le futur porte très souvent le poids du passé. Julien Maldonato, associé chez Deloitte et spécialiste du sujet, le rappelle : « On vit encore avec des protocoles inventés il y a quarante ans, avant Internet. Ce sont des systèmes robustes, mais rigides. » Car derrière chaque achat, chaque virement effectués aujourd'hui, se cachent encore les circuits interbancaires conçus dans les années 1970 notamment pour la carte bancaire, bien avant le numérique grand public.
Mais une révolution pourrait bien être en marche. Pour Julien Maldonato, la grande rupture a eu lieu en 2009, avec l'apparition du bitcoin. « Pour la première fois, on a fusionné la communication et la tenue de compte. C'est un réseau et un registre à la fois : il permet de graver directement sur internet l'histoire d'une transaction. »
Autrement dit, la blockchain a effacé la frontière entre le message de paiement et l'écriture comptable. Dans le système bancaire classique, ces deux opérations sont distinctes : lorsqu'un paiement est effectué, un premier réseau – celui de la « messagerie interbancaire » (Visa, Mastercard, SEPA...) – transmet l'ordre de transfert entre banques. Puis, dans un second temps, chaque établissement ajuste ses propres écritures internes, débitant le compte de l'un et créditant celui de l'autre. Deux mondes séparés, deux acteurs différents, et un intermédiaire obligé pour garantir la confiance.
Une révolution qui prend du temps
Avec la blockchain, ces étapes fusionnent en une seule. Chaque transaction, une fois validée, est simultanément transmise et enregistrée dans un registre public partagé, accessible à tous les participants du réseau. Il n'existe plus de « tiers de confiance » chargé de vérifier ou de comptabiliser : le réseau devient lui-même le tiers de confiance.
Cette architecture distribue la fonction comptable entre des milliers de nœuds informatiques, qui valident collectivement l'opération et la gravent dans la mémoire du système. Une rupture majeure dans l'histoire des paiements : le paiement et sa preuve deviennent indissociables. Il n'y a plus un ordre d'un côté et une écriture de l'autre, mais un seul acte numérique, définitif et infalsifiable.
Mais cette révolution reste encore très théorique. Les systèmes bancaires existants sont lourds, coûteux et profondément intégrés à l'économie mondiale. « On va vers les stablecoins, mais les réseaux existants ne sont pas prêts d'être complètement débranchés », résume Julien Maldonato.
Les stablecoins, ces jetons numériques adossés à des devises classiques comme l'euro ou le dollar, et d'autres formes de « monnaie jetonisée » seraient pourtant l'étape suivante : une monnaie électronique moderne, échangeable instantanément, sans passer par les circuits monétiques traditionnels.
Des « paiements crypto » encore très difficiles
Jean Meyer, cofondateur de la fintech Deblock, qui propose un compte courant en euros associé à un portefeuille crypto intégré, partage cette vision mais rappelle que les obstacles sont encore considérables. Pour lui, les freins à une adoption de masse sont d'abord technologiques et fiscaux. Sur le plan technique, le constat est sans appel. « Une transaction bitcoin prend en moyenne 45 minutes. Attendre trois quarts d'heure pour payer un café, c'est compliqué ».
Même le réseau Lightning, censé accélérer les échanges, peine à convaincre : il nécessite que les deux parties soient connectées au même moment, rendant impossible tout paiement hors ligne. D'autres blockchains, comme ethereum ou solana, offrent des transactions plus rapides – quelques secondes dans le meilleur des cas – mais restent encore bien moins fluides qu'un Apple Pay ou une carte sans contact.
À ces contraintes techniques s'ajoute une question plus fondamentale : la fiscalité. Car même si le règlement européen MiCA, entré en vigueur en 2024, reconnaît les stablecoins régulés comme de la monnaie électronique, la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) n'a toujours pas clarifié leur statut fiscal. « On navigue en zone grise. Tant que la DGFIP ne s'est pas prononcée, les échanges de jetons stables peuvent déclencher une imposition sur la plus-value », déplore Jean Meyer. En clair, convertir du bitcoin ou de l'ether en stablecoin, puis régler un achat avec ces fonds, peut théoriquement être assimilé à une cession d'actifs et donc être taxable.
« Pour les paiements internationaux, les stablecoins surpassent largement les systèmes actuels »
L'entrepreneur en profite pour démonter un mythe : celui des « cartes crypto ». « La plupart de ces cartes vendent vos bitcoins ou autres actifs numériques contre des euros, en prenant environ 2% de frais au passage. Vous croyez payer en crypto, mais en réalité, vous payez en euros, et vous déclenchez un événement taxable. »
Si le paiement du quotidien n'est pas encore à la portée des blockchains, d'autres usages progressent à grande vitesse. Pour les transactions internationales, par exemple, les stablecoins représentent déjà une alternative crédible : en quelques secondes, un freelance au Pérou peut être payé par un client européen sans passer par le labyrinthe des transferts bancaires. « Pour les paiements internationaux, les stablecoins surpassent largement les systèmes actuels. C'est plus rapide, moins cher et totalement transparent », assure Jean Meyer.
Une adoption qui peine à se concrétiser
Les règlements interbancaires suivent la même voie : le réseau SWIFT, pilier des paiements mondiaux, expérimente déjà la tokenisation de ses flux. Cette transformation silencieuse, plus industrielle que visible, pourrait marquer le vrai tournant vers des paiements « natifs Internet ».
Julien Maldonato y voit aussi une opportunité pour l'Europe, souvent perçue comme en retard sur les crypto-actifs. « Nous allons prendre de l'avance sur la manipulation des wallets cryptographiques : identité numérique, passeports produits... Tout cela prépare les citoyens à l'usage des jetons. » L'Union européenne pousse en effet à l'adoption de portefeuilles numériques sécurisés, qui hébergeront demain aussi bien la carte d'identité que des « euros tokenisés ». Un apprentissage collectif, qui pourrait rendre la transition plus naturelle le jour où la frontière entre monnaie fiat et stablecoin s'effacera.
Pour autant, ni Julien Maldonato ni Jean Meyer ne croient à un basculement rapide. L'un évoque « une hybridation durable » dans laquelle cartes, virements, cryptos et cash coexisteront longtemps. L'autre prédit une lente adoption comparable à celle d'Internet : « Entre les premiers tests dans les années 70 et l'usage grand public, il s'est écoulé trente ans. Pour la blockchain, on n'en a que quinze. »
Le grand public, lui, ne verra sans doute pas la différence. Demain, les salaires pourraient être versés en euros « tokenisés », les paiements circuler via une blockchain, mais l'expérience restera la même : un clic, une transaction, un solde mis à jour. « On parlera encore d'euros, mais derrière, ce seront des euros « tokenisés ». Le grand public n'en aura même plus conscience », résume Julien Maldonato.
Derrière la promesse d'une révolution, se dessine donc un changement de couche plutôt que de monnaie : un passage progressif de l'Internet bancaire à l'Internet des paiements, ou de l'internet 1.0 à celui du 3.0. Le jour où nous paierons tous « en crypto », nous ne le saurons peut-être même pas.