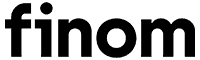Aristide a dit:
en regardant les exemples tant du JO des Communautées Européennes que le JO République française concernés, j'avais bien vu ces nuances de calculs en fonction des dates des flux en cause.
Mais je reste toujours interrogatif sur ces textes:
"B) - Calcul du taux annuel effectif global sur la base d'une année standard (un an = 365 jours ou 365,25 jours ou 52 semaines ou 12 mois normalisés)
"d" des Remarques :"L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fraction d'années.
Une année compte 365 jours ou, pour les années bissextiles 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés.
Un mois normalisé compte 30,41666 jours ( c'est à dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non."
Dans les applications pratiques, comment interpretez vous cette "série de OU" ?
Indique t-elle que la prêteur a le libre choix d'utiliser
+ ou 365 jours
+ ou 365,25 jours
+ ou 52 semaines
+ ou 12 mois normalisés
Si non, pour un calcul de TEG à partir d'une série de flux considérés, en fonction de quelles régles une de ces propostiions serait-elle à utiliser plutôt qu'une autre ?
Bien cordialement,
@Aristide
C’est avec beaucoup d’humilité que je tente de contribuer au questionnement que vous avez formulé sur un point déjà esquissé ici.
Tout d’abord, les vérifications opérées sur la feuille de calcul mise en ligne m’amènent à constater que vous avez raison de dire que l’actualisation annuelle des paiements (calcul du TAEG au moyen de la fonction TRI.PAIEMENTS d’Excel) n’aboutit pas exactement au même résultat que celui induit par les mathématiques à partir d’une périodicité différente (mensuelle au cas d’espèce).
La différence semble provenir :
• D’une part, du fait que le nombre de jours contenu dans une période mensuelle varie d’un mois sur l’autre et il en va par conséquent de même du calcul d’actualisation sur le nombre de jours séparant le paiement considéré du terme annuel.
• D’autre part, cette fonction informatique actualise sur une période de 365 jours sans tenir compte (semble t’il) des années bissextiles, cas de l’année 2012 comprise dans l’échéancier que vous avez produit.
Mais, plus en profondeur, votre questionnement révèle aussi une différence d’approche entre la pratique courante et d’autres lectures, peut être un peu rapidement écartées.
Vous vous demandez pourquoi l’application réglementaire de la Directive européenne fixe un mois « normalisé » comportant 30,4141666 jours et vous le faites à raison si cette précision n’a aucune incidence sur le résultat du calcul auquel vous procédez.
J’espère ne pas trahir votre pensée en rappelant que, dans votre conception du TEG proportionnel, vous estimez que « la plus petite période de calcul » étant d’un mois, tout règlement opéré à l’intérieur de cette période serait ramené (fictivement) au premier jour de celle-ci.
Ainsi, pour des mensualités constantes versées au 1er de chaque mois, un règlement exceptionnel (frais annuels de cotisation d’assurance incendie ou d’avertissement aux cautions, par exemple) intervenant au 15 d’un mois considéré amènerait à placer ce paiement au 1er jour de celui-ci, date des autres prélèvements.
Cette manière de faire est
préjudiciable à la banque comme reporter l’effet du règlement au dernier jour de la période le serait à l’emprunteur, l’actualisation du paiement particulier conduisant à un chiffrage trop important dans le premier cas et trop faible dans le second.
Dans ce cas, le TEG ne répondrait plus à « l’
effectivité » à laquelle il doit satisfaire.
Il existe donc bien une difficulté, une contrariété apparente.
Pour tenter de la résoudre, je propose à votre examen l’hypothèse suivante :
La notion de « plus petit intervalle de calcul » s’entendrait de celle qui permet de calculer le taux de période infra-annuel, la base de calcul de tout autre crédit que celui de consommation courante.
Pour un crédit remboursable à termes constants au 1er de chaque mois, nous raisonnons alors en quelque sorte en « base 12 », c'est-à-dire en considérant 12 périodes indistinctes dans l’année.
Pour actualiser un paiement « e » de rang « 2 » au taux de période (mensuel) de « i », nous avons :
A1 = e*(1+i)^-2
Si un paiement « p » intervient le 15 du même mois, supposé de 30 jours, son actualisation résultera de la formule :
A2 = p*(1+i)^-2,5
L’unité de mesure – la période d’un mois – ne prohiberait donc pas la prise en considération à bonne date de chacun des paiements, interprétation qui donnerait alors sens à la précision réglementaire.
Mais ce n’est pas ainsi que pratique la communauté bancaire, nous avez-vous dit, et la fonction informatique que vous utilisez (fonction « TRI » d’excel) est la traduction de ce constat puisqu’elle ne tient pas compte des dates de versements mais seulement de périodes réputées constantes.
Pourtant, l’interprétation préconisée semble bien donner un éclairage cohérent au corpus de règles et le calcul du TEG gagne ainsi à la fois en précision et en équité.
C’est pourquoi il semble préférable de doubler l’affichage informatique par un calcul des flux actualisés répondant à l’équation de base « Prêt = somme des flux actualisés » pour mieux percevoir l’impact des entrées de données.
Enfin, vous me demandez comment peut s’interpréter la série de « OU » trouvée en annexe à la Directive Européenne quand elle pose notamment : « un an = 365 jours ou 365,25 jours ».
S’il existe bien un choix, c
e n’est pas celui du prêteur mais celui de l’Etat membre de l’Union.
La France a choisi de considérer que l’année (de calcul) comporterait 365 jours « que l’année (calendaire) soit bissextile ou non », comme le précise le texte d’application interne.
Mais la norme juridique n’a pas toujours été respectée dans sa traduction calculée.
Et c’est alors que se trouve soulignée l’imperfection des applications informatiques internationales (anglo-saxonnes) qui pourraient ou non tenir compte des années bissextiles ou considérer que l’année comporte 365,25 jours par le choix d’une option également offerte par la même Directive.
En clair, cela aboutit à une
« référence circulaire non résolue » et, donc, à la nécessité d’une harmonisation plus complète des pratiques intra-communautaires pour la résoudre.
Convenons donc que préciser le nombre de jours contenus dans un mois normalisé n’aurait aucun sens si la position de ces jours dans la période minimale de calcul ne devait pas être utilisée pour obtenir une actualisation précise du paiement.
Voici pourquoi, tout en constatant avec vous que l’affirmation n’est pas rigoureusement exacte et donc scientifiquement satisfaisante, alors même que les chiffrages obtenus seraient légèrement discordants en raison de mois comportant un nombre de jours différents, on peut dire que le TEG et le TAEG relèvent d’un même principe de calcul (actualisation des flux) dont les résultats se différencient, pour l’essentiel au moins, par une modalité d’affichage annuel.
J’espère que la complexité du développement ne nuira pas à son intelligence, avançant en guise d’excuses qu’il découle de la qualité de votre question.
Votre bien dévoué Avocatlex.