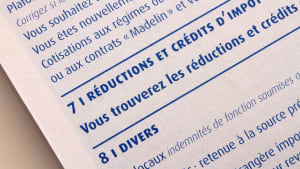agra07 a dit:
Bonjour,
Pour ma part, ce serait plutôt désespérant, certaines Cours d'appel jugeant qu'un surcoût de 10€ crée un "déséquilibre significatif" et d'autres non. On repartirait dans la plus grande confusion jurisprudentielle.
Sauf cas très exceptionnel (et probablement impossible) le surcoût lié à un calcul lombard ne crée pas de "déséquilibre significatif".
Encore faudrait-il s'accorder sur la notion de "déséquilibre significatif". Une approche simple consiste à considérer que le déséquilibre est significatif dès lors que l'emprunteur n'aurait pas contracté si ce déséquilibre caché avait été connu de lui.
Une fois de plus, et combien de fois avons-nous échangé sur ce point, vous confondez la notion de préjudice (peu importe son montant) et
sanction d'un mauvais comportement d'un prêteur qui aura sciemment caché une modalité de calcul dont l'emprunteur n'a pas été averti, de sorte qu'il n'a pas pu donner un consentement libre et éclairé.
Dans pareille affaire, et la CJUE est formelle sur ce point, ce n'est pas à l'emprunteur de démontrer qu'il n'aurait pas contracté s'il avait été informé d'un éventuel surcoût, mais à la banque de prouver qu'elle a apporté toutes les informations utiles.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur «
[…] l’idée […] que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel, en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci […] » (citation tirée de l’affaire C-147/16, Karel de Grote, point 54 - 17 mai 2018 ; voir également, en ce sens, arrêt Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C-484/08, point 27).
Ainsi, s’agissant de l'article 5 de la directive 93/13, la Cour de justice de l’Union européenne a souligné à plusieurs reprises
l’importance de la transparence des informations fournies par les professionnels pour que les consommateurs puissent comprendre l’étendue de leurs droits et obligations en vertu du contrat avant d’être liés par celui-ci, en rappelant que : «
[…] il est de jurisprudence constante que l’information, avant la conclusion d’un contrat, sur les clauses contractuelles et les conséquences de ladite conclusion, est, pour un consommateur, d’une importance fondamentale. C’est, notamment, sur la base de cette information que ce dernier décide s’il souhaite se lier par les conditions rédigées préalablement par le professionnel […] » (Renvoi aux affaires C-92/11, RWE Vertrieb, 21 mars 2013, point 44, et C-154/15, C-307/15, C-308/15, Gutiérrez Naranjo et autres, 21 décembre 2016, point 50).
Il sera précisé que les clauses dont le contenu ne peut pas être influencé par les consommateurs incluent, en particulier, celles figurant dans l
es contrats dits « d’adhésion », c’est-à-dire les contrats qu’ils peuvent seulement accepter ou refuser dans leur ensemble, de sorte que leur marge de manœuvre se limite à contracter ou ne pas contracter avec le professionnel.
La notion de « contrat d’adhésion » est, par ailleurs, intimement liée à celle de « conditions générales », à savoir les clauses standards pré-rédigées qu’un professionnel utilise de manière systématique dans ses relations d’affaires avec les consommateurs afin de rationaliser ses coûts.
En outre, si le premier alinéa de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 93/13 tend à indiquer qu’une clause pré-rédigée doit « toujours » (c’est-à-dire nécessairement) être considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle,
son troisième alinéa laisse toutefois au professionnel la possibilité de démontrer qu’une clause standardisée (par hypothèse préalablement rédigée) a fait l’objet d’une négociation individuelle.
Dès lors qu'il n'est pas satisfait aux exigences de transparence applicables aux professionnels qui ont recours à des clauses contractuelles non négociées individuellement, la Cour de justice de l'Union européenne considère que
ce non-respect constitue un élément d’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle donnée (en ce sens, affaire C-472/10, Invitel, point 1 du dispositif et points 30 et 31 - 26 avril 2012 ; ou encore, affaire C-226/12, Constructora Principado, point 27 - 16 janvier 2014), et peut même indiquer un caractère abusif (affaire C-191/15, Verein für Konsumenteninformation c/Amazon, point 2 du dispositif et points 65 et 71 - 28 juillet 2016).
En ce sens, pour la Cour de justice de l'Union européenne, le critère à retenir pour définir l’absence de bonne foi, liée au déséquilibre significatif existant entre les droits et obligations créé par une clause contractuelle peu claire (notamment lorsque les explications nécessaires à sa compréhension ne sont pas fournies),
consiste à vérifier si « le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le consommateur accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle » (voir notamment arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11, point 69 ; ou encore, arrêt du 20 septembre 2017, C-186/16, Andriciuc, point 57).
La clause litigieuse (dite “clause lombarde“), relative à une période ne correspondant pas à un mois complet, revêt un caractère abusif en ce qu'elle crée au détriment des emprunteurs «
un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » au sens de l’article L.132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige.
 ) en avance de phase n'est pas très judicieux
) en avance de phase n'est pas très judicieux