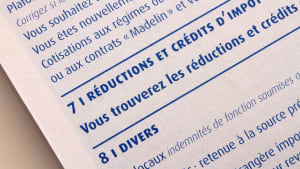MRGT34 a dit:
c'est bien cela qui vous perdra, car sans considération de ce point capital, gare à un revirement sévère de doctrine.
Mais NON, il n'y aura pas de revirement de la doctrine, sinon ce serait déjà fait ! Ce qui précède, dans mes propos, traite d'avis et d'analyses qui datent de novembre et décembre 2017... il y a 5-6 mois, et à six reprises déjà, la Haute Juridiction a jugé selon le
DROIT DES CONTRATS ET DES NULLITÉS (en 2013, 2015, 2016).
On se fout des calculs, ce qui compte c'est de savoir
si l'emprunteur avait conscience de payer un surcoût (le juge est obligé de faire cette recherche), même s'il s'agit d'un surcoût minime d'intérêts de la première échéance de son prêt, lorsqu'il a signé son offre de prêt (devenu donc contrat entre les parties).
Si c'est non, alors
le contrat ne s'est pas valablement formé. Car, dans un contrat de prêt, il y a deux
aspects : l'emprunteur signe d'une part pour un taux contractuel défini et, d'autre part, signe pour que la banque perçoive sa rémunération selon ce taux.
Si ce taux s'avère erroné, ne serait-ce que parce que la première échéance est fausse (ce qui, au passage, déséquilibre tout le tableau d'amortissement), de plus que ce diviseur 360 sur la première échéance laisse penser que toutes les échéances sont calculées selon un ratio 30/360 (car il est peu probable qu'un même échéancier comporte plusieurs méthodes de calculs, ce serait un non sens), alors le taux contractuel est annulé, et
seul subsistera dans le contrat le fait que la banque se rémunère. Et comme l'article 1907 du CC nous dit que le taux est conventionnel ou légal, s'il n'y a plus de taux conventionnel, alors c'est le taux légal qui prend la relève.
La Cour de cassation ne se positionne que sur ce fondement :
l'absence de consentement de l'emprunteur aux surcoûts, même minimes, ce qui induit que le contrat ne s'est pas formé entre les parties, et statue en nullité (droit des contrats). Désolé pour Agra, sur ces seuls fondements, même pour 5 euros, la banque peut être condamnée à rembourser la différence entre l'intérêt conventionnel et l'intérêt légal, ce qui peut aller chercher dans les 70.000 euros dans certaines décisions.
Dura lex, sed lex.
Jugeant sur les fondements du droit des contrats et des nullités, on voit mal la Cour de cassation modifier sa position, d'autant que ce serai déjà fait.
Bien à vous.
Chercheur de Jurisprudences