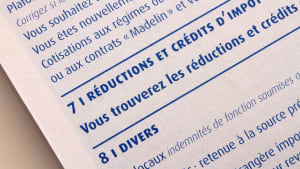Un avocat analyse la décision de la Cour de cassation du 27 novembre 2019, relative à un calcul d'intérêts selon le rapport 30/360
Nous en débattons ici depuis plusieurs jours. Dans un article paru dans Village-Justice aujourd'hui, un professionnel du droit nous livre son interprétation :
Année lombarde - L’arrêt du 27 novembre 2019 [lien réservé abonné]
J'ai envie de retenir un point qui me semble intéressant pour tous les emprunteurs en contentieux avec leur banque sur ce sujet, c'est que le dossier ayant donné lieu à l’arrêt commenté n’était pas expressément abordé sous l'angle du caractère abusif de la clause, mais sur celui de sa nullité, la Cour d’appel relevant simplement qu’aucun taux d’intérêt n’avait été valablement stipulé.
Or on le sait, la Cour de cassation ne fait jamais que répondre à un moyen. Tout le moyen, mais rien que le moyen disent les avocats aux Conseils. Et saisie d’un tel moyen, tiré du caractère abusif de la clause 360, la Haute juridiction pouvait difficilement parvenir à retenir la même solution qu’au cas présent.
D’emblée, on observera que la Haute Cour confirme ici encore que le calcul des intérêts ne peut être effectué sur la base d’une année de 360 jours et que l’usage prohibé du diviseur 360 est de nature à permettre à l’emprunteur d’obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêts.
Sur ce point, cette décision du 27 novembre 2019 fait écho à celle du 24 octobre dernier, et s’inscrit dans une jurisprudence constante.
Par ailleurs, suivant l'une des interprétations de l'auteur, on se rapproche de ce que nous évoquait précédemment Crapoduc :
« La Cour de cassation se réfère à un « surcoût » et un « montant » payé par l’emprunteur, et non à l’information délivrée à ce dernier. » Donc, comment interpréter un surcoût à 0,1 % ?
Ensuite, on retrouve quelque part le raisonnement d'Aristide : si l’on considère le surcoût engendré par l’usage du diviseur 360 comme des intérêts, il faudrait que le surcoût d’intérêts soit égal à 3.456 euros, ce qui reviendrait à porter le taux contractuel à 3,95 % l’an, quand le taux convenu est de 3,85% ! (en ce sens, on est loin de la sacro sainte rencontre des volontés du droit des contrats).
On ne saurait imaginer un instant que la Cour de cassation ait eu l’intention de donner un blanc-seing aux établissements de crédit de prélever de telles sommes, sur la base d’un usage dont on connaît le caractère prohibé.
Enfin, comme le révèlent nos différents échanges, l’arrêt n’évoque à aucun moment un taux erroné, pas plus qu’un TEG erroné, d’une décimale ou non, mais « un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R.313-1 du Code de la consommation ».
Ce ne sont donc ni le TEG, ni le taux nominal qui sont donc ici en cause.
Il n'en reste pas moins que sans l'analyse du Conseiller Rapporteur et sans l'Avis de l'Avocat Général, il reste difficile de se faire une opinion claire sur un tel arrêt. Cela est tout à fait inadmissible, et que je sache, depuis octobre 2019, il a été demandé à la Cour de cassation de mieux développer son argumentation. En l'espèce, ce n'est pas le cas ! :-(