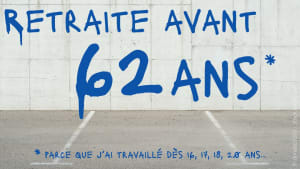agra07
Contributeur régulier
Bonjour,
je comprends que @Manu215 ne puisse pas faire valoir ses droits lorsque la santé des patients, sinon leur vie, est en jeu.
Moi-même ne les ai pas fait valoir lorsque j'étais en activité alors que c'était simplement une question de conscience professionnelle. Il faut dire aussi que je travaillais dans un groupe où le capital était entièrement détenus par les salariés ce qui constitue une motivation supplémentaire.
J'ai vécu, "de l'intérieur" si je peux dire (un proche travaillait à l'époque à l'inspection du travail), l'application des lois Aubry 1 et 2 : une vraie usine à gaz et une grossière erreur politique et économique dont on paie, encore aujourd'hui, les conséquences. Le but était louable: diminuer le nombre de chômeurs en partageant le gâteau travail et ce, bien entendu, sans diminution de salaire. Le postulat était faux et la méthode utopique.
Alors il y a eu deux approches: dans la fonction publique, la réduction représentant environ 10% du temps de travail, soit environ 22 jours par an, a été généralement appliquée arithmétiquement. Dans le privé, des accords de branche on été signés et comme par hasard, dans ma branche, ça a été 11 jours de RTT par an et on a remplacé la durée de travail hebdomadaire par la notion de mission: chacun s'est débrouillé avec cet accord bancal, les salaires ayant été maintenus dans un premier temps et les augmentations annuelles modérées.
Bref, il a fallu faire le même travail avec 11 jours de moins dans l'année: en économie on appelle cela un gain de productivité, mot miraculeux cher à l'époque à Martine.
Alors, quand on réduit de 10 % le temps de travail individuel du personnel d'un hôpital, il n'est guère étonnant que ledit personnel soit débordé et qu'il doive faire des heures supplémentaires.
Je simplifie un peu mais la vérité est qu'on ne réduit pas le chômage en réduisant le temps de travail; en tout cas c'est ma conviction.
je comprends que @Manu215 ne puisse pas faire valoir ses droits lorsque la santé des patients, sinon leur vie, est en jeu.
Moi-même ne les ai pas fait valoir lorsque j'étais en activité alors que c'était simplement une question de conscience professionnelle. Il faut dire aussi que je travaillais dans un groupe où le capital était entièrement détenus par les salariés ce qui constitue une motivation supplémentaire.
J'ai vécu, "de l'intérieur" si je peux dire (un proche travaillait à l'époque à l'inspection du travail), l'application des lois Aubry 1 et 2 : une vraie usine à gaz et une grossière erreur politique et économique dont on paie, encore aujourd'hui, les conséquences. Le but était louable: diminuer le nombre de chômeurs en partageant le gâteau travail et ce, bien entendu, sans diminution de salaire. Le postulat était faux et la méthode utopique.
Alors il y a eu deux approches: dans la fonction publique, la réduction représentant environ 10% du temps de travail, soit environ 22 jours par an, a été généralement appliquée arithmétiquement. Dans le privé, des accords de branche on été signés et comme par hasard, dans ma branche, ça a été 11 jours de RTT par an et on a remplacé la durée de travail hebdomadaire par la notion de mission: chacun s'est débrouillé avec cet accord bancal, les salaires ayant été maintenus dans un premier temps et les augmentations annuelles modérées.
Bref, il a fallu faire le même travail avec 11 jours de moins dans l'année: en économie on appelle cela un gain de productivité, mot miraculeux cher à l'époque à Martine.
Alors, quand on réduit de 10 % le temps de travail individuel du personnel d'un hôpital, il n'est guère étonnant que ledit personnel soit débordé et qu'il doive faire des heures supplémentaires.
Je simplifie un peu mais la vérité est qu'on ne réduit pas le chômage en réduisant le temps de travail; en tout cas c'est ma conviction.
 ).
).