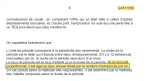Membre39498 a dit:
Merci Jurisprudence, je trouve cet arrêt très critiquable sur le plan de la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation : la cour d’appel nous explique que la prescription a commencé à courir le 11 novembre 2011, et qu’elle a été interrompue par une mise en demeure du 7 novembre 2013. Or seul un commandement (acte d’huissier) interrompt la prescription et non une simple mise en demeure, même par LRAR. L’arrêt a toutes les chances d’être cassé, au bénéfice pour une fois des emprunteurs, en cas de nouveau pourvoi.
En revanche, pour ce qui est de la sanction du taux de période, la cour d’appel de BASTIA a parfaitement raison de s’assoir sur le scandaleux arrêt Civ. 1°, 5 février 2020, n° 19-11939, FS-P+B+I (« Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels. Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313 -1 »). Un commentaire très critique de cet arrêt a d'ailleurs été mis en ligne par Crapoduc récemment.
Pour ce qui est de l'usage du diviseur 360, je ne crois pas qu'on puisse tirer grand-chose de cet arrêt, mis à part l'incurie des avocats de la banque : le rapport d'expertise privée (du genre Humania je suppose) devait démontrer que les intérêts des échéances pleines était calculés en mois normalisés (rien que de très normal), la banque annonçait un document prouvant qu'un calcul avec des années civiles donnerait la même chose (ce qui est vrai si on s'en tient aux échéances pleines) mais les avocats ont joint une autre simulation sans aucun rapport !
Je me permets à mon tour de rebondir sur votre intervention.
Il ne me parait pas judicieux d'indiquer que
la cour d’appel de BASTIA a parfaitement raison de s’assoir sur le scandaleux arrêt Civ. 1°, 5 février 2020, n° 19-11939 puisque les magistrats ont la possibilité de ne pas suivre un arrêt de la Cour de cassation. C'est d'ailleurs dans ce sens que, suite à une série d'arrêts de Cour d'appel (Paris en particulier) allant à contre sens de l'arrêt de 2016, la haute Cour a fait évoluer sa jurisprudence en la matière.
Pour rappel aux termes de l'article R. 313-1 alinéa 2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016,
le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
L’article 1907 du code civil dispose que
l''intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Le formalisme entourant la communication du taux de période n’est pas trop rigoureux puisque celle-ci peut être opérée à l’aide d’un document extérieur au contrat de prêt (Civ. 1re, 19 février 2013, inédit, pourvoi no 12-14.381).
Par un arrêt rendu le
19 février 2013, publié ( Civ. 1ère, 19 février 2013, n°12-14.381 ), la chambre a retenu, au visa des
articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de consommation “ Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si le taux de période avait été expressément communiqué à l'emprunteur, fût-ce dans un document distinct du contrat de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;”
Et par un arrêt en date
du 1er juin 2016, (
1re Civ., 1er juin 2016, n°15-15.813) la chambre a précisément écarté le grief invoqué par le demandeur au pourvoi, tiré de ce qu’aucune sanction, et en particulier la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts, n’était prévue par le code de la consommation en cas de défaut de communication à l’emprunteur du taux de période et que, n’ayant aucune incidence sur le TEG tel qu’il est mentionné dans le contrat, de sorte qu’il ne pouvait emporter la nullité de la stipulation d’intérêts en énonçant que “
l'arrêt retient exactement que, faute de mention du taux de période du TEG, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil ; Attendu, ensuite,faute de mention du taux de période du TEG, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 ducode civil, que la mention dans l'écrit constatant un prêt d'argent du TEG est une condition de validité de la stipulation d'intérêt et que l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention, et qu'ainsi, la sanction est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu ».
Mais la Cour de cassation a progressivement infléchit sa position.
Désormais, en cas de défaut de communication du taux de période :
-dans l’offre de crédit : il est sanctionné, comme l’erreur ou l’absence de mention du TEG, par la déchéance, totale ou partielle du droit aux intérêts conventionnels,
1ère Civ. 6 février 2019, n°17-24.812
-dans le contrat de prêt lui-même : il est sanctionné par la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, par analogie avec l’application de cette en cas d’absence ou d’erreur de TEG,
1re Civ., 27 mars 2019, n°18-11.617 ; 1re Civ. 27 mars 2019, n°18-11.448
En tout état de cause, la Cour de cassation considère que le juge n’a pas à rechercher si l’omission de la mention du taux effectif global à laquelle est assimilée son inexactitude- est de nature à induire l’emprunteur en erreur sur les conditions du prêt (1re Civ., 24 juin 1981, n°80-12.903, Bull. no 234).
Elle juge également que l'indication du taux effectif global n'est qu'une condition de validité de la stipulation d'intérêt elle-même, de sorte que son omission n'entraîne pas, à elle seule, la nullité de la convention (Com., 12 juillet 2005, n° 03-20.997, inédit).
Il s’infère ainsi de telles décisions que, sauf si l’emprunteur soutient que l’erreur affectant le taux effectif global a vicié son consentement au prêt lui-même, le juge n’a pas à s’interroger sur l’incidence d’une telle erreur sur la validité du contrat.
Cette évolution de la jurisprudence a été opérée en partie avec le soutien de la doctrine était favorable à l’introduction du principe de proportionnalité pour sanctionner le défaut du taux de période :
M. Lassere capdeville,(Semaine Juridique Entreprise et Affaires no 3, 19 Janvier 2017, 1044, no 19) la
présence du taux de période permet de vérifier l'exactitude du TEG. Néanmoins, son absence n'a pas d'impact direct sur le calcul de ce dernier.
MM. Crédot et Samin, in Revue de Droit bancaire et financier no 4, Juillet 2014, comm. 126) : “
La solution nous laisse par conséquent circonspects l'absence de communication du taux et de la durée de la période ne postule pas que le TEG soit erroné. Si ces éléments permettent de vérifier la base utilisée par le prêteur pour le calcul du TEG, on ne peut pas pour autant considérer, qu'en leur absence, le TEG serait irrégulièrement mentionné et que la substitution du taux légal serait ainsi justifiée”.
Enfin, M. P. Lutz plaide également pour une mise en conformité de la solution actuellement rendue par la Cour de cassation avec le principe de proportionnalité :
«
Dans tous les cas, la sanction devrait être proportionnée à la gravité de la faute et au préjudice subi. L’exigence de proportionnalité ne résulte pas seulement des deux directives d’harmonisation du crédit à la consommation et du crédit immobilier, lesquelles laissent les sanctions à la disposition des États membres, sous réserve qu’elles soient « effectives, proportionnées et dissuasives ». Il s’agit d’une exigence inhérente au marché intérieur communautaire, qui constitue une condition de l’effectivité de la libre circulation des biens et des services : des sanctions disproportionnées pratiquées dans un pays auraient un effet dissuasif sur les prestations de services transfrontalières » (
in RDBF no 3, Mai 2017, étude 13, no 7).
L’évolution de la législation, notamment l’ordonnance n)2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global, a permis de prendre en compte ce principe de proportionnalité relative aux sanctions .
Voilà où nous en sommes actuellement ….
Sipayung