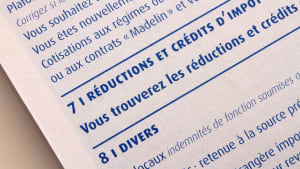Voici ces trois arrêts.
Rien de particulier, sauf Riom qui, bien que constatant l'usage d'un diviseur 360, se met à suivre ses copains de Paris en écrivant :
« M. et Mme X n’ont pas pu valablement consentir au mode de calcul de l’intérêt conventionnel sur la base de l’année lombarde. Toutefois, ce mode de calcul se distingue de l’énonciation elle-même du taux d’intérêt conventionnel qui doit être fixé par écrit conformément à l’article 1907 alinéa 2 du code civil, et dont seul le défaut ou ce qui lui est assimilé, est sanctionné par la nullité de la stipulation d’intérêts.
Dans ces conditions, le Crédit Lyonnais sera tenu de restituer les intérêts trop perçus, sans substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel régulièrement fixé par écrit, soit la somme de 8,08 euros. »
Un tel raisonnement est tout simplement inadmissible car il procède d'une lecture tronquée de l'article 1907 du Code civil qu'il faut rappeler dans son entièreté :
L’article 1907 du Code civil, qui régit tout contrat de prêt d’argent quel qu’il soit, précise que le taux d’intérêt peut être légal ou conventionnel.
L’intérêt conventionnel est celui qui est convenu par les parties, contrairement à l’intérêt légal qui est déterminé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, étant entendu que cette règle conditionne la validité même de la stipulation d’intérêt.
Aux termes de l’article L.313-2 ancien du Code monétaire et financier, le taux de l'intérêt légal est fixé par décret sur la base de l'année civile de 365 jours ou 366 jours.
Ainsi, l'article 1907 fait clairement ressortir que le taux conventionnel qui serait déterminé sur une autre base que celle définie par la loi n’est pas légal.
Dès lors, aux termes de l'article 1907 du Code civil, le taux légal avec lequel le taux conventionnel est comparé, est exprimé en jours exacts sur l'année civile. Pour confronter ces deux taux, ceux-ci doivent être exprimés sur la même base, soit selon un nombre de jours exacts sur l'année civile.
Ainsi, mathématiquement parlant, seule cette base est recevable et doit être reprise pour le calcul des intérêts des prêts immobiliers, l'utilisation de toute autre base empêchant la comparaison avec le taux légal.
Il en ressort donc que les Magistrats de Riom, en constatant l'usage lombard, auraient dû considérer que le taux de l'offre était irrégulier et qu'il ne pouvait pas être celui du contrat pour défaut d'application.
Le taux de l'offre et celui du contrat étant différents, la banque a porté atteinte à l'intégrité du consentement de l'emprunteur qui n'a pas consenti au prix du crédit et à un taux parfaitement indéterminable.
La conséquence de tout ceci aurait dû être la nullité de la clause d'intérêts, et non le remboursement de quelques euros.
En statuant ainsi, les magistrats ont raisonné selon le droit de la responsabilité (le préjudice subi par l'emprunteur) et non selon le droit des contrats qui sanctionne l'absence de consentement.
Il y a encore du chemin à faire pour innover dans l'argumentation.
Ce que je vous propose là est une piste intéressante.
Je soumets à la réflexion de tout un chacun.