Aristide
Top contributeur
Un calcul "journalier" conforme est pourtant bien un calcul "exact/exact"
Cdt
Cdt
Suivez la vidéo ci-dessous pour voir comment installer notre site en tant qu'application web sur votre écran d'accueil.
Note.: Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible dans certains navigateurs.
Aristide a dit:Un calcul "journalier" conforme est pourtant bien un calcul "exact/exact"
Cdt

Membre39498 a dit:Il y n'y a pas de base légale, mais il y a une base réglementaire depuis le 1er octobre 2016, avec le décret du 13 mai 2016 : "L'écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours (...)". Et avant le 1er octobre 2016, il y avait déjà la jurisprudence de la cour de cassation (la jurisprudence est une source du droit, au même titre que les textes) : c'est le fameux arrêt Civ. 1° 19 juin 2013 (Cf. le rapport dont cet arrêt a repris les conclusions : "l’usage du diviseur 360 jours a pour effet arithmétique d’augmenter le taux réel de l’intérêt; ainsi, pour un emprunt de 10000 € à 10 % l’an, si ce taux est calculé sur l’année bancaire de 360 jours, le débiteur paiera (pour trois jours) 8,33 € d’intérêts sur l’année civile, tandis que s’il est calculé sur l’année civile de 365 jours, il ne devra que 8,22 €. Il existe une différence minime mais sensible de 0,11 € l’an". C'est la cour d'appel de Paris qui est complètement hors les clous, si les emprunteurs forment un pourvoi, je ne vois pas comment cet arrêt du 4 septembre pourrait échapper à la cassation.
Jurisprudence a dit:Pourquoi le vocable « pourtant » ?
Il va être difficile de faire comprendre notamment a la CA de Paris que le calcul pour une échéance brisée doit être calculé en exact/exact.
 ), désormais que je l'ai lu, je commence à comprendre.
), désormais que je l'ai lu, je commence à comprendre.— Sur le recours à l’année lombarde pour le calcul des intérêts :
Attendu que selon les termes des offres de prêt : 'les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an',
Attendu que selon les appelants, le seul recours à l’année lombarde serait fautif,
Attendu cependant que 1/360 ème d’intérêts sur 360 jours par an est strictement égal à la méthode des mois normalisés de 1/365 ème d’intérêts sur 365 jours par an à laquelle fait référence l’annexe à l’article R 313-1 du code de la consommation, que les intérêts sont donc bien calculés par la banque, conformément aux exigences légales sur la base de l’année civile,
seul leur mode de calcul étant fait sur la base non de 360 jours par an mais de 30/360 jours c’est à dire de 1/12e chaque mois de prêt,
Membre39498 a dit:si les emprunteurs forment un pourvoi, je ne vois pas comment cet arrêt du 4 septembre pourrait échapper à la cassation.
Aristide a dit:Et, en supposant qu'il y ait pourvoi et que l'arrêt soit cassé, du fait que le calcul effectué concerne bien "chaque mois de prêt"=>donc sur des échéances pleines, et que le calcul 30/360 est donc parfaitement légal, n'y a t-il pas une forte probabilité pour que les emprunteurs soient de nouveau déboutés.............avec des bons arguments cette fois ci ?
Cdt
J'ai toujours été surpris de lire: "calcul du taux débiteur".Membre39498 a dit:Il y n'y a pas de base légale, mais il y a une base réglementaire depuis le 1er octobre 2016, avec le décret du 13 mai 2016 : "L'écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours (...)". Et avant le 1er octobre 2016, il y avait déjà la jurisprudence de la cour de cassation (la jurisprudence est une source du droit, au même titre que les textes) : c'est le fameux arrêt Civ. 1° 19 juin 2013 (Cf. le rapport dont cet arrêt a repris les conclusions : "l’usage du diviseur 360 jours a pour effet arithmétique d’augmenter le taux réel de l’intérêt; ainsi, pour un emprunt de 10000 € à 10 % l’an, si ce taux est calculé sur l’année bancaire de 360 jours, le débiteur paiera (pour trois jours) 8,33 € d’intérêts sur l’année civile, tandis que s’il est calculé sur l’année civile de 365 jours, il ne devra que 8,22 €. Il existe une différence minime mais sensible de 0,11 € l’an". C'est la cour d'appel de Paris qui est complètement hors les clous, si les emprunteurs forment un pourvoi, je ne vois pas comment cet arrêt du 4 septembre pourrait échapper à la cassation.
Jurisprudence a dit:C'est pour cela que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 septembre, que nous avons évoqué précédemment (Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 4 septembre 2019, n° 17/08390), a toutes les chances d'être cassé en cas de pourvoi en cassation de l'emprunteur.
agra07 a dit:Le résultat découlant de ce taux est le tableau d'amortissement, non?
OuiEt c'est donc le calcul de ce tableau qui peut, on non, être entaché d'erreur, non?
Oui, c'est possible dans les cas simples.Pour le commun des mortels, ne serait il pas plus compréhensible d'employer un mode de raisonnement clair (même s'il est possible de calculer un taux à partir d'un tableau d'amortissement).
Oui en général mais pas toujours si c'est un calcul lombard qui considère tous les mois de 30 jours.Pour le reste, tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'un calcul d'intérêts d'une échéance rompue sur une base exact/360 donne un montant d''intérêts illégal car majoré.
agra07 a dit:Bonjour,
J'ai toujours été surpris de lire: "calcul du taux débiteur".
En tant que néophyte, le taux débiteur (ou "conventionnel", "nominal", "contractuel", sauf erreur de dénomination que relèveront les spécialistes), est pour l'emprunteur néophyte une donnée de son crédit et non le résultat d'un calcul.
Le résultat découlant de ce taux est le tableau d'amortissement, non?
Et c'est donc le calcul de ce tableau qui peut, on non, être entaché d'erreur, non?
Evidemment, il en est tout autrement pour le TEG/TAEG qui, lui, est calculé à partir du taux nominal auquel s'ajoutent toutes les charges obligatoires liées au prêt.
Pour le commun des mortels, ne serait il pas plus compréhensible d'employer un mode de raisonnement clair (même s'il est possible de calculer un taux à partir d'un tableau d'amortissement).
Pour le reste, tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'un calcul d'intérêts d'une échéance rompue sur une base exact/360 donne un montant d''intérêts illégal car majoré.
Les décisions de justice ne peuvent toutefois pas faire l'impasse de l'évaluation de cette majoration au regard de la masse des sommes en jeu.
La notion de préjudice, que j'ai évoquée depuis plusieurs mois (ce qui m'a d'ailleurs été vivement reproché par certains) semble aujourd'hui faire son chemin dans l'esprit de certains magistrats.
Dont acte qu'on ne parlait pas du même arrêt. Je parlais de l'arrêt du 4 septembre 2019 de la cour d’appel de Paris. La cour reconnaît, ce qui n'est pas contesté par la banque, que les intérêts inclus dans l’échéance brisée ont été calculés en exact/360 avec un indu de 5,09 €, mais elle refuse d’en tirer la moindre conséquence, au motif que la notion d’intérêt journalier utilisée par l’expert pour calculer le montant des intérêts de l’échéance brisée « n’a pas d’existence légale au regard du principe de l’égalité des mois posé par le législateur, principe d’application générale » (sic). La cour de Douai avait jugé l’inverse, la banque avait formé un pourvoi, puis s’était désistée après avoir pris connaissance de l'avis de l’avocat général et du conseiller rapporteur, dont Jurisprudence a révélé quelques extraits (le rapporteur expliquait notamment que « le grief consistant à reprocher à la cour d’appel de ne pas avoir limité aux intérêts journaliers l’annulation de la stipulation d’intérêts ne peut être suivi. En effet, la nullité de la clause qui fixe le calcul des intérêts sur la base d’une année bancaire de 360 jours emporte l’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels afférente au prêt consenti, ainsi que l’a exactement retenu l’arrêt attaqué ». C’est pour cette raison que je disais qu’un pourvoi contre l’arrêt de la CA Paris avait toutes les chances de prospérer.Aristide a dit:L'attendu que j'ai joint et commenté ci-dessus concerne l'arrêt Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 3 septembre 2019, n° 18/03921 et non pas celui que vous citez que je n'ai pas encore lu (mais je le lirai).
C'est aussi sur le 18/03921 qu'ont portés les échanges antérieurs.
Au plan général je suis cependant d'accord avec vous mais, pour l'arrêt que j'ai lu, puisqu'il n'est question que de:
+ 'les intérêts courus entre deux échéances"
+ "chaque mois de prêt"
=> Il n'y a donc que des échéances pleines qui permettait donc l'utilisation parfaitement légale du mois normalisé.
La rencontre des volontés ou bien son absence ne semble pas concernée.
Cdt

Aristide a dit:OK.
Je suis donc d'accord avec vous.
Et vous êtes d'accord avec moi.
Cdt


Je comprends mais même dans ces cas complexes, il apparait plus "normal" de dire qu'on calcule les intérêts à partir du taux conventionnel et non l'inverse ou alors quelque chose m'échappe?Aristide a dit:Oui mais le tableau d'amortissement prend en compte diverses autres caractéristiques éventuelles.
+ Durée réellement courue (échéance brisée)
+ Franchise/amortissement négatif/technique de capitalisation ou de report des intérêts
+ Frais dossier ou autres prélevés sur les premières échéances
Vous confirmez mon propos ci-avant.Oui, c'est possible dans les cas simples.
Ce n'est pas non plus impossible dans les cas plus compliqués.
Mais par exemple avec des frais de dossier prélevés en priorité sur les premières échéances, une franchise totale de 18 mois qui utilise la capitalisation légale à 12 mois puis un report d'intérêts payables en priorité dans les premières échéances d'amortissement, pas certain que tous soient à l'aise pour comprendre ledit tableau d'amortissement et, partant, de recalculer le taux contractuel.
J'ai effectivement pris connaissance de cette possibilité mais est-elle répandue en pratique?Oui en général mais pas toujours si c'est un calcul lombard qui considère tous les mois de 30 jours
A noter que la CA de PARIS considère qu'une erreur (entrainant un excédent modique d'intérêts) doit s'analyser comme une "mauvaise exécution du contrat".Membre39498 a dit:Dont acte qu'on ne parlait pas du même arrêt. Je parlais de l'arrêt du 4 septembre 2019 de la cour d’appel de Paris. La cour reconnaît, ce qui n'est pas contesté par la banque, que les intérêts inclus dans l’échéance brisée ont été calculés en exact/360 avec un indu de 5,09 €, mais elle refuse d’en tirer la moindre conséquence, au motif que la notion d’intérêt journalier utilisée par l’expert pour calculer le montant des intérêts de l’échéance brisée « n’a pas d’existence légale au regard du principe de l’égalité des mois posé par le législateur, principe d’application générale » (sic). La cour de Douai avait jugé l’inverse, la banque avait formé un pourvoi, puis s’était désistée après avoir pris connaissance de l'avis de l’avocat général et du conseiller rapporteur, dont Jurisprudence a révélé quelques extraits (le rapporteur expliquait notamment que « le grief consistant à reprocher à la cour d’appel de ne pas avoir limité aux intérêts journaliers l’annulation de la stipulation d’intérêts ne peut être suivi. En effet, la nullité de la clause qui fixe le calcul des intérêts sur la base d’une année bancaire de 360 jours emporte l’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels afférente au prêt consenti, ainsi que l’a exactement retenu l’arrêt attaqué ». C’est pour cette raison que je disais qu’un pourvoi contre l’arrêt de la CA Paris avait toutes les chances de prospérer.
agra07 a dit:Je comprends mais même dans ces cas complexes, il apparait plus "normal" de dire qu'on calcule les intérêts à partir du taux conventionnel et non l'inverse ou alors quelque chose m'échappe?
Cette pratique est "exact/360"Pour moi l'année lombarde, c'était celle qui prenait en compte un nombre de jours calendaires rapporté à 360 pour calculer les intérêts sur une période rompue.
C'est la méthode lombardeSi on diminue le nombre de jours par un artifice consistant à supprimer les 31 du mois, évidemment on peut retomber sur ses pieds, voire favoriser l'emprunteur dans la mesure où il y a 8 mois de 31 jours dans une année!...
L'une et l'autre représentent une minorité.J'ai effectivement pris connaissance de cette possibilité mais est-elle répandue en pratique?
Aristide a dit:Il pourrait effectivement se faire que 'les intérêts courus entre deux échéances" soient des échéances uniquement composées d'intérêts intercalaires; mais elles sont alors actualisées comme n'importe quel autre flux de sortie de trésorerie => donc bien pris en compte dans les calculs.
Désolé mais je ne comprends rien !
Cdt
 Assurance vie à La Banque Postale et à la Caisse d'épargne : des taux allant jusqu'à 5% en 2025
Assurance vie à La Banque Postale et à la Caisse d'épargne : des taux allant jusqu'à 5% en 2025
 Taux assurance vie : le palmarès des meilleurs rendements 2025
Taux assurance vie : le palmarès des meilleurs rendements 2025
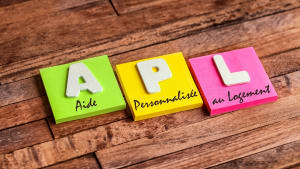 Logement : ce qui change pour le montant 2026 des APL versées par la CAF
Logement : ce qui change pour le montant 2026 des APL versées par la CAF
 Assurance vie 2025 : mauvaise nouvelle pour les rendements de la GMF, MMA et MAAF
Assurance vie 2025 : mauvaise nouvelle pour les rendements de la GMF, MMA et MAAF
 Crédit d'impôt Ehpad : ce ne sera (toujours) pas pour 2026
Crédit d'impôt Ehpad : ce ne sera (toujours) pas pour 2026
 Arrêt maladie : une bonne nouvelle pour la rémunération des salariés de la fonction publique
Arrêt maladie : une bonne nouvelle pour la rémunération des salariés de la fonction publique


