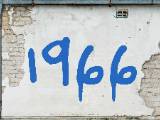Ticket initial publié le 13/05/2011 sur le blog
Tous les 3 ans, la Banque de France réalise une enquête typologique sur le surendettement.
L’édition 2010 qui vient d’être publiée dresse le profil des personnes surendettées et l’évolution de celui-ci par rapport aux enquêtes précédentes.
Ce document met en évidence des tendances qui s’affirment sur la période 2001-2010.
Il s’agit d’une étude nationale élaborée sur la base des dossiers déclarés recevables par les commissions de surendettement au cours des 10 premiers mois de l’année 2010 (soit près de 180.000 dossiers concernant près de 225.000 personnes).
L’étude a tenté de rapprocher certaines des caractéristiques des surendettés avec les données relatives à la population vivant en France publiées par l’INSEE.
Le profil des surendettés
En 2010, 65% des surendettés vivaient seuls et sans personnes à charge alors qu’en 2001 58% des surendettés étaient dans cette situation. On note également une surreprésentation des femmes.
Les surendettés sont de plus en plus âgés : près de 25% d’entre eux ont plus de 55 ans et 8% ont plus de 65 ans. La proportion des surendettés de plus de 55 ans a doublé depuis 2001.
Parmi les surendettés, la part des locataires s’élève à 80% (en croissance depuis 2001) alors que la part des propriétaires a diminué de moitié sur la même période pour s’établir en 2010 à 8%.
L’étude rappelle que, dans la population française, près de 58% des habitants sont propriétaires.
Les catégories socioprofessionnelles les plus représentées sont les employés (34%), les personnes sans activité professionnelle (27,5%) et les ouvriers (24%).
Les ressources des surendettés
En 2010, 83% d’entre eux disposent de moins de 2.000 € par mois, plus d’un surendetté sur deux (54%) doit vivre avec des ressources inférieures ou égales au SMIC et 43% d’entre eux disposent de revenus compris entre le RSA (466 € pour une personne seule) et le SMIC (moins de 1.100 € par mois quand on a la chance de travailler à temps complet).
Les revenus des surendettés sont constitués à 56% de revenus d’activité (contre 80% pour la population globale), à 18% de pensions (contre 7,5%) et de minima sociaux pour 8% (contre 1% pour la population française).
L’écart est encore plus important pour les prestations liées à la famille ou au logement qui représentent 18% des ressources des surendettés mais 4% des ressources de la population française.
La capacité de remboursement des surendettés ne cesse de s’amenuiser.
La part des personnes disposant d’une capacité de remboursement négative a été multipliée par deux depuis 2001 ; cette situation concerne en 2010 56% des dossiers.
L’endettement des surendettés
L’endettement s’élève en moyenne à 34.500 € par dossier et est composé d’environ 10 dettes différentes. Les dettes bancaires (inscrites dans 95% des dossiers) représentent 83% du total (soit un peu plus de 30.000 € par dossier).
On trouve dans cet endettement
—> Des prêts immobiliers dans 7% des dossiers pour un endettement moyen qui approche 90.000 €. Dans les deux tiers des cas, le dépôt du dossier de surendettement intervient dans les 5 années qui suivent l’octroi de ces prêts.
—> Des crédits renouvelables dans 82% des dossiers pour montant moyen de 17.000 €.
—> Des prêts personnels dans près de la moitié des dossiers pour environ 14.500 €.
—> Des découverts en compte et dépassements dans près de 60% des dossiers pour une dette moyenne de 1.300 €.
—> Des dettes de charges courantes (logement, énergie, transports, assurances,…) pour plus de 4.000 € par dossier.
Le patrimoine des surendettés
Moins de 9% des personnes surendettées sont propriétaires d’un bien immobilier.
Un surendetté sur deux dispose d’une épargne qui, dans la majeure partie des cas, est inférieure ou égale à 1.500 €.
°°°°°
Il serait facile, pour les partisans d’un fichier positif (recensant tous les encours de crédit) d’en déduire que, si il n’y avait pas de dettes bancaires… il n’y aurait pas de surendettement.
Ne s’agit-il pas d’un constat un peu rapide ?
D’abord parce que rien ne prouve que les 225.000 personnes dont le dossier a été analysé à travers cette étude ont emprunté alors qu’elles étaient déjà en situation de surendettement.
On peut penser aussi que, lors de l’octroi de chaque nouveau financement, le prêteur a interrogé le FICP afin de vérifier qu’il n’existait pas d’incidents de paiement.
Il est évident qu’avec un revenu moyen aussi faible dans l’absolu (et même si le revenu médian de 2008 s’établissait en France à environ 1.500 € par mois), le moindre accident de la vie (perte d’emploi, maladie,…) peut transformer un crédit supportable… en un crédit impayé.
Ensuite parce que les encours de crédits présents dans ces dossiers sont pour leur immense majorité des crédits de trésorerie (prêts personnels, comptes renouvelables et découverts bancaires) qui ont probablement été utilisés pour faire face aux besoins de la vie courante et au paiement de factures brûlantes.
On comprend aisément que la priorité des surendettés soit de payer le loyer pour éviter l’expulsion et d’honorer les factures d’énergie (électricité, gaz, fioul,…).
Enfin parce que, si ces personnes n’ont plus accès à des crédits de trésorerie du fait de l’instauration d’un fichier positif qui les exclut du crédit, leur endettement sera certes moins important mais il sera alors uniquement composé de dettes relatives à leur logement (loyers, énergie,…) ou à leur vie courante (assurances, transports, cantine scolaire, frais de garde des enfants,…).
Elles seront ainsi plus vulnérables car rapidement menacées d’expulsion locative par des bailleurs (sociaux ou privés) qui ne voudront/pourront pas laisser la dette atteindre des dizaines de milliers d’euros.
Il faudra par ailleurs que la collectivité (je devrais dire les collectivités locales) renforce les aides qu’elle accorde aux personnes en difficultés car il n’est pas pensable de laisser des familles sans abri, sans électricité et sans chauffage ; il n’est pas imaginable non plus de priver les enfants de déjeuner du fait que leurs parents n’ont pas payé la facture de la cantine scolaire.
Il est probablement évident, quand on prend connaissance de l’étude dressée par la Banque de France, de penser que couper le robinet du crédit serait le moyen d’éradiquer le surendettement.
Il est vrai que cette proposition aurait le mérite de déplacer la dette qui, à terme, ne serait plus supportée par les banques mais qui échoirait aux bailleurs, aux collectivités locales et aux associations de bienfaisance.
En effet, tant qu’il y aura dans notre pays des personnes dont les revenus ne suffisent pas à financer le minimum vital (logement, nourriture, énergie, santé, transports,…), il y aura nécessairement une dette ; reste à savoir quels créanciers doivent/peuvent la porter.
Je n’évoquerai pas non plus le formidable outil de marketing que constituerait pour la profession bancaire (au sens large du terme, assureurs compris) un fichier recensant tous les financements accordés à la population vivant dans notre pays.
Peut-on raisonnablement penser réduire (voire éliminer) le surendettement en prenant le risque de générer chaque année l’expulsion locative de plus de 200.000 personnes ?
Est-ce là la seule solution proposée à cette population qui croît en nombre, qui vieillit et dont les ressources (ainsi que la capacité de remboursement) ne cessent de se réduire depuis la mise en place de la loi sur le surendettement en 1990 ?
Un jour viendra, hélas, où le fait d’écrire ou de prononcer l’expression solidarité nationale sera puni bien plus sévèrement… que toute atteinte à la sûreté de l’État.
L’étude de la Banque de France [lien réservé abonné]
Tous les 3 ans, la Banque de France réalise une enquête typologique sur le surendettement.
L’édition 2010 qui vient d’être publiée dresse le profil des personnes surendettées et l’évolution de celui-ci par rapport aux enquêtes précédentes.
Ce document met en évidence des tendances qui s’affirment sur la période 2001-2010.
Il s’agit d’une étude nationale élaborée sur la base des dossiers déclarés recevables par les commissions de surendettement au cours des 10 premiers mois de l’année 2010 (soit près de 180.000 dossiers concernant près de 225.000 personnes).
L’étude a tenté de rapprocher certaines des caractéristiques des surendettés avec les données relatives à la population vivant en France publiées par l’INSEE.
Le profil des surendettés
En 2010, 65% des surendettés vivaient seuls et sans personnes à charge alors qu’en 2001 58% des surendettés étaient dans cette situation. On note également une surreprésentation des femmes.
Les surendettés sont de plus en plus âgés : près de 25% d’entre eux ont plus de 55 ans et 8% ont plus de 65 ans. La proportion des surendettés de plus de 55 ans a doublé depuis 2001.
Parmi les surendettés, la part des locataires s’élève à 80% (en croissance depuis 2001) alors que la part des propriétaires a diminué de moitié sur la même période pour s’établir en 2010 à 8%.
L’étude rappelle que, dans la population française, près de 58% des habitants sont propriétaires.
Les catégories socioprofessionnelles les plus représentées sont les employés (34%), les personnes sans activité professionnelle (27,5%) et les ouvriers (24%).
Les ressources des surendettés
En 2010, 83% d’entre eux disposent de moins de 2.000 € par mois, plus d’un surendetté sur deux (54%) doit vivre avec des ressources inférieures ou égales au SMIC et 43% d’entre eux disposent de revenus compris entre le RSA (466 € pour une personne seule) et le SMIC (moins de 1.100 € par mois quand on a la chance de travailler à temps complet).
Les revenus des surendettés sont constitués à 56% de revenus d’activité (contre 80% pour la population globale), à 18% de pensions (contre 7,5%) et de minima sociaux pour 8% (contre 1% pour la population française).
L’écart est encore plus important pour les prestations liées à la famille ou au logement qui représentent 18% des ressources des surendettés mais 4% des ressources de la population française.
La capacité de remboursement des surendettés ne cesse de s’amenuiser.
La part des personnes disposant d’une capacité de remboursement négative a été multipliée par deux depuis 2001 ; cette situation concerne en 2010 56% des dossiers.
L’endettement des surendettés
L’endettement s’élève en moyenne à 34.500 € par dossier et est composé d’environ 10 dettes différentes. Les dettes bancaires (inscrites dans 95% des dossiers) représentent 83% du total (soit un peu plus de 30.000 € par dossier).
On trouve dans cet endettement
—> Des prêts immobiliers dans 7% des dossiers pour un endettement moyen qui approche 90.000 €. Dans les deux tiers des cas, le dépôt du dossier de surendettement intervient dans les 5 années qui suivent l’octroi de ces prêts.
—> Des crédits renouvelables dans 82% des dossiers pour montant moyen de 17.000 €.
—> Des prêts personnels dans près de la moitié des dossiers pour environ 14.500 €.
—> Des découverts en compte et dépassements dans près de 60% des dossiers pour une dette moyenne de 1.300 €.
—> Des dettes de charges courantes (logement, énergie, transports, assurances,…) pour plus de 4.000 € par dossier.
Le patrimoine des surendettés
Moins de 9% des personnes surendettées sont propriétaires d’un bien immobilier.
Un surendetté sur deux dispose d’une épargne qui, dans la majeure partie des cas, est inférieure ou égale à 1.500 €.
°°°°°
Il serait facile, pour les partisans d’un fichier positif (recensant tous les encours de crédit) d’en déduire que, si il n’y avait pas de dettes bancaires… il n’y aurait pas de surendettement.
Ne s’agit-il pas d’un constat un peu rapide ?
D’abord parce que rien ne prouve que les 225.000 personnes dont le dossier a été analysé à travers cette étude ont emprunté alors qu’elles étaient déjà en situation de surendettement.
On peut penser aussi que, lors de l’octroi de chaque nouveau financement, le prêteur a interrogé le FICP afin de vérifier qu’il n’existait pas d’incidents de paiement.
Il est évident qu’avec un revenu moyen aussi faible dans l’absolu (et même si le revenu médian de 2008 s’établissait en France à environ 1.500 € par mois), le moindre accident de la vie (perte d’emploi, maladie,…) peut transformer un crédit supportable… en un crédit impayé.
Ensuite parce que les encours de crédits présents dans ces dossiers sont pour leur immense majorité des crédits de trésorerie (prêts personnels, comptes renouvelables et découverts bancaires) qui ont probablement été utilisés pour faire face aux besoins de la vie courante et au paiement de factures brûlantes.
On comprend aisément que la priorité des surendettés soit de payer le loyer pour éviter l’expulsion et d’honorer les factures d’énergie (électricité, gaz, fioul,…).
Enfin parce que, si ces personnes n’ont plus accès à des crédits de trésorerie du fait de l’instauration d’un fichier positif qui les exclut du crédit, leur endettement sera certes moins important mais il sera alors uniquement composé de dettes relatives à leur logement (loyers, énergie,…) ou à leur vie courante (assurances, transports, cantine scolaire, frais de garde des enfants,…).
Elles seront ainsi plus vulnérables car rapidement menacées d’expulsion locative par des bailleurs (sociaux ou privés) qui ne voudront/pourront pas laisser la dette atteindre des dizaines de milliers d’euros.
Il faudra par ailleurs que la collectivité (je devrais dire les collectivités locales) renforce les aides qu’elle accorde aux personnes en difficultés car il n’est pas pensable de laisser des familles sans abri, sans électricité et sans chauffage ; il n’est pas imaginable non plus de priver les enfants de déjeuner du fait que leurs parents n’ont pas payé la facture de la cantine scolaire.
Il est probablement évident, quand on prend connaissance de l’étude dressée par la Banque de France, de penser que couper le robinet du crédit serait le moyen d’éradiquer le surendettement.
Il est vrai que cette proposition aurait le mérite de déplacer la dette qui, à terme, ne serait plus supportée par les banques mais qui échoirait aux bailleurs, aux collectivités locales et aux associations de bienfaisance.
En effet, tant qu’il y aura dans notre pays des personnes dont les revenus ne suffisent pas à financer le minimum vital (logement, nourriture, énergie, santé, transports,…), il y aura nécessairement une dette ; reste à savoir quels créanciers doivent/peuvent la porter.
Je n’évoquerai pas non plus le formidable outil de marketing que constituerait pour la profession bancaire (au sens large du terme, assureurs compris) un fichier recensant tous les financements accordés à la population vivant dans notre pays.
Peut-on raisonnablement penser réduire (voire éliminer) le surendettement en prenant le risque de générer chaque année l’expulsion locative de plus de 200.000 personnes ?
Est-ce là la seule solution proposée à cette population qui croît en nombre, qui vieillit et dont les ressources (ainsi que la capacité de remboursement) ne cessent de se réduire depuis la mise en place de la loi sur le surendettement en 1990 ?
Un jour viendra, hélas, où le fait d’écrire ou de prononcer l’expression solidarité nationale sera puni bien plus sévèrement… que toute atteinte à la sûreté de l’État.
L’étude de la Banque de France [lien réservé abonné]