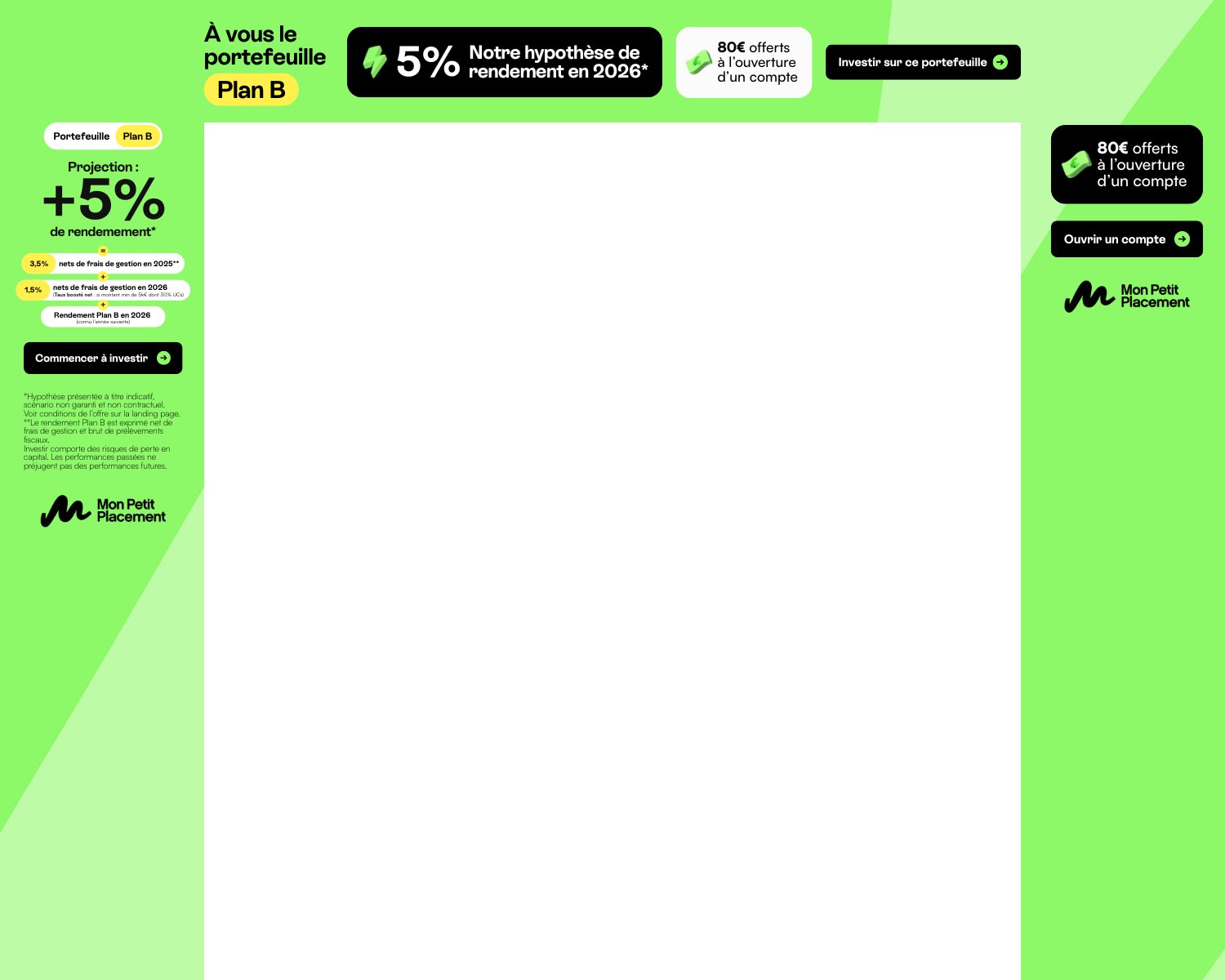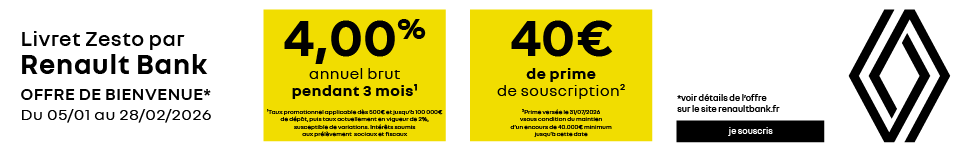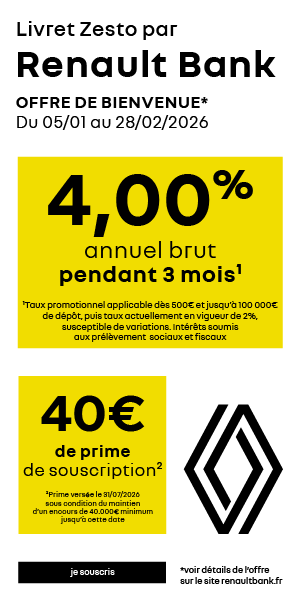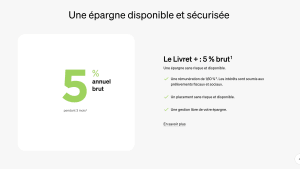L'essentiel
- Un client de LCL réclame le remboursement de 11 800 euros. Selon lui, cette somme a été transférée sans son consentement par son ex-épouse.
- LCL rejette la demande, la qualifiant de litige personnel. Selon les jurisprudences, seules les titulaires de compte peuvent effectuer des retraits.
- Un spécialiste conseille au client de porter plainte contre son ex-femme avant 2026. Selon la loi de 2006, l'immunité familiale ne protège pas les délits d'escroquerie.
C'est une histoire étonnante que relate un article du Monde concernant un courrier adressé par l'un de ses lecteurs. Client de LCL, M. X indique que son ex-épouse a transféré 11 800 euros de son Livret de développement durable et solidaire (LDDS) vers son compte personnel sans son consentement, en juin 2020. Il ne découvre cette fraude qu'en 2021 et réclame alors un remboursement à sa banque. Cependant, LCL rejette sa demande, considérant qu'il ne s'agit pas d'une fraude bancaire, mais d'un litige personnel.
La banque peut se retourner contre le conjoint
Pourtant, le droit bancaire et matrimonial protège le titulaire du compte. Depuis la réforme de 1965, seule la personne titulaire d'un compte peut effectuer des retraits. Une jurisprudence de 2001 avait confirmé cette règle en condamnant la Caisse d'Épargne à restituer près de 200 000 euros à un mari dont l'épouse avait opéré des retraits sans autorisation.
Toutefois, la banque peut se retourner contre l'auteur de la fraude pour récupérer les sommes. Un « recours subrogatoire » qui avait ainsi permis à la Société Générale de récupérer 20 000 euros auprès d'une femme qui avait prélevé cette somme sur le compte épargne de son époux.
« L'immunité familiale ne protège plus ceux qui, pour “commettre le délit d'escroquerie”, “se servent” de moyens de paiement »
Retour à l'affaire de ce lecteur du Monde, client de LCL. En 2024, M. X, ayant découvert un article de l'UFC-Que Choisir sur les escroqueries bancaires, décide de relancer LCL et de saisir le médiateur bancaire. Mais ce recours est trop tardif : la loi impose un délai d'un an après la réclamation écrite.
Dans ce contexte, Jérôme Lasserre Capdeville, maître de conférences spécialiste de droit bancaire, conseille à Monsieur X. de poursuivre pénalement son ex-épouse, avant juin 2026, date à laquelle le délai de prescription, de 6 ans à compter de l'infraction serait écoulé. « En effet, depuis une loi du 4 avril 2006 (article 9), telle qu'interprétée par la Cour de cassation (22-84.591), l'immunité familiale ne protège plus ceux qui, pour “commettre le délit d'escroquerie”, “se servent” de “moyens de paiement” : or, le virement en est un », souligne l'article du Monde.