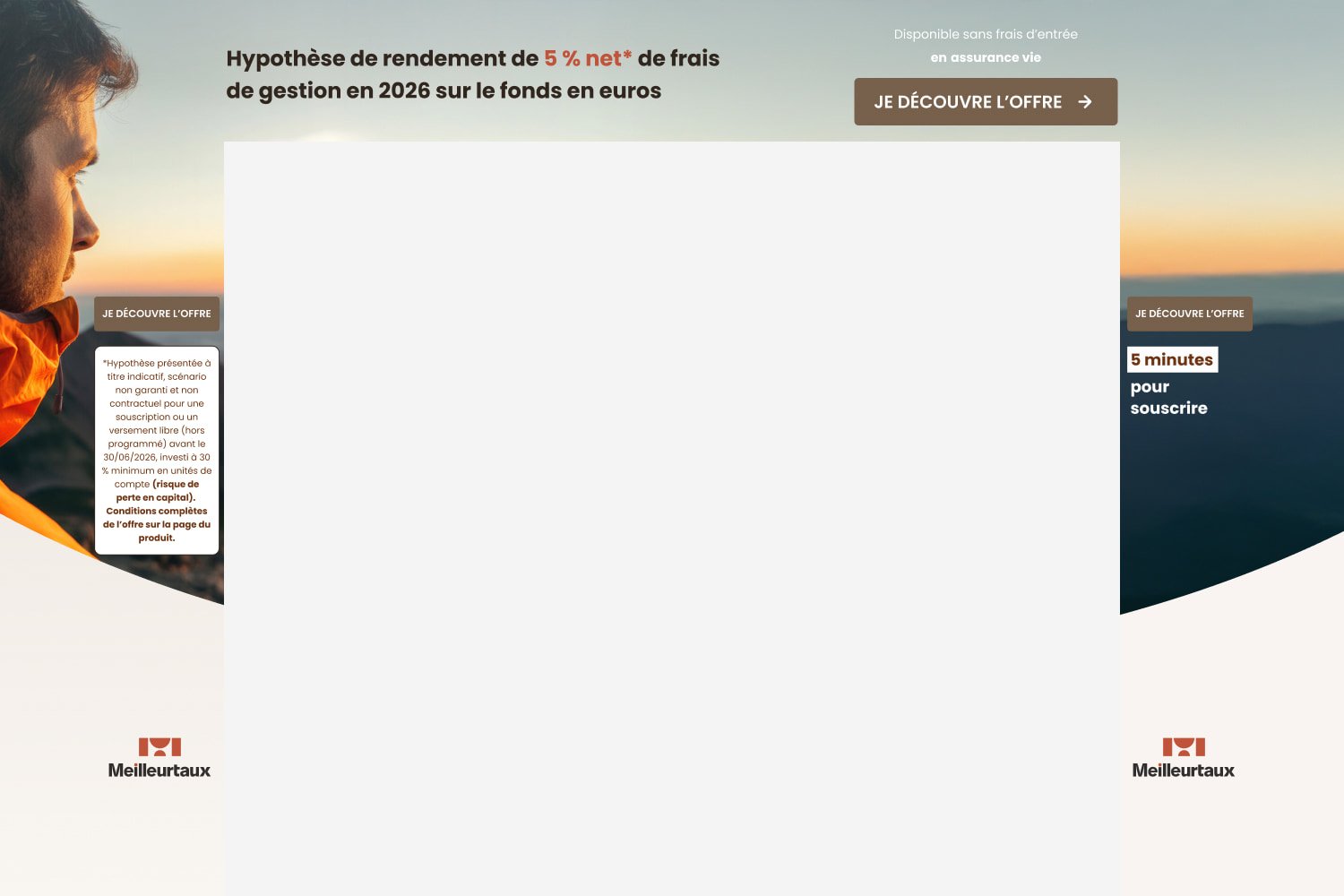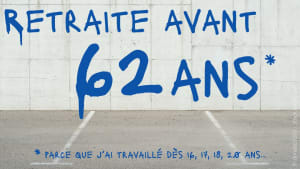Quand et comment clôturer un PER (Plan Épargne Retraite) ? Sortie en capital ou en rente, déblocage anticipé, fiscalité, décès : tout ce qu'il faut savoir afin de récupérer ces fonds.
Le Plan Épargne Retraite (PER) a été conçu pour constituer une épargne à long terme, essentiellement destinée à préparer la retraite. Ainsi, la clôture intervient normalement à l'arrivée de la retraite. Mais parfois, les aléas de la vie entraînent la nécessité d'une fermeture anticipée.
Mettre fin à un PER individuel ne s'improvise pas. Selon la situation personnelle de l'épargnant, les règles diffèrent et les démarches à réaliser varient. L'enjeu fiscal est également conséquent. Alors, comment clôturer un PER individuel sans mauvaises surprises ?
La clôture du PER à la retraite
La demande de déblocage du Plan Epargne Retraite individuel peut être faite dès le jour de l'obtention de la pension de retraite, ou à l'âge légal de la retraite (entre 62 et 64 ans selon votre année de naissance). Cette clôture n'étant pas automatique, l'épargnant doit formuler la demande de fermeture et dans la plupart des cas, il doit aussi faire un choix important.
En fonction de l'emplacement de l'épargne sur le PER, il peut en effet être amené à décider de la manière dont il souhaite percevoir son argent en fonction de ses besoins et de ses projets. Ce choix ne peut être fait que pour le compartiment individuel (n°1) réservé aux versements volontaires, et pour le compartiment collectif (n°2) lié à l'épargne salariale et à l'épargne-temps. Pour le compartiment catégoriel (n°3) relatif aux versements obligatoires du salarié et de l'entreprise, la sortie ne peut avoir lieu qu'en rente viagère (sauf exception).
Dès lors, trois grandes options s'offrent à lui : la sortie en capital, la sortie en rente viagère et la sortie mixte combinant les deux précédentes options.
Certains contrats ne prévoient pas toujours ces trois options. Parfois, la sortie en rente viagère n'est pas possible. Au contraire, dans certains cas, l'option pour la rente viagère se fait dès l'ouverture du contrat et est alors irréversible. Il est donc important, au moment de la souscription, de se renseigner sur ce point.
Le saviez-vous ? Il est tout à fait possible de conserver son PER après son départ à la retraite puisque sa clôture n'est pas automatique ! Mieux encore, l'épargnant peut continuer à l'alimenter, aucun âge limite n'étant prévu par la loi. Par ailleurs, l'ouverture d'un PER demeure envisageable même après la fin de la vie active, et permet de bénéficier des avantages fiscaux de ce placement tout en facilitant la transmission de son patrimoine.
La sortie en capital : totale ou fractionnée
Lors de la clôture du PER au moment du départ à la retraite, il est possible d'opter pour une sortie en capital. Cela signifie que l'épargne placée est versée sous forme d'un ou plusieurs virements et non sous la forme d'un revenu régulier. La sortie en capital peut donc être demandée en une seule fois ou alors de manière fractionnée sur plusieurs années. Le fractionnement, pour être envisagé, doit être expressément prévu dans le contrat. Il est parfois encadré par des conditions.
Cette sortie en capital est possible pour tous les types de versements réalisés sur le PER, sauf pour le ceux du troisième compartiment relatif aux cotisations obligatoires du salarié et de l'employeur comme indiqué précédemment. Elles ne peuvent faire l'objet d'une sortie en capital que dans une seule hypothèse : si le montant de la rente mensuelle ne dépasse pas la somme de 110 euros (article A160-2 du Code des assurances).
En optant pour cette option, le titulaire a l'avantage de récupérer immédiatement les fonds et de pouvoir en disposer pour un éventuel projet ou un nouvel investissement. Elle offre une grande flexibilité dans l'utilisation des fonds, mais ne garantit pas un revenu régulier sur le long terme.
Exemple : un PER contient 50 000 euros. Daniel souhaite en retirer 40 000 à son départ à la retraite pour financer des travaux, puis 1 000 euros par an pendant les cinq années suivantes pour financer ses voyages annuels. Ce fractionnement est prévu dans son contrat. Il peut donc en faire la demande au moment du déblocage à son gestionnaire.
S'agissant de la fiscalité applicable aux montants récupérés, elle est différente selon la déductibilité des versements. Pour rappel, quand une personne verse de l'argent sur un PER durant sa vie active, elle peut choisir si elle le souhaite de déduire tout ou partie de ces sommes de son revenu imposable (dans une certaine limite). Ce choix de la déductibilité se fait annuellement, au moment de la déclaration de revenus, au printemps. Il peut donc être utile d'utiliser un simulateur pour aider à estimer ce qui est le plus intéressant. Lors de la clôture du PER, pour savoir quelle fiscalité s'applique, il faut donc distinguer entre les versements déduits et les ceux n'ayant pas été déduits du revenu imposable au fil des années.
Concernant les versements déduits, la part correspondant aux primes versées est soumise au barème progressif de l'impôt sur le revenu mais elle est exonérée de prélèvements sociaux. Les gains, quant à eux, sont soumis à la flat tax.
Quant aux versements n'ayant pas été déduits du revenu imposable, ils bénéficient d'une fiscalité plus légère à la sortie. Le capital versé est exonéré d'impôt, seuls les gains sont soumis aux prélèvements sociaux.
Incertitude quant à la fiscalité du PER
Depuis le 1er janvier 2026, la flat tax est passée de 30% à 31,4% suite à la hausse de la CSG sur les revenus du capital.
Toutefois, une incertitude juridique subsiste pour le PER :
- Le texte de loi ne mentionne pas explicitement le PER parmi les produits exonérés de cette hausse (contrairement à l'assurance-vie).
- Deux interprétations s'opposent : certains experts assimilent le PER assurance à l'assurance-vie (maintien de la flat tax à 30%), tandis que d'autres prévoient l'application du nouveau taux de 31,4%.
À ce jour, aucune confirmation officielle n'a été apportée par l'administration fiscale.
La sortie en rente viagère
La seconde option possible, lors de la clôture du PER, est la rente viagère. Elle permet de transformer l'épargne constituée en revenu régulier versé jusqu'à la fin de la vie, généralement mensuellement ou trimestriellement. Elle renforce la sécurité financière sur le long terme. Elle est tout particulièrement adaptée à ceux qui souhaitent un complément de revenus à la retraite.
Il faut savoir que ce choix est irréversible : une fois la sortie en rente choisie, il n'est plus possible de récupérer le capital. Il faut donc bien réfléchir en fonction de sa possible espérance de vie, de ses besoins et envies, mais aussi de sa situation familiale.
Le montant de la rente est défini en fonction de plusieurs facteurs :
- Le montant du capital sur le PER au moment de la liquidation,
- L'âge du titulaire (plus il est jeune, plus la rente sera faible)
- L'espérance de vie statistique,
- Les conditions prévues dans le contrat (rente simple ou réversible, avec ou sans annuités garanties...).
Exemple : un PER contient 80 000 euros au moment du départ à la retraite. A 65 ans, Paul opte pour une sortie en rente viagère et se verra donc verser 250 euros par mois à vie. Une option de réversion est prévue dans ce contrat. À son décès, cette rente (quelque peu minorée) sera donc reportée sur la tête de son épouse survivante.
Sur le plan fiscal, il faut aussi distinguer selon la déductibilité des versements.
Pour les versements déduits au fil des années précédentes, la rente est soumise au régime des pensions et rentes viagères à titre gratuit. Ainsi, comme les autres pensions de retraite, après un abattement de 10% (dans la limite de 4 321 euros pour 2025), elle est soumise à l'impôt sur le revenu. De plus, elle est imposable aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%, après application d'un abattement qui dépend de l'âge du titulaire :
- 30% pour les moins de 50 ans,
- 50% entre 50 et 59 ans,
- 60% entre 60 et 69 ans,
- 70% pour les plus de 69 ans.
S'agissant des versements non déduits, le régime fiscal applicable est celui de la rente viagère à titre onéreux (RVTO). Cela signifie que seule une partie de la rente, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire lors de son départ en retraite, est soumise à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. L'abattement appliqué sur la rente imposable est défini en fonction de l'âge, soit :
- 70% si le rentier est âgé de moins de 50 ans,
- 50% s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus,
- 40% s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus,
- 30% s'il est âgé de plus de 69 ans.
La sortie mixte : capital et rente combinés
Enfin, il est également possible de combiner la sortie en capital et la rente viagère. Une partie de l'épargne est alors versée immédiatement sous forme de capital, et l'autre est convertie en rente viagère. Ce choix permet de bénéficier d'un apport pour un projet ou un besoin immédiat et d'un revenu régulier à vie pour compléter sa retraite.
Exemple : un PER contient 100 000 euros au moment de la retraite. Sophie décide de percevoir 40 000 euros en capital pour aider son fils et de convertir le solde en capital de façon à se voir verser 190 euros par mois jusqu'à la fin de sa vie.
La fiscalité applicable aux sommes débloquées suit la nature de chaque partie. Le capital est soumis à l'impôt selon l'origine des versements, et la rente, quant à elle, est traitée comme une pension de retraite, comme expliqué ci-dessus.
La fiscalité du PER au cours de la vie
Comparatif des modes de sortie
Options | Avantages | Inconvénients | Profils concernés |
|---|---|---|---|
Sortie en capital |
|
|
|
Sortie en rente viagère |
|
|
|
Sortie mixte |
|
|
|
En fonction des besoins et du profil de l'épargnant, certains modes de sorties sont plus adaptés que d'autres.
Ainsi, par exemple, pour un retraité ayant déjà des revenus réguliers suffisants et ayant besoin de liquidités pour réaliser un projet, il peut être intéressant d'opter pour une sortie en capital.
A contrario, pour un retraité ayant de faibles revenus, la sortie en rente viagère peut être plus opportune. Enfin, il est aussi possible d'envisager une sortie mixte, permettant d'allier liquidités et complément de revenus réguliers, à condition que le contrat du PER prévoit cette option.
Les cas de déblocage anticipé du PER
Afin de prendre en compte les imprévus de la vie, le législateur a prévu sept cas dans lesquels le titulaire d'un PER individuel peut demander son déblocage anticipé (article L.224-4 du Code monétaire et financier), à savoir :
- L'invalidité du titulaire, ou de son conjoint, ou de son partenaire pacsé, ou de l'un de ses enfants : cette invalidité doit être de 2ème catégorie (incapacité de travailler) ou de 3ème catégorie (incapacité de travailler avec besoin de l'assistance d'une tierce personne) selon la classification de la Sécurité sociale.
- Le décès du conjoint ou du partenaire pacsé du titulaire du PER : dans ce cas précis, la demande de clôture doit avoir lieu au plus tard dans les six mois suivant le décès.
- L'expiration des droits au chômage du titulaire après un licenciement ou une rupture conventionnelle.
- La situation de surendettement du titulaire.
- La cessation d'activité non salariée suite à une liquidation judiciaire.
- L'acquisition, par le titulaire, de sa résidence principale ou la remise en état de celle-ci après une catastrophe naturelle.
La fermeture du PER en cas de décès
Le décès du titulaire entraîne de plein droit la clôture du PER non encore débloqué. Cependant, le sort de l'épargne dépend de la nature du plan épargne retraite. En effet, il faut différencier le PER bancaire et le PER assurantiel.
Dans l'hypothèse où le PER est un PER bancaire, il prend généralement la forme d'un compte-titres. Ainsi, au moment du décès du titulaire, le PER non débloqué est clôturé et l'épargne intègre l'actif successoral. Il sera donc réparti entre les héritiers selon les règles de dévolution légale et soumis aux droits de succession.
Dans la majorité des cas, le PER est un PER assurantiel, c'est-à-dire un contrat d'assurance de groupe contenant une clause bénéficiaire. Dès lors, il subit le même sort qu'une assurance-vie. La fiscalité dépendra de l'âge du titulaire au moment du décès (avant ou après 70 ans).
Clôturer un PER : les démarches
Pour clôturer le plan d'épargne retraite, il suffit d'adresser une lettre (en recommandé avec accusé de réception, de préférence) au gestionnaire du contrat en précisant les coordonnées, le numéro du contrat et le motif de déblocage. Le gestionnaire peut être un assureur, une mutuelle, ou encore une société de gestion. Certains gestionnaires proposent également d'adresser la demande en ligne, via l'espace client.
Il est nécessaire de joindre à cette lettre une pièce d'identité, un RIB ainsi que tous les éléments justificatifs nécessaires. Il est recommandé de se rapprocher directement du gestionnaire du contrat pour connaître la liste des éléments à fournir.
Les documents varient selon le motif de déblocage invoqué. Par exemple, en cas de déblocage pour invalidité, il sera nécessaire de joindre une attestation de la CPAM et/ou un certificat médical. En cas de décès, il faudra joindre le livret de famille ainsi qu'un original de l'acte de décès. Dans l'hypothèse où la demande de déblocage fait suite à la cessation de droits au chômage, il faudra fournir une attestation de France Travail (anciennement Pôle Emploi). Si le motif de déblocage invoqué est l'acquisition de la résidence principale, il sera nécessaire de produire le compromis de vente ou l'acte notarié d'acquisition.
Les délais de traitement sont variables selon chaque établissement, mais ils sont généralement de deux à quatre semaines après réception du dossier complet.
Le transfert du PER, alternative à la clôture
Les motifs de fermeture d'un plan épargne retraite sont donc restreints. Néanmoins, dans l'hypothèse où la volonté de clôturer son PER est liée à des frais de gestion trop élevés, à un mauvais rendement ou à une volonté de réaliser un regroupement de contrat, il existe une alternative : le transfert du PER.
Les démarches à réaliser sont similaires, sauf que l'argent n'est pas débloqué mais simplement transféré sur un autre contrat. Il est possible que des frais soient appliqués si le PER a moins de 5 ans, mais ils sont plafonnés à 1% maximum de l'encours. Si le PER a plus de 5 ans, alors le transfert est nécessairement gratuit.
Transfert de PER : les règles pour transférer un contrat

Alexandrine CHICOINE
Diplômée notaire et titulaire d’un Master 2 en gestion de patrimoine, Alexandrine est en charge de la veille juridique et du décryptage des textes... Lire la suite
© MoneyVox 2025-2026 / Droits réservés